19/04/2025
Georg Trakl, Œuvres complètes

Rencontre
Sur le chemin du pays étranger — nous nous regardons
Et nos yeux fatigués interrogent :
Qu’as-tu fait de ta vie ?
Tais-toi ! Tais-toi ! Cesse ces plaintes !
Il fait déjà plus froid autour de nous,
Les nuages se défont dans les lointains,
Nous n’interrogerons plus longtemps, il me semble,
Et nul ne nous accompagnera dans la nuit.
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduction
Marc Petit et Jean-Claude Schneider,
Gallimard, 1972, p. 309.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, œuvres complètes, rencontre | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2025
Georg Trakl, Œuvres complètes

Le long des murs
Un vieux chemin s’en va le long
Des jardins sauvages et des murs solitaires.
Des ifs millénaires frissonnent
Dans le chant montant tombant du vent.
Les phalènes dansent près de mourir,
Mon regard boit en pleurant les ombres et lumières.
Au loin flottent des visages de femmes
Fantomatiquement peintes sur le bleu.
Un sourire tremble dans l’éclat du soleil,
Tandis que je poursuis lentement mon chemin ;
Un amour infini m’accompagne.
En silence verdit le roc dur.
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduction
Marc Petit et Jean-Claude Schneider,
Gallimard, 1972, p. 183.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, œuvres complètes, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2025
Georg Trakl, Œuvres complètes

Dans un vieil album
Toujours tu reviens, mélancolie,
Ô douceur de l’âme solitaire.
Un jour d’or embrase sur sa fin.
Humble se couche à sa douleur le patient
Résonnant d’harmonies et de tendre folie.
Vois ! Le soir déjà s’est assombri.
Revient la nit, et lamente un destin mortel,
Avec lui un autre endure.
Tressaillant sous les étoiles d’automne
Penche plus profond chaque année la tête.
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduction
Marc Petit et Jean-Claude Schneider,
Gallimard, 1972, p.42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, œuvres complètes, album, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2025
Pierre Reverdy, Nord-Sud

Littérature
Dans un coin de petits personnages se dont face. Derrière chacun d’eux, il y a une glace. Et ils se retournent pour écrire, car ils écrivent. Plus énorme à leurs yeux que l’actualité — qui pourtant leur est chère (de quoi s’occuperaient-ils ?) — chacun parle de soi et se félicite. Ils se félicitent même l’un l’autre… humblement. Il y a aussi ce petit concert de voix d’enfants encore naïfs qui trépignent de joie. On entend des applaudissements nombreux. Les acteurs eux-mêmes applaudissent.
Quand on a fini de parler de soi-même quelqu’un prend l’encensoir et le promène sous le nez de quelque faux grand homme en forme de mannequin. À l’enseigne de … la boutique est fermée.
La muflerie est un courage autant qu’encourir les rigueurs de la censure (celui-ci très recherché). Et on travaille ferme pour la littérature.
Pierre Reverdy, Nord-Sud, dans Œuvres
complètes, Flammarion, 2010, p. 486.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, nord-sud, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
15/04/2025
Pierre Reverdy, Le cadran quadrillé

Le temps demain
La flamme au cadre
Et le visage au fond du puits
À son rebord
On entend la musique sourde
l’esprit s’endort
Le chemin dans le ciel bordé de briques rouges
La rampe où se suivent les mains
Devant les paupières fermées
Près du jardin
Les armes suspendues
La lune sur la tête
Et l’heure qui sort de la croisée
En même temps qu’une voix claire
Peut-être rien
Pierre Reverdy, La cadran quadrillé, dans Œuvres complètes, Flammarion, 2010, p. 833.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le cadran quadrillé, le temps demain | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2025
Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit

Et là
Quelqu’un parle et je suis debout
Je vais partir là-bas à l’autre bout
Les arbres pleurent
Parce qu’au loin d’autres choses meurent
Maintenant la tête a tout pris
Mais je ne l’ai pas encore compris
Je marche sur tes pas sans savoir qui je suis
Il faut passer par une porte où personne n’attend
Pour un impossible repos
Tout s’écarte et montre le dos
Un peu de vide reste autour
Et pour revivre d’anciens jours
Une âme détachée s’amuse
Et traîne encore un corps qui s’use
Le dernier temps d’une mesure
Plus tendre et plus déchirant
Plus tenace et plus déchirant
Un chagrin musical murmure
Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit, dans Œuvres
complètes, Flammarion, 2010, p. 229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les ardoises du toit, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
13/04/2025
Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit

Carrefour
«’arrêter devant le soleil
Après la chute ou le réveil
Quitter la cuirasse du temps
Se reposer sur un nuage blanc
Et boire au cristal transparent
De l’air
De la lumière
Un rayon sur le bord du verre
Ma main déçue n’attrape rien
Enfin tout seul j’aurai vécu
Jusqu’au dernier matin
Sans qu’un mot m’indiquât quel fut le bon chemin
Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit, dans Œuvres
complètes, Flammarion, 2010, p. 201.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les ardoises du toit, chemin | ![]() Facebook |
Facebook |
12/04/2025
Pierre Reverdy, Les Ardoises du toit

Minute
Il n’est pas encore revenu
Mais qui dans la nuit est entré
La pendule les bras en croix
S’est arrêtée
Pierre Reverdy, Leq Ardoises du toit, dans
Œuvres complètes, I, Flammarion 2010, p. 185.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les ardoises du toit, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
11/04/2025
Pierre Reverdy, La Lucarne ovale

Grandeur nature
Je vois enfin le jour à travers les paupières
Les persiennes de la maison se soulèvent
Et battent
Mais le jour où je devais le rencontrer
N’est pas encore venu
Entre le chemin qui penche et les arbres il est nu
Et ces cheveux au vent que soulève le soleil
C’est la flamme qui entoure sa tête
Au déclin du jour
Au milieu du vol des chauves-souris
Sous le toit couvert de mousse où fume une cheminée
Lentement
Il s’est évanoui
Au bord de la forêt
Une femme en jupon
Vient de s’agenouiller
Pierre Reverdy, La Lucarne ovale, dans Œuvres complètes, I, Flammarion, 2010, p. 109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la lucarne ovale absence | ![]() Facebook |
Facebook |
10/04/2025
Christopher Okigbo, Labyrinthes

Lustres
Alors j’irais encore dans les collines alors j’irais là
où jaillit la fontaine
là-bas pour y puiser de l’eau
Et à la cime des collines grimperais
corps et âme
chaulé dans la rosée de lune
là-bas pour aller voir d’en haut
Alors j’irais de mon œil balayer la brume
alors j’irais
de brume de lune jusqu’à cime de colline
là-bas pour purification
Ici est un œuf à eine pondu ici une poule blanche à mi-terme.
Christopher Okigbo, Labyrinthes, édition bilingue, traduction de l’anglais (Nigeria) par Christine Fioupou, Poésie/Gallimard, 2025, p.83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher okigbo, labyrinthes | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2025
Alexis Bardini, Ressacs

La nuit venue je tombe en toi
Tu redeviens d’ombre
Et dans cette eau que la lune éblouit
Tu te sens pris d’un grand vertige
Tu veux danser et tu t’installes
Dans ta légende
Une main immobile
L’autre désaccordée
Entre nous l’abîme
Trait d’union de l’orgueil
Tu tais en toi les noms
Dont la vieillesse poudre ton visage
À retrousser l’obscur nos mains s’épuisent
Alexis Bardini, Ressacs, Gallimard, 2024, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexis bardini, ressacs, vertige | ![]() Facebook |
Facebook |
Gabriel Mwènè Okoundji, L'âme blessée d'un éléphant noir
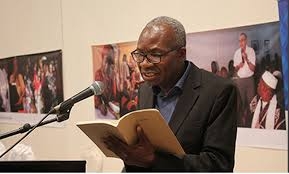
Avec ta main entière sur ton cœur, juste ta main comme repère
tu apprendras à être proche sans te confondre
tu apprendras à croire ce que verront tes yeux d’homme
dans le désordre ardent de l’obscurité meurtrière
l’arbre qui se consume dans l’épreuve du feu n’ignore pas le recueillement
et n’oublie pas
ta parole est ta mémoire
le silence est ton enclos
aux âmes vulnérables
la patience garantit l(éternité du chemin
Gabriel Mwènè Okoundji, L’âme blessée d’un éléphant noir, Poésie/Gallimard, 2025, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriel mwènè okoundji, l'âme blessée d'un éléphant noir, patience | ![]() Facebook |
Facebook |
08/04/2025
Soline de Laveleye, Par les baleines

(…) Ne l’as-tu pas été, cette suite d’organes qu’on ausculte, sur laquelle on légifère, qu’on veut bride ou débrider, selon l’humeur. Tour après tour — dans le miroir à facettes les contours t’échappaient. Ne l’as-tu donc pas été cet élan ? Il trahissait tes orifices qu’il fallait occuper, dégager et emplir encore. Nous l’avons été — comme nous avons été empoisonnées trifouillées arrêtées — et nous avons été un corps qui s’étire et qui se renforce, un corps qui porte au jour, un corps qui se dédouble. Un corps désigné, ou encore : un corps étranger, un corps second. Nous avons été cette course, cette horizontalité, cette entité qui fend qui flotte qui chute. Tour après tour. Un corps de cycles. Des nuits, des jours. Ça continue à tourner. Il y a des masses et des fluides, de l’air autour et à travers, de l’air qui contient et qui élargit. Et nous ne saurons jamais vraiment, le saurons-nous, un jour le sauras-tu : ça commence où, ce corps ? et où ça s’arrête ?
Soline de Laveleye, Par les baleines, Gallimard, 2025, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soline de laveleye, par les baleines, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2025
Soline de Laveleye, Par les baleines

C’était hier
Te souviens-tu du rêve
qui dépliait un ciel entre tes omoplates
quand les grandes migrations
en le quadrillant
te rappelaient l’espace
qu’il restait à grandir ?
Où courais-tu aigu ? Quelle odeur sur tes doigts ?
Quelle voix familière te clouait-elle au lit ?
Quelle rivière se nouer aux chevilles, quand le désir déborde ?
Quel visage a sorti
cette enfance du placard et le cœur du fourreau et la langue de son nom ?
Quel être a tramé notre perte
qui chantonnait la vie au fond du labyrinthe ?
Un beau jour il reste les accrocs, les appels perdus, les petits pas marins
pour faire semblant de vivre
Jusqu’au prochain passage d’un camion sous la pluie
son sillage de soie rêche où mord parfois le cœur.
Soline de Laveleye, Par les baleines, Gallimard, 2025, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soline de laveleye, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
06/04/2025
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G, automne 2024

Dans le poème de la une de couverture, Larry Eigner pose la question « qu’est-ce que l’abstrait ? qu’est-ce que le concret » après une suite de mots écrits verticalement :
carte
peinture
poème
truc
vert
soleil
couleur
La liste peut être dite "concrète", chaque mot évoque un élément du monde et, en outre,peinture et couleur peuvent être associés, ou d’une autre manière peinture et poème — et d’autres relations existent ; elle est abstraite dans la mesure où la signification de la liste n’est construite que par le choix d’un lecteur, sinon la série reste un tas de mots, comme tel tableau de Paul Klee est ou n’est pas un amas de formes et de couleurs.
Un second texte de Larry Eigner appellerait des remarques analogues et cette nécessité d’inventer sa lecture caractérise évidemment une grande partie de la livraison.
On ne s’étonnera pas que l’on ait à le faire pour le long poème, en vers et prose, de Claude Royet-Journoud ; "La pensée n’opère que sur des surfaces ", repris avec d’autres poèmes parus dans K.S.O.N.G. dans Une disposition primitive (P.O.L., 2025). On note des constantes, comme l’absence de continuité d’un vers ou d’un groupe de vers à l’autre ; ainsi pour les premiers vers :
On y dépose de simples éléments
Corps penchés sur les débris
Des yeux se ferment
On repère le jeu des pronoms (on, il, elle), également propre à l’auteur, la présence d’un miroir qui double l’image — « le corps se scinde en deux » —, mais aussi un « corps dénué de visage », « un corps éparpillé », à partir du moment où la maîtrise des mots s’altère. Avec l’idée d’une scène dans le passé, avec le travail de la mémoire d’où surgissent des mots, le lecteur de Royet-Journoud a le sentiment de lire un immense poème commencé avec la publication de son premier livre, Le Renversement (1972) où était interrogée la composition de l’écrit — « alors décroît le nom / à l’avant de chaque parole / de chaque accomplissement / métaphorique » (p. 83). Interrogations analogues ici — « Combien de temps pour que le sens enfin nous parvienne » — et réponse que seule la lecture pourra proposer.
Les fragments d’un récit de Robert Creeley, traduits par Martin Richet proposent des aspects différents de son écriture. Une série d’énoncés avec le mot "dent" juxtapose le réel (« dents de la scie »), la fiction (« dents du dragon ») et l’absurde (« Qui ne s’est pas déjà fait scier une dent en quatre sans s’en souvenir ? ») ; l’unité de cet ensemble est rompue par des éléments sans aucun lien avec la série, comme l’introduction de deux personnages féminins, « Le souvenir de Betty et Marjorie et du voyage à Des Moines est vrai » : l’affirmation met en cause la "vérité", la réalité, de ce qui précède. Ce qui suit semble sans relation avec le développement à propos des dents, mais l’idée de réalité est à nouveau présentée, et répétée, en même temps que la possibilité de la fable, « Quand je me montre telle que je suis, je reviens à la réalité ». La suite introduit des bouts de phrase en espagnol (dont la traduction est présente plus loin dans le texte), la répétition de « Vire au vert, vire au blanc » dans un texte énoncé par un "je" féminin qui affirme plusieurs fois son individualité (« Il faut penser à soi »), pose à nouveau qu’il « revient(t) à la réalité » pour aussitôt annoncer « Retournement. J’aime que mes combinaisons paraissent incongrues ». Les derniers éléments des fragments sont des variations lexicographiques autour du mot « Mother, cette mère (…) », qui se résument dans le mot « source ».
Serge Linarès donne à voir ce qu’a été le travail de l’écrivaine Anne-Marie Albiach sur un poème. Il présente dans son intégralité le premier état du tapuscrit d’un poème, sans ses ratures signalées en note. On aurait souhaité connaître les ratures des deux tapuscrits suivants et que soit joint l’état définitif du poème, "Répétition", publié dans Mezza Voce en 1984 (réédité en 1992) ; tous les lecteurs n’ont pas à portée de main le volume et il est en effet passionnant de découvrir, en y passant beaucoup de temps, comment l’auteur a progressivement transformé et réduit son texte. La lecture préalable de l’essai de Jean Daive, Anne-Marie Albiach, L’exact réel (Éric Pesty éditeur, 2006) aidera, me semble-t-il, à aborder ce tapuscrit
Le titre du poème de Jean Daive, qui clôt le numéro, trappist, est ambigu, renvoyant comme "trappiste" en français au monde cistercien et à une bière fabriquée par des moines, mais il est aussi employé en anglais comme le français "trappeur" et, récemment, c’est le nom donné à une étoile (Trappist-1) située à 40 années-lumière de la Terre. Tous ces usages sont dans le poème qui s’ouvre sur une absence ; à la question « D’où venons-nous du plus loin / que vous et moi et de plus / loin que nous ? », est répondu « « Personne ». / Je ne rien » et, plus avant, sont donnés un temps et un espace non calculables, « Génération après génération / Galaxie et galaxie ». Jean Daive introduit des éléments susceptibles de transformer la lecture qui semblait acquise, les équivalences ciels / eaux, les trois Sœurs — Parques ou Moires —, le jeu du miroir, d’où le double et les paroles dupliquées, etc. On a le sentiment que le poème appartient à un ensemble où ces éléments sont intégrés.
Comme les livraisons précédentes de K.O.S.H.K.O.N.O.N.G., ce numéro exige du lecteur une lecture attentive — et c’est tant mieux : une revue devrait toujours être un lieu d’expériences d’écriture.
K .O.S.H.K.O.N.O.N.G., n° 27, Automne 2024, 32 p., 11 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 février 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |





