03/03/2014
Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
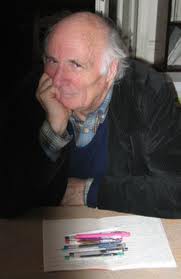
Chant I
Strophe première
Du terminus saint-Lazare
à l'arrêt Havre-Haussmann
L'autobus vingt et neuf, départ de saint-lazare
Comme la ligne vingt
Ce n'est pas par hazare
Les lignes dont le nom commence par un deux
Partent toutes
Partaient
Des lazaréens lieux
À moins que dépecée un jour par un caprisse
De la èr-a-té-pé quelqu'un ne finisse
Ailleurs : ainsi le vingt et deux à l'opéra
Célèbre par son chic et par ses petits ra
Ce haut lieu musical où des milliers se prèsse
Tels des touristes zen partance vers la grèsse
Pour entendre don juan, falstaff ou turandot
Avec plus de ferveur qu'en attendant godot
De mauroy disait quidam dedans la poste
Confondant avec la rue où fidèle au poste
La donzelle chanté' par brassens opérai
Le recrutement d'un client bien argentai
J'insère ici deux vers que je vous donne en primes
Afin de respecter l'alternance des rimes
Dans un film de clouzot autre confusi-on
Analogue on entend
Belle précisi-on
"On ne badine pas avec l'amour" d'alfrède
De musset
Admirez !
[...]
Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, éditions
Attila, 2012, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ode à la ligne 29 des autobus parisiens, alexandrin, rime, récit, couleur | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2013
Edoardo Sanguineti, Corollaire : recension

Corollaire réunit la traduction de 53 poèmes, suivie du texte original, dans un format carré (20x20) qui permet de publier les vers d'un seul tenant. Spécialiste de Dante, lié au compositeur Luciano Berio, au peintre Enrico Baj, fondateur du "gruppo 63" avec Nanni Balestrini, Giorgio Manganelli, Umberto Eco, etc., Sanguineti est encore peu connu en France(1). On lira avant d'entrer dans le livre la courte préface de Jacques Roubaud situant précisément l'activité d'écriture du poète et Corollaire dans un ensemble dont on espère maintenant la traduction.
Stendhal écrivait dans son Journal qu'il faut « tirer les corollaires [d'un] fait », et c'est bien un des aspects du livre. Chaque poème rapporte un souvenir de voyage, relate une soirée ou part d'une anecdote, toujours introduits avec précisons sur le moment (« le dimanche 28 au soir ») et le lieu (« dans une salle du Café Diglas »)[à Vienne] ; un récit est construit, qui se déroule grâce à une succession de détails et de commentaires entre parenthèses. Cette succession est articulée par une ponctuation particulière, deux points, pour introduire une explication, presque toujours une relation de conséquence (un corollaire) entre deux énoncés. On remarque que ces deux points terminent chaque poème qui, donc, pourrait être continué ou est lié au suivant, d'autant plus aisément qu'aucune majuscule n'est présente. On s'attardera sur deux exceptions. La première concerne un poème écrit à la suite d'un voyage à Jérusalem ; après avoir constaté le « puzzle si fou » de la ville et les oppositions religieuses, Sanguineti conclut « je peux comprendre même Moïse et Mahomet : (je peux même leur pardonner, tu vois) : mais de là à nous dire chrétiens, quelle honte ! » — impossible de poursuivre ensuite, pas de corollaire possible...
On repère la seconde exception dans un court récit où le narrateur descend une rue comme « un revenant vivant », ce qui conduit à la conclusion « quelle étrange extravagance, une survivance ! » Le fait lui-même ne peut susciter de suite, le temps vécu pleinement occupant la plus grande place dans la poésie de Sanguineti. Une partie des poèmes se termine par un vers détaché, corollaire à propos de la vie ; ainsi, ce qui peut rester, puisque tout est infiniment petit et sans mystère vis-à-vis du néant, c'est une leçon épicurienne : « c'est vraiment vrai, que j'ai aimé ma vie : (la vie) », « j'en ai joui, moi, de ma vie ». Et il s'agit de la jouissance amoureuse. Le poème d'ouverture part d'une définition de l'acrobate, développée pour explorer toutes ses manières de faire, plus ou moins périlleuses, et se conclut par l'analogie entre l'artiste du cirque et le poète : « (ainsi je me tourne et saute, moi, dans ton cœur) » ; on peut bien lire dans ce vers un art poétique — la phrase de Sanguineti sans cesse bifurque, se reprend, se repent — mais autant un hommage à l'aimée.
Il y a, jusqu'au poème final, un défilé vertigineux de femmes à séduire, et ce qui semble faire vivre le narrateur tient en quelques mots, notés par son père sur un petit morceau de papier conservé précieusement, « copulo ergo sum », formule reprise dans un autre poème. Mais à côté d'anecdotes de drague, l'aimée — « toi », sans nécessité du prénom tant elle est présence — est celle à qui le narrateur écrit, l'unique dont l'absence est inimaginable, celle avec qui on rêve de fusionner : « m'engloutir tout entier, dans ton doux enfer vaginal ». Le thème de l'amante élue opposé aux amours non accomplies, de passage, pour être un lieu commun permet néanmoins à Sanguineti de s'en prendre à une morale hypocrite, en multipliant les esquisses de séduction de toutes les jolies femmes qu'il rencontre et, à l'opposé, en écrivant ce qui est réputé intime, ainsi : « que tu as de longs doigts, chérie, toi, housse poilue de ma pine, si ferme, [...] », puis « nous sommes sur le point de nous accoupler (de nous assassiner, peut-on même / soupçonner), [...]».
Refuser un lyrisme éculé et fonder un tout autre lien amoureux est un parti-pris politique, autant que la critique du commerce capitaliste qui annule, par exemple, ce que pourrait être la découverte de l'autre par le voyage : le narrateur croise à Paris « une armée de japonaises saoules, répugnantes indécentes ». Quant à ceux qui gouvernent l'Italie, Sanguineti appelle à se protéger « contre les noirs recours des seconds barbares de retour, de salon et de Salò », rageant contre « notre pays bordelisé berlusconisé, cette serve Italie forzitaliénée »(2). Il constate aussi la perte de la conscience de classe des prolétaires et ne désespère pas de relever « les vieux drapeaux ».
Dans Corollaire, Sanguineti mêle d'autres langues à l'italien, mais cette introduction n'est pas faite au hasard. Si les mots anglais appartiennent le plus souvent au globish, le latin est présent souvent pour évoquer la tradition classique (y compris dans son usage pour masquer le vocabulaire considéré socialement interdit), le français dans un contexte parisien et les formes colombiennes et mexicaines de l'espagnol lors de voyages en Amérique. Comme le jeu complexe des allitérations, l'emploi de mots valises et de rébus(3), d'allusions à déchiffrerou d'une ponctuation inhabituelle, cette jubilatoire exhibition de la mosaïque des langues, freine la lecture : il s'agit bien de tenir éveillé le « cher lecteur coélecteur », manière de poser aussi, dans notre société, la question de la lecture. Un autre motif parfois s'ajoute : ainsi, l'emploi de l'espagnol permet de mettre en retrait (ou en évidence ?) la question du temps qui passe : après avoir évoqué l'enfance (« muchacho, no partas ahora »), le narrateur ajoute : « entonces [cependant] c'est vrai que je ne peux pas le rêver, vieillard, el regreso [le retour] ». C'est revenir au problème du temps et à la manière dont le "je" se situe dans le livre : un composé incernable, sans cesse occupé par l'odor di femina et se définissant à la fois comme « œnomane érotomane » et « vieux sot et fatigué ». Sanguineti, encore une fois, propose une poésie qui défait l'ordre du vers pour donner aussi à voir le désordre du monde, ce qui se dit : « tout avan[ce] dans le sens dont tourn[e] mon discours, au hasard, en boucle, au point mort, à vide ».
Edoardo Sanguineti, Corollaire, traduit de l'italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas, préface de Jacques Roubaud, éditions NOUS, 2013.
1 Ont été traduits pour les romans : Capriccio italiano (collection "Tel Quel", Seuil,1964 ; Le noble jeu de l'oye (id., 1969) ; et pour la poésie : Renga, avec Octavio Paz, Jacques Roubaud et Charles Tomlison (Gallimard, 1971), Postkarten (L'Âge d'Homme, 1985), dont on peut écouter un extrait lu par Sanguineti sur le site Centre international de poésie / Marseille : (http://www.cipmarseille.com/auteur_fiche.php?id=337).
Sur le gruppo 63, voir Nanni Balestrini : www.nannibalestrini.it/gruppo63/prefazione.htm
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edoardo sanguineti, corollaire, patrizia atzei, benoît casas, jacques roubaud | ![]() Facebook |
Facebook |
25/08/2013
Jacques Roubaud, Ciel et terre et ciel et terre, et ciel, John Constable
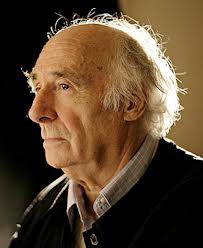
Ciel, Terre, février 1944
Au deuxième étage de la maison, de la chambre, une fenêtre regardait vers l'extérieur. Une fenêtre et lui regardaient, de l'autre côté de la rue en pente vers la droite un espace descendant, non pavé, non goudronné, plus large que la rue, descendant vers la rue qui courait, elle, parallèlement à la fenêtre. Il regardait, et les maisons les plus proches, et l'église, tout en haut de cet Enclos, étaient loin, leurs fenêtres rares, closes : personne ne pourrait le voir regarder. Il était seul. Il pleuvait. Il regardait, et voyait l'eau ruisseler sur le sol, s'en aller dans la pente, suivre sa pente, comme toutes les eaux, comme toutes les pluies. Il voyait devant lui, sous la fenêtre une large flaque, presque une mare, entre le macadam et le trottoir.
Et dans cette flaque d'eau de pluie, que la pluie pointillait, criblait, crevait de son petit plomb de gouttes, les nuages. À genoux sur le parquet à l'odeur de cire propre, le front contre la vitre, il regardait, pendant les heures de l'après-midi oisive, dans l'eau de pluie, les nuages. Ce n'étaient plus les nuages heureux de septembre, mais des nuées rapides, fuyantes, pressées, inquiètes, que le vent poussait l'une après l'autre dans le ciel, des nuages de pluie grise d'hiver, gris. Reflétés dans la vitre de l'eau grise derrière la vitre au verre embué de la fenêtre, ils coulaient en silence dans cette eau triste, comme un torrent.
Jacques Roubaud, Ciel et terre et ciel et terre, et ciel, John Constable, Flohic éditions, 1997, p. 23 et 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ciel et terre et ciel et terre, et ciel, john constable, vitre, nuage, pluie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2013
Jacques Roubaud, Quelque chose noir
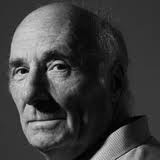
Mort
Ta mort parle vrai ta mort parlera toujours vrai. ce que parle ta mort est vrai parcequ'elle parle. certains ont pensé que la mort parlait vrai parceque la mort est vraie. d'autres que la mort ne pouvait parler vrai parceque le vrai n'a pas affaire avec la mort. mais en réalité la mort parle vrai dès qu'elle parle.
Et on en vient à découvrir que la mort ne parle pas virtuellement, étant ce qui arrive, effective au regard de l'être. ce qui est le cas.
Ni une limite ni l'impossible, dérobée dans le geste de l'appropriation répétitive, puisque je ne peux aucunement dire : c'est là.
Ta mort, de ton propre aveu, ne dit rien ? elle montre. quoi ? qu'elle ne dit rien. mais aussi qu'en montrant elle ne peut pas non plus, du même coup, s'abolir.
« Ma mort te servira d'élucidation de la manière suivante : tu pourras la reconnaître comme dépourvue de sens, quand tu l'auras gravie, telel une marche, pour atteindre au-delà d'elle (jetant , pour ainsi dire, l'échelle). » je ne crois pas comprendre cela.
Ta mort m'a été montrée. Voici : rien et son envers : rien.
Dans ce miroir, circulaire, virtuel et fermé. le langage n'a pas de pouvoir.
Quand ta mort sera finie. et elle finira parcequ'elle parle. quand ta mort sera finie. et elle finira. comme toute mort. comme tout.
Quand ta mort sera finie. je serai mort.
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, mort, vrai, langage | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2013
Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde
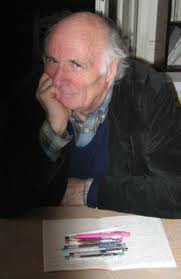
Les pigeons de Paris
« Les petits pigeons pleins de fientaisie »
Raymond Queneau
Les pigeons qui chient sur Paris
ses arbres ses bans ses automobiles
attendent que l'Hôtel de ville
soit propre pour le couvrir de pipi
Les pigeons pollués et gris
polluent de leurs acides chiures
façades vitrines et toitures
les parcs les balcons les mairies
Les pigeons à l'œil archibête
choisissent principalement ma tête
pour y projeter leurs immondices
à la consistance de petits suisses
Ils ne trouvent rien de mieux à faire
dans Paris la Ville Lumière
Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde, Seghers, 1990, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, les animaux de tout le monde, pigeon, paris, pollution | ![]() Facebook |
Facebook |
22/08/2013
Jacques Roubaud, Dors, précédé de Dire la poésie

dormir
dormir
sans que rien
compte
rien vaille
veille
———————————————
nuit
nuit
tu viendrais
les lumières
pousseraient
sur les pentes
vidées de jour
les feuilles en
seraient sombres
———————————————
œil,
dans ton
œil
bleu
devient
gris
devient
bleu
dans l'œil
de ton œil
———————————————
un silence
rien
d'autre
pas
de branche
parlant
à la fenêtre
pas d'œil
à ton ventre
gouttes égales.
Jacques Roubaud, Dors, précédé de
Dire la poésie, Gallimard, 1981, p. 54-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, dors, précédé de dire la poésie, nuit, silence, œil, ventre | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2013
Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, 1987-1990
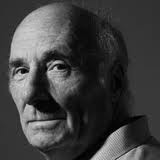
Fleurs, Fleur
La graine jetée dans le ventre de la terre, pourrie dessus-dessous le fumier, battue d’hiver, sur les premières douceurs du printemps, rallie ses petites pièces, ressuscite de petites racines, investissant la motte tendre pour en sucer la moelle, perçant la terre jette un petit filet blanc, une pointe verte, se nourrit à vue d’œil, par laps de temps s’engraisse, gagne le haut,
roidit une tige verte, à la faveur du Soleil boutonne, à couvert digère ses couleurs, le bouton enfle, éclate doucement, montrant en sa fente l’essai de son apprentissage et un rayon de ses beautés, mûries de temps.
La Nature soigneuse de son trésor odoriférant les contregarde curieusement, armant les unes de pointes aiguës, hérissant les autres de piquerons, couvrant celles-ci de feuilles raboteuses, jetant les autres à l’abri des feuilles larges, fait jouer de secrets ressorts, afin que les déboutonnant aux influences de l’Aurore, sur le soir elles se reboutonnent d’elles-mêmes devant les horreurs de la nuit.
Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, 1987-1990, Gallimard, 1991, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, la pluralité des mondes de lewis, fleur, vie des plantes | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2013
Jacques Roubaud, Mono no aware, Le Sentiment des choses

Élégie sur l'impermanence de la vie humaine
nous sommes sans force
contre l'écoulement des années
les douleurs qui nous poursuivent
centuple douleur sur nous
les jeunes filles en jeunes filles
bijoux chinois à leurs poignets
se saluent manches de soie blanche
trainant le rouge de leurs jupons
main dans la main avec leurs amies
mais comme floraison de l'an
que l'on ne peut freiner jamais
avant même de voir le temps
la gelée blanche sera tombée
sur les chevelures noires
comme les entrailles de l'escargot
et les rides (d'où venues ?)
creusent le rose des joues
les jeunes hommes en guerriers
l'épée courte à la taille
l'arc ferme dans les mains
sautent sur leurs chevaux bais
aux selles parées d'étoffes
et vont partout triomphant
mais ce monde de la joie
sera-t-il le leur toujours ?
les jeunes femmes ferment leur porte
qui glissent plus tard doucement et dans le noir
ils retrouvent leur bien aimée
les bras durs serrent les beaux bras
hélas que ce sont peu de nuits
pour eux dormir emmêlés
avant que bâton au flanc
ils vacillent sur les routes
moqués ici haïs là
et ce sera pour nous ainsi
on peut pleurer sur sa vie
rien n'y fait
(envoi)
souvent je pense
ah si je pouvais toujours
être le roc éternel
hélas chose de ce monde
je ne peux éloigner l'âge
Jacques Roubaud, Mono no aware, Le Sentiment des choses cent quarante trois poèmes empruntés au japonais, Gallimard, 1970, p. 29-30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, mono no aware, le sentiment des choses, Élégie, impermanence de la vie humaine | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2013
Jacques Roubaud, Autobiographie chapitre dix
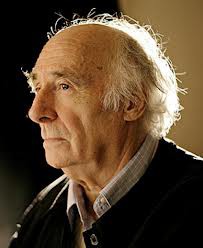
48
ET MAINTENANT, PROSE
je partais pour l'Amérique
c'était le temps des linoléums,
des bocks,
de la margarine,
Il y avait encore, en haut des escaliers, des fenêtres aux carreaux voilés de peinture bleue rayée d'ongles
c'était le temps où les lames gilette uniques, petites brochures d'acier inoxydable d'une seule feuille, s'offraient dans leur emballage bleu
je partais
49
GO WEST, WE
près des grands docks
où les policemen géants sont
piqués comme des points d'interrogation
les marchands d'allumettes
criaient penny penny penny
je me suis promené près de la Tamise
dans cette ville où
toutes les boutiques ont les yeux très jaunes les meilleurs sont les épiceries
on est jeune pour la vie, Nick
Carter les menottes
jetons brillants
tu es le frère de Bayard et de la reine
d'Angleterre. Il n'y a pas de cafés
seulement les trottoirs longs comme les
années ma mémoire me suit
chien plus bête que ses brebis
je vais à Barbizon relire
les voyages du capitaine Cook
Jacques Roubaud, Autobiographie chapitre dix, poèmes avec des moments de repos en prose, Gallimard, 1977, p. 30-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, autobiographie chapitre dix, poésie et prose, l'amérique, la tamise, nick carter | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2013
Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus vite, hélas,...
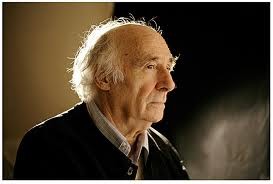
Discours aux rues de Paris
« Rues
Madame
Mademoiselle
Monsieur »,
etc.
*
À la tour Eiffel
Tour Eiffel cesse de me dévisager comme ça
Si je t'offre un sonnet en vers de quatorze syllabes
(Un mètre assidûment cultivé par Jacques Réda)
Ce n'est pas pour que tu me toises de cet œil de crabe
Des toises, certes, tu en as et cette couleur « drab »
(Terne, comme disent les Anglais) du crabe tu l'as
Malgré le mercurochrome du mini-um dont la
Ville soigne tes griffures causées par vents et sables
Entre tes jambes écartées passe la foule épaisse
Qui te lorgne les dessous, que ne voiles-tu tes fesses
(D'ailleurs théoriques) il y a des enfants ici
Qui s'en retourneront bientôt rêver dans nos campagnes
Par trouble amour d'une géante à jamais pervertis
Comme hameaux intranquilles au pied d'une montagne.
Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, Poésie/Gallimard, 2006 [1999], p. 233 et 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, paris, la tour eiffel, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2012
Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde
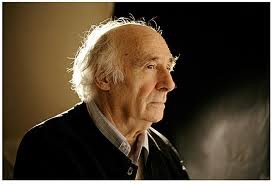
La vache : description
La
Vache
Est
Un
Animal
Qui
A
Environ
Quatre
Pattes
Qui
Descendent
Jusqu'
À terre.
L'escargot
Il passe comme un paquebot
dans l'herbe tremblante de pluie
quand les araignées essuient
leurs toiles car il fait beau
J'ai toujours aimé l'escargot
son pas frais luisant et sans bruit
sa navigation dans la nuit
le long des murs, vivant cargo
on en retrouve le sillage
le matin, brillant au soleil
Où va l'escargot, qui voyage
dans le noir cornes en éveil ?
En haut du fenouil, en équilibre
il médite sur les étoiles libres.
Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde,
poèmes illustrés, Seghers, 1990, p. 74, 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, les animaux de tout le monde, la vache, l'escargot, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2012
Jacques Roubaud, Quelque chose noir
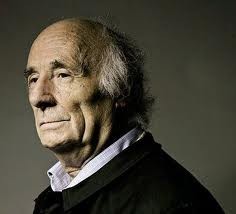
Envoi
S'attacher à la mort comme telle, y reconnaître l'avidité d'un réel, c'était avouer qu'il est dans la langue, et dans toutes ses constructions, quelque chose dont je n'étais plus responsable.
Or, c'est là ce que personne ne supporte plus mal. Où sont les insignes de l'élection individuelle sinon en ce qu'un ordre vous est obéissant, avec ses raisons de langue.
La mort n'est pas une propriété distinctive, telle qu'à jamais les êtres qui ne la présenteraient pas, à jamais s'excluraient des décomptes.
Ni les Trônes, ni les Puissances, ni les Principautés, ni l'Âme du Monde en ses Constellations.
Cela que pourtant tu t'efforçais de frayer, par photons évaporants, par solarisation de ta nudité précise.
La transcription réussie, l'ombre ne devait être nulle part appuyée plus qu'en ce lieu où le soleil avait poussé l'évidence jusqu'au point de conclure : le lit, de fesses qui s'écartent en brûlant.
Or, et c'est là ce que personne ne tolère plus mal, l'écriture de la lumière ne réclame pas l'assentiment.
Pour qui sait lire, seuls les limbes de l'entente.
Et le soleil, qui t'empaquetait entre deux vitres.
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 93-94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, la mort, la mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2012
Jacques Roubaud, Ciel et terre et ciel et terre, et ciel
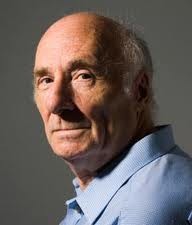
Chapitre 1
Ciel, septembre 1943
Il falalit d'abord franchir le barrage. La retenue d'eau, à l'abandon, en arrière, était envahie d'arbres. La petite rivière se déversait dans le bas, répide, bouillonnante, écumeuse, impétueuse, bordée de roseaux légers. Grâce au barrage, elle était habillée de ronces, de peupliers à l'odeur de miel lourd, de trembles, de frênes, d'aulnes ; feuilles, feuilles vertes ; feuilles déjà jaunes ; feuilles à dessous presque blancs. Un peu plus haut, des arbres, renversés par le vent ou consumés de vieillesse, formaient une sorte de digue : un mur vert, un mur végétal impénétrable. L'eau filtrait à travers ces débris. Elle en sortait toute meringuée d'écume, de libellules, grandes libellules aux yeux de diamant. Les pierres, sur le dessus du barrage, çà et là s'étaient effondrées, disjointes ; couvertes d'herbes, de graminées. Entre elles, des couleuvres d'eau fuyaient en chuintant. Il sautait d'une pierre à l'autre, en espadrilles, restant du côté gauche, du côté de l'eau, par prudence. Il savait nager ; il n'avait pas peur de tomber dans l'eau. Traverser n'était qu'un jeu ; à dix ans, un jeu d'enfant.
Ensuite commençait la garrigue, son territoire personnel, la tranquillité sans menaces, la solitude, son bien. Personne. Il montait par le sentier dans les poussières, es thyms, les muscaris, les lavandes, les buissons de genièvres, les chênes-lièges nains, les vignes abandonnées, quelques pins. Aux coins des vieilles vignes, des pêchers de vigne, des amandiers aux fruits couverts de fourrure verte et grise, comme des oreilles d'âne. Chemin ponctué d'insectes, de froissements, de lézards. L'appel des chiens et des chasseurs, oin. Les passages de vent. Le continuum des grillons comme un silence protecteur. Sur le sentier son pas faisait jaillir des sauterelles. Elles étaient brunes, comme poussiéreuses. Pendant leurs bonds on voyait se déployer le drapeau de leurs élytres; les unes bleues, les autres rouges.
Jacques Roubaud, Ciel et terre et ciel et terre, et ciel, John Constable, Flohic éditions, 1997, p. 7 et 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ciel et terre..., l'eau, enfance, garrigue | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2011
Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis
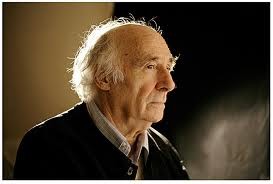
xxii
Monde clair
monde clair, lumières terreuses, pentes
le soleil tourne dans les eaux
j'ouvre les yeux, je constate le poids
de la chaleur sur mes yeux, mes mains,
l'air est brillant, sans durée.
monde arrêté dans la transparence
présent, tournant sur soi
hier obscur, épais, opaque
demain opaque, épais, obscur
monde clair, halte
séjour
sans dimensions, que ton image traverse.
xxviii
Que le monde était là
M'endormant je croyais que le monde était là,
le monde et tout ce qui s'ensuit ;
'maintenant' plus petit qu'un point
derrière les couleurs immenses et sérieuses.
bourdonnantes années revenues de loin,
angle de la rue avec la rue,
effacées traces sous de la pluie,
jaune matériel rassemblé dans la main.
En m'endormant je voyais tout cela :
la chaleur et l'ellipse du puits,
la terre, où les feuilles n'ont plus de poids,
l'eau juste et médiane, qui balance.
Je voyais, m'endormant, je voyais cela
que j'avais accueilli en des années
que je ne savais pas dans mon souvenir :
années entières, avec vérité,
c'est-à-dire, si on veut, avec mort.
Je voulais, et je ne voulais pas, en m'endormant,
voir ce que trop de fois j'avais vu.
Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, Gallimard,
1991, p. 30 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, la pluralité des mondes de lewis | ![]() Facebook |
Facebook |
02/11/2011
Jacques Roubaud, Tombeaux de Pétrarque, dans Dors
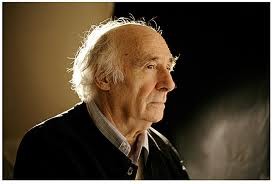
Tombeaux de Pétrarque
cobla I
Ou le soleil mange les étoiles dans l'aube
ou dans la neige tes cheveux prendront rive
comme les vents aux fleuves liés de glace
si des écueils but amer de ma voile
une lumière de collines entre branches
m'écarte neuf j'aborde au cours d'un bois
contre la lune dans tes bois c'est le soir
pas une fleur que la trame de ces notes
poisse les nuits comme rimes à la mort
cobla II
Poisse des fleurs ou dans le style joyeux
si la forêt d'un seul jour sur la terre
s'éveille force de ces vers qui voient l'air
vibrer des yeux s'emplir d'années-laurier
qu'ainsi la pente (la nuit jette les eaux
à ces vallées soit de pluie soit de brume)
partout légère (c'est le prix de ce lieu
nommé le port mais sans navires) : la vie
la nôtre Temps du ciel gavé de feuilles
Jacques Roubaud, Dors, précédé de Dire la poésie, Gallimard, 1981, p. 109-110.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, pétrarque, tombeau, cobla | ![]() Facebook |
Facebook |





