30/05/2024
Franz Kafka, Journal

Je vais essayer de rassembler progressivement tout ce qu’il y a de douteux en moi, plus tard ce qui est plausible, ensuite le possible, etc. Il y a sans doute en moi un désir avide de livres. Non pas, en fait, les posséder ou les lire, mais bien plutôt les voir, me convaincre de leur existence dans la vitrine d’un libraire. S’il y a quelque part plusieurs exemplaires du même livre chacun d’entre eux me réjouit. C’est comme si ce désir provenait de l’estomac, comme si c’était un appétit qui s’égare. Les livres que je possède me réjouissent moi, par contre les livres de mes sœurs me font bien plaisir. Le besoin de les posséder est incomparablement plus faible, il manque presque.
Kafka, Journal, traduction Robert Kahn, éditions NOUS, 2020, p. 211-212.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, journal, livre, librairie, possession | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2024
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Chacun se hisse à sa manière hors du souterrain, moi je me hisse grâce à la littérature. C’est pourquoi, si je dois me maintenir en haut, je ne puis le faire qu’à l’aide de la littérature, et non pas à l’aide de repos et de sommeil. J’obtiendrais plutôt le repos par la littérature que la littérature par le repos.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 681.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, littérature, repos | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2024
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Pour écrire j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Ce n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. (...) Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette peur.
Franz Kafka, Lettre à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1990, p. 470.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice ii, ermite, effroi | ![]() Facebook |
Facebook |
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Pour écrire j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Ce n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. (...) Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette peur.
Franz Kafka, Lettre à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1990, p. 470.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice ii, ermite, effroi | ![]() Facebook |
Facebook |
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Pour écrire j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Ce n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. (...) Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette peur.
Franz Kafka, Lettre à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1990, p. 470.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice ii, ermite, effroi | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2024
Franz Kafka, Lettres à Felice

(...) Je répugne absolument à parler. Du reste ce que je dis est faux à mon sens. A mes yeux la parole ôte à tout ce que je dis importance et sérieux. Il me semble qu’il ne peut en être autrement, étant donné que mille choses et mille pressions extérieures ne cessent d’influencer le discours. Je suis donc taciturne par nécessité, mais aussi par conviction. L’écriture est la seule forme d’expression qui me convienne.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 511.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, parole, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2022
Franz Kafka, A Milena = recension
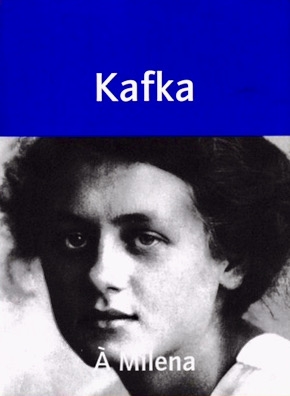
Les éditions NOUS ont eu l’excellente idée de rééditer les lettres à Milena dans la traduction de Robert Kahn, très soucieux de restituer les particularités de l’écriture de Kafka, notamment pour la ponctuation et les répétitions. Situons avec lui la correspondance. Après une rencontre à Prague dans un café, Milena Jesenska proposa à Kafka de traduire le premier chapitre de ce qui deviendra L’Amérique : elle devient alors sa "voix" en tchèque. La jeune femme, journaliste, séduisante, fille d’un médecin connu, fit scandale par une relation avec un Juif pilier de cafés, Ernst Pollack : son père accepta le mariage à la condition que le couple vive à Vienne. Une correspondance s’engage entre l’écrivain et sa traductrice : 140 lettres et cartes postales écrites de mars à décembre 1920, 9 en 1922 et 1923 de Kafka ont été conservées, aucune de Milena dont on connaît souvent la trame par les allusions dans les réponses. Le traducteur insiste justement sur l’absence de différence dans l’écriture entre la correspondance, les Journaux et les fictions, c’est pourquoi toutes les lettres publiées appartiennent entièrement à l’œuvre1.
En mars 1920, Kafka s’adresse à « Chère Madame Milena », il passe à « Milena » le 30 mai ; le 11 juin, à la suite du vouvoiement il ajoute à la fin de sa lettre, « S’il te plaît dis-moi de nouveau une fois encore — pas toujours, je ne veux pas du tout cela — dis-moi une fois Tu » ; le tutoiement est ensuite la règle. Il est intéressant de détailler la relation singulière de Kafka avec Milena : ils ne se rencontrent que deux fois (quatre jours à Vienne, un jour dans une ville frontière) et ne vivent qu’un "amour de loin"2. Il écrit d’ailleurs très tôt (4 juin) à ce propos, « Certes ma chambre est petite, mais la vraie Milena est ici », plus tard le même jour « là où je suis vous y êtes comme moi et plus forte » ; il lui confie en octobre qu’il avait connu dans un rêve leur fusion, « j’étais Toi, Tu étais moi ». Attentive à ce qu’il a publié, à ce qu’il dit de lui dans les lettres, elle lui est vite devenue un soutien qu’il n’avait jamais espéré : « il m’a toujours été totalement incompréhensible que quelqu’un puisse se prendre d’intérêt pour moi. »
L’intérêt que lui porte Milena, puis une forme complexe de passion, satisfait Kafka sans du tout résoudre ses difficultés devant les réalités de la vie. Il voudrait qu’elle soit toujours près de lui et se refuse pourtant à la rejoindre à Vienne ; il lui conseille dans une lettre de ne plus lui écrire tous les jours et, plus avant, « ne suis pas mon conseil et écris-moi (...) même un mot, mais ce mot je ne pourrais m’en passer qu’en souffrant terriblement ». Les lettres, affirme-t-il, « c’est ce qui m’est arrivé de plus beau dans la vie », parce que Milena lui a permis de ne plus être seul ; le fait qu’ils ne soient pas ensemble n’est pas l’essentiel puisque, écrit-il, c’est « toi-même qui es rassurante-inquiétante ». Ce qui importe, c’est l’échange par lettres qui aboutit, selon lui, à ce qu’ils se vivent « seuls dans le tumulte du monde ». L’idéal pour Kafka, inatteignable, serait de ne plus connaître les désagréments de la vie sociale, ce qui ne peut s’accomplir que par la disparition, « il m’apparaît parfois qu’au lieu de vivre ensemble nous devrions nous coucher l’un à côté de l’autre, paisiblement et satisfaits, pour mourir. »
Ce vœu, après leur première rencontre à Vienne, est en accord avec la difficulté, et peut-être l’impossibilité, qu’a Kafka de vivre. Dans la relation amoureuse le "je" semble se dérober quand il répond à Milena, « Tu veux toujours savoir Milena, si [je] t’aime, mais c’est quand même une question difficile à laquelle on ne peut répondre par lettre » ; dans la lettre originale, le ich (= je) manque, « parce qu’il n’y a pas de « je », analyse Robert Kahn. On lit d’autres traces de cet effacement : il signe « Ton » et commente avec humour « Voilà que je perds même le nom » ; dans une autre lettre, il signe « Franz faux F faux Ton faux plus rien silence forêt profonde ». Cette distance vis-à-vis du sujet ne signifie pas du tout une méconnaissance de l’inconscient, lecteur de Freud (dont il ne pense pas que ses théories puissent guérir qui que ce soit), il analyse sa tuberculose comme « un débordement de la maladie mentale ». Le savoir n'empêche pas, cependant, la peur dans la vie de tous les jours.
Le mot "peur" (Angst en allemand) est récurrent, sans que Kafka puisse lui donner un contenu. Il revient souvent à la peur qu’il éprouve constamment, dissipée seulement pendant les quatre jours vécus avec Milena, et il comprend qu’elle ne peut être attribuée à une cause quelconque ; il écrit par exemple à Milena avoir été « préoccupé toute la journée par [s]es lettres, dans la souffrance, l’amour, le souci et dans une sorte de peur tout à fait indéterminée devant l’Indéterminé, dont l’indéterminé consiste pour l’essentiel en ce qu’il dépasse de très loin mes forces ». Il ne pense pas que le fait d’être juif soit une explication, pas plus que sa relation difficile avec son père ; dans l’une des dernières lettres de 1920, il répond à Milena à ce sujet : « Je ne peux expliquer ni à toi ni à personne comment c’est à l’intérieur de moi. Comment pourrai-je rendre compréhensible ce pourquoi il en est ainsi ; je ne peux même pas me le faire comprendre à moi-même. »
Kafka écrit aussi à propos de ses relations dans le monde juif de Prague, de son ami Max Brod, il évoque quelquefois ses lectures littéraires ou non (Freud) et, connaissant fort bien le sionisme, il mentionne son projet — velléitaire — de partir en Palestine.
Dans un article à la mort de Kafka, Milena a compris ce qui est essentiel dans l’œuvre, « Tous ses livres décrivent l’horreur d’une incompréhension énigmatique, d’une innocente culpabilité entre les humains ». Comme les trois sœurs de Kafka, elle a terminé sa vie dans l’enfer d’un camp de concentration, elle à Ravensbruck.
1 On peut lire aussi : Kafka, Lettres à Felice, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, 2 vol. (Felice Bauer a été fiancée à K ) ; Lettres à Ottla et à la famille, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1978 (Ottla, une des sœurs de K).
2 Remembra.m d’un amor de lonh « Je me souviens d’un amour de loin « : R. Kahn cite cette fin du premier vers d’une chanson de Jaufré Rudel (XIIe s.), souvent reprise à propos de l’amour selon les troubadours.
Franz Kafka, A Milena, traduction Robert Kahn, NOUS, 2021, 336 p., 15 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er avril 2022.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, à milenaz, correspondance : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2022
Kafka, À Milena

mardi 17 août 1920
(...) Et c’est juste en ce moment qu’il me semble que j’aurais à te dire de l’indicible, et qui ne peut s’écrire, non pas pour réparer quelque chose que j’ai mal fait à Gmünd, non pas pour sauver quelque chose de totalement submergé, mais pour te faire comprendre en profondeur ce qu’il en est de moi, afin que tu ne te laisses pas effrayer, comme cela pourrait fatalement arriver malgré toute entre les humains. Il me semble parfois être lesté de tels poids de plomb que je devrais en un instant couler à pic au plus profond de la mer et que celui qui voudrait me saisir ou me « sauver » y renoncerait, non par faiblesse, ni même faute d’espoir, mais par simple irritation. Bon, bien sûr, cela n’est pas dit pour Toi, mais pour un faible semblant de Toi, comme une tête fatiguée, vide (ni malheureuse no excitée, c’est presque un état qui ferait éprouver de la reconnaissance) peut encore tout juste le percevoir.
Kafka, À Milena, traduction Robert Kahn, NOUS, 2021, p. 214-215.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, à milena, indicible, comprendre, espoir | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2022
Kafka, À Milena

Prague, 15 juillet 1920
(...) Tu remarques peut-être que cela fait plusieurs nuits que je ne dors pas. C’est tout simplement « la peur ». C’est vraiment quelque chose qui m’enlève toute volonté, qui me jette de ci de là selon son bon vouloir, je ne reconnais plus ni haut ni bas, ni droite ni gauche. (...) De plus dans tes dernières lettres se glissent deux ou trois remarques qui m’ont rendu heureux, mais désespérément heureux car ce que tu dis à ce propos est vraiment convaincant pour la raison, le cœur et le corps, mais il y a encore une conviction plus profonde dont je ne connais pas le lieu et qui ne se laisse visiblement convaincre par rien. Et pour finir, ce qui a beaucoup contribué à m’affaiblir, la disparition au fil des jours du merveilleux effet apaisant-excitant de ta présence corporelle. Si seulement tu étais déjà là ! Donc je n’ai personne d’autre ici que la peur, nous roulons étroitement enlacés l’un à l’autre à travers les nuits. Cette peur recèle quelque chose de très sérieux, en un certain sens elle rend compréhensible le fait qu’elle m’annonce continuellement la nécessité du grand aveu : Milena n’est elle aussi qu’un être humain.
Kafka, À Milena, traduction Robert Kahn, NOUS, 2021, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, À milena, lettre, peur, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
24/03/2022
Kafka, À Milena
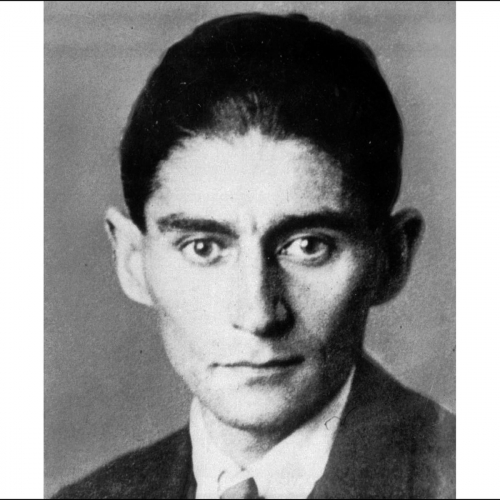
[...] En sortant de la maison la cuisinière disait qu’elle allait raconter au maître quel garnement j’avais été à la maison. En fait je n’étais sans doute pas un tel garnement, mais quand même boudeur, inutile, triste, méchant et sans doute il aurait pu en sortir quelque chose de joli pour le maître. Je le savais et ne prenais donc pas à la légère la menace de la cuisinière. Mais je croyais d’abord que le chemin de l’école était incroyablement long, que beaucoup de choses pouvaient encore s’y passer (c’est à partir d’une telle insouciance enfantine apparente que se développent progressivement, puisque en fait les chemins ne sont pas incroyablement longs, cette anxiété et ce sérieux du regard des morts) et je doutais fort (...) que la cuisinière, certes personne d’une grande respectabilité mais limitée à la sphère de la maison, osât seulement parler au maître, qui lui jouissait du respect du monde entier. Peut-être même disais-je quelque chose dans ce genre-là, et la cuisinière répondait d’habitude brièvement avec ses étroites lèvres impitoyables que je n’avais pas besoin de la croire mais qu’elle le dirait bel et bien. À peu près au niveau de l’entrée de la rue du Marché à la viande (...) la crainte de la menace l’emportait. Car l’école était déjà en soi et pour soi épouvantable et voilà que la cuisinière voulait encore l’empirer. Je commençais à la supplier, elle secouait la tête, plus je suppliais plus me semblait précieux ce pourquoi je suppliais, et plus grand le danger, je restais sur place et la suppliais de m’excuser, elle me tirait en avant, je la menaçais de représailles parentales, elle riait, ici elle était toute puissante (...).
Kafka, À Milena, traduction Robert Kahn, NOUS, 2021, p. 80-81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, à milena, école, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2022
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Chez nous les parents ont coutume de dire que les enfants vous font sentir à quel point on vieillit. Quand on n’a pas d’enfants, ce sont vos propres fantômes qui vous le font sentir, et ils le font d’autant plus radicalement. Je me souviens que dans ma jeunesse je les attirai hors de leur trou, ils ne venaient guère, je les attirais avec plus de force, je m’ennuyais sans eux, ils ne venaient pas et je commençais à croire qu’ils ne viendraient jamais. À cause de cela j’ai déjà souvent été bien près de maudire mon existence. Par la suite ils sont quand même venus de temps à autre seulement, c’était toujours du beau monde, il fallait leur faire des courbettes bien qu’ils fussent encore tout petits, souvent ce n’était nullement eux, ils avaient seulement l’air de l’être ou bien ils le donnaient seulement à entendre. Cependant lorsqu’ils venaient pour de bon, ils se montraient rarement féroces, on n’avait pas lieu d’être très fiers d’eux, ils vous sautaient dessus tout au plus comme le lionceau saute sur la chienne, ils mordaient mais on ne s’en apercevait qu’en maintenant l’endroit mordu avec le doigt et en y appuyant l’ongle. Plus tard, il est vrai, ayant grandi, ils sont venus et sont restés à leur guise, de tendres dos d’oiseaux sont devenus des dos de géants comme on voit sur les monuments, ils sont entrés par toutes les portes, enfonçant celles qui étaient fermées (...).
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 683.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, fantôme | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2021
Kafka, Journaux

Avant de s’endormir. Cela paraît si affreux d’être célibataire, et, vieux monsieur, de quémander un accueil en ayant du mal à conserver sa dignité quand on veut passer une soirée avec des gens, rapporter son repas à la maison dans sa propre main, ne pouvoir attendre personne paresseusement et avec une tranquille confiance, ne pouvoir faire de cadeaux qu’à grand-peine ou en s’énervant, prendre congé devant la porte de la maison, ne jamais pouvoir se précipiter en haut de l’escalier avec sa femme, être malade et n(avoir pour seule consolation que la vue de sa fenêtre quand on peut s’asseoir, n’avoir dans sa chambre que des portes de côté qui donnent sur les appartements d’autrui, avoir à ressentir les membres de sa famille comme des étrangers, avec lesquels on ne peurt rester ami que par le mariage, d’abord le mariage de ses parents, ensuite, quand l’effet en est passé, le sien propre (...)
Kafka, Journaux, traduction Robert Kahn, NOUS, 2020, p. 216-217.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journaux, célibataire, solitude, ennui | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2021
Kafka, Journaux

Il est certain que le dimanche ne me sera jamais plus utile qu’un jour de semaine, car la disposition particulière des heures renverse et brouille toutes mes habitudes et j’ai besoin de temps libre en excédent pour m’organiser un tant soit peu dans ce jour particulier.
Kafka, Journaux, traduction Robert Kahn, NOUS, 2020, p. 257.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journaux, dimanche, habitude | ![]() Facebook |
Facebook |
27/01/2021
Franz Kafka, Journal

« La fraîcheur avec laquelle aujourd’hui, après une répartition
de l’emploi du temps de la journée un peu modifiée, je suis sorti
dans la rue. Observation ridicule, quand vais-je éliminer cela. »
Kafka, Journal, traduction Robert Kahn, NOUS, 2020, p. 532.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journal, traduction robert kahn | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2020
Kafka, Journaux : recension
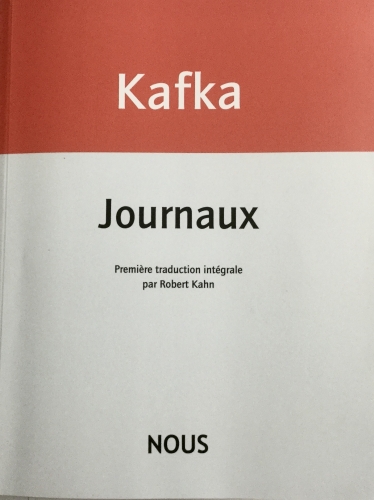
Robert Kahn, disparu le 6 avril, avait traduit pour le même éditeur À Milena(2015) et Derniers cahiers (2017). Le lecteur avait découvert sous le titre Journal, en 1954, la traduction de Marthe Robert*, du texte établi et expurgé par Max Brod, mais traduction faite aussi pour certains fragments en partant de l’édition anglaise. Robert Kahn a tenu compte de tous les textes contenus dans les cahiers, traduisant à partir de l’édition critique allemande qui reproduit les manuscrits de Kafka ; il n’a donc pas exclu les ensembles narratifs, achevés ou non, mêlés au texte autobiographique — ne serait-ce que pour mieux comprendre les commentaires qu’en fait parfois Kafka à leur suite. Par ailleurs, de nouvelles études ont conduit à modifier la chronologie. Enfin, un autre regard était aussi nécessaire pour restituer le style de Kafka, qui ne songeait pas du tout à ce que ces écrits soient un jour publiés.
C’est là un aspect important qui apparaît à la lecture des Journaux. Souvent — et surtout quand un "journal" est publié du vivant de son auteur (sous ce titre ou non) — le lecteur a longtemps eu devant lui un écrit nettoyé, qui ne pouvait choquer au regard des normes sociales en vigueur : on pense par exemple au Journal de Jules Renard revu et corrigé par son épouse avant publication. Les Journaux de Kafka regorgent de phrases inachevées (« Par la fenêtre du coupé »), de phrases elliptiques qui n’ont de sens que pour leur auteur, de notations parfois acides à propos de ses amis, tel Max Brod dont Kafka regrette la « mesquinerie de comptable », se promettant d’ouvrir « un cahier spécial sur [s]es rapports avec Max ». Kafka ne distinguait pas ce qui concernait sa vie intime, sociale, et les fictions qu’il écrivait dans ses cahiers : ils étaient un lieu d’essai et on y lit des débuts de nouvelles, parfois repris, prolongés et abandonnés, ou écrits d’un seul jet comme Le Verdict : « dans la nuit du 22 au 23 [septembre 1912] ». C’est alors un moment heureux, où il éprouve, écrit-il, « terrible tension et joie (...) comme si je fendais les flots ». Il commente d’ailleurs de temps à autre ce que représente pour lui ce que sont ces cahiers.
Le Journal contient une partie des matériaux qui pourraient conduire à rédiger une autobiographie, ce qui « serait une grande joie », mais ce projet à peine évoqué n’a jamais eu de suite. Surtout, s’assujettir à écrire régulièrement dans un cahier est un pis-aller nécessaire quand il ne peut travailler à une autre forme d’écriture (« Je n’abandonnerai plus le Journal. Je dois me tenir fermement ici, car je ne peux qu’ici », 10/12/1910). L’écrit a alors une fonction de repère ; il est relu pour des raisons pratiques : des extraits sont choisis pour être lus à Max Brod, tout en sachant qu’ils n’ont pas de « valeur particulière », d’autres « dans le but précis de [s]e faciliter le sommeil ». Il est relu aussi plusieurs fois pour retrouver des moments du passé et des allusions sont faites à un « vieux carnet de notes », à de « vieux papiers », ou encore parce qu’il peut en tirer « une sorte d’intuition quant à l’organisation » de sa vie. Mais dans les moments de dépression, une notation à propos de son emploi du temps lui apparaît une « observation ridicule » et, au sanatorium à la fin de l’été 1913, il n’a « même plus envie d’écrire un Journal » tant cette pratique accroît sa « tristesse. »
L’état d’abattement bien réel que connaît Kafka n’est pas constant, il est d’abord provoqué par le regard qu’il porte sur son corps. Dans les premières pages du premier cahier (1910), il rapporte que s’il trouve agréable de se toucher les oreilles, il note aussitôt « le désespoir que me causent mon corps et l’avenir avec ce corps ». Les remarques négatives abondent pour qualifier ce corps, les moins acides le voient « provenant d’un débarras » ou comme « un tas de paille ». C’est un corps malade, atteint de la tuberculose, un corps aussi qui n’est pas du tout à l’aise sexuellement : ce n’est pas hasard si, par exemple, décrivant un acteur, il insiste sur sa « puissance sexuelle », s’il décrit le viol de la jeune servante d’une auberge par un "il" qui pourrait lui ressembler. C’est également un corps qui ne trouve que rarement le sommeil, souvent plusieurs jours de suite. On ne relève qu’une seule remarque positive, il a « cessé d’avoir honte » de son corps, au moins quelque temps, quand il a fréquenté les piscines. Ce fort rejet a évidemment des conséquences dans ses relations, très complexes, avec les femmes, question qui demanderait à être suivie dans les Journaux. Kafka balance entre les amours sans lendemain et le mariage ; à propos de prostituées vues dans une rue, il écrit, « Passer près d’elles m’excite, cette possibilité lointaine, mais toujours présente, d’aller avec l’une d’elles » ; à l’inverse, après quelques jours à Marienbad avec Felice, qu’il connaît depuis cinq ans, le ton est négatif : il n’a pas supporté la vie commune et résume elliptiquement : « Nuit malheureuse. Impossibilité de vivre avec F. Vie en commun insupportable avec quiconque ». Il lui arrive de s’exalter à l’idée d’être amoureux (« que ne ferais-je ») tout en avouant ailleurs qu’il comprend l’amour « à peu près autant que la musique » — donc, pas du tout.
Un regard apaisé sur lui-même existe cependant lorsqu’il lit ce qui le passionne (par exemple Gœthe ou des ouvrages sur l’histoire du judaïsme), fréquente le théâtre, et notamment les troupes juives, assiste à des conférences qui l’intéressent : après l’une de Richepin, il note « Je ne pensai pas à mes souffrances et à mes soucis. » Ce qui est destructeur et qui agit sur son corps, c’est l’impossibilité d’écrire comme il le voudrait, ce qu’il affirme à l’ouverture du premier cahier (« mon incapacité à écrire »), opposant « la vraie vie », c’est-à-dire « un travail littéraire » à son poste au bureau. Au cours des années, il a relevé les moments où il est incapable d’écrire, d’où le sentiment de perte de soi, « le vide, l’absence de sens, la faiblesse » (3 mai 1915). Par ailleurs, il analyse avec acuité en quoi l’écriture peut lui permettre, écrit-il, « d’extirper complètement de moi tout mon état de peur et, de même qu’il vient des profondeurs, de le déverser dans la profondeur du papier » et, plus avant, précise qu’il faut « s’abandonner à l’inconscient, qu’on croit lointain, alors que précisément on s’y brûle ». Cette clairvoyance ne suffit malheureusement pas pour trouver un équilibre et les dernières pages des Journaux sont à cet égard un exemple de lucidité ; conscient de la destruction progressive de lui-même, Kafka songe à l’enfance perdue, « appel de la vie », à son effondrement (« incapable de tout sauf d’avoir mal » 12/06/1923), mais un peu plus tôt (27/01/1922) rappelle ce que peut être l’écriture : « Consolation de l’écriture : étrange, mystérieuse, peut-être dangereuse, peut-être libératrice. » C’est peut-être la certitude de ne pas surmonter son sentiment de vide qui, progressivement, conduit Kafka à abandonner le Journal ; aux notations suivies et abondantes de 1910 à 1915 succède leur raréfaction : on passe du 29 février 1920 au 15 octobre 1921, et l’année 1923, la dernière, ne compte que trois mentions. Parallèlement, plusieurs textes paraissent entre 1913 et 1922, dont La Métamorphose, La colonie pénitentiaire, Un champion de jeûne.
Il est d’autres aspects de la vie de Kafka, lisibles dans son Journal, que l’on pourrait reconstituer : son intense activité de lecteur, sa fréquentation du théâtre juif, des acteurs et du yiddish, ses réunions fréquentes avec un cercle d’amis, son intérêt constant pour la Palestine — il ne faut pas oublier, aujourd’hui, que des communautés juives y étaient installées et que Tel-Aviv a été fondé en 1909. Les notes (650 à propos des Journaux) sont indispensables pour comprendre l’importante vie intellectuelle de Kafka et de la communauté juive de Prague, mais pas seulement, c’est toute une époque de la culture allemande qu’évoquent les dizaines de titres d’œuvres, de noms de personnes et de lieux. Robert Kahn, pour la quatrième de couverture, présente les Journaux comme « le cœur de l’œuvre de Kafka : le lieu où les frontières entre la vie et l’œuvre s’évanouissent ». Ne serait-ce que pour cette raison, leur lecture est passionnante.
* Cette traduction a été reprise en édition de poche. Sous le titre Journal intime, Pierre Klossowski avait traduit (1945) des fragments des cahiers tenus par Kafka.
Kafka, Journaux, première traduction intégrale par Robert Kahn, éditions NOUS, 2020, 848 p., 35 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 4 mai 2020.
Publié dans Kafka Franz, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journaux, première, robert kahn | ![]() Facebook |
Facebook |





