13/02/2021
Julien Gracq, Nœuds de vie

(...)Le sentier herbeux qui se glisse le long de le Loire entre deux jardinets d’un côté, et de l’autre la rangée de frênes et de saules de la berge, ouvre entre fleuve et jardins une promenade couverte, un bout de monde à la fois scintillant et fleuri qui semble fait pour protéger et cacher dans chaque maison autant de bonheurs domestiques tapis entre rosiers et haricots. Dans le plaisir que j’ai éprouvé à me glisser pour la première fois le long de ce sentier humblement enchanté jouait quelque chose du déclic magique que le rêve assez souvent procure, mais aussi quelquefois lorsque, par une porte clandestine, par un passage caché, un lieu attirant et familier débouche soudain pour nous sur un autre, insoupçonné, et plus attirant encore. Comme si dans ce passage, un peu miraculeux à la quintessence, si soudain et si aisé, une capacité de profusion, d’excès dans le don se révélait à nous, qui nous laisse à la fois souriants d’aise et presque incrédules, comme lorsque dans le château enchanté des contes, la salle à manger où le chevaucheur épuisé trouve devant lui la table toute servie, se révèle n’être en fait que l’antichambre de la salle aux trésors.
Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, passage, conte de fées, magie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2021
Ezra Pound, Cathay : recension
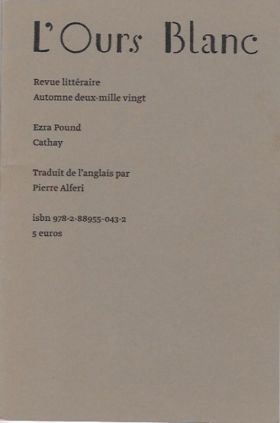
Il est bon de rappeler que "L’Ours Blanc", revue sans parution régulière (qui doit son nom à un vers de Valère Novarina), propose dans chaque livraison un seul texte, traduction (Charles Reznikoff, Jack Spicer, Russell Edson, etc.) ou non (Fabienne Raphoz, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes, etc.). Le numéro 27 a paru en même temps que la traduction de Pound, Ombres blanches sur fond presque blanc, de Baptiste Gaillard, écrivain de Suisse romande. Cathay rassemblait, en 1915, les traductions par Pound de poèmes du poète chinois Rihaku (transcription du nom en japonais) ou Li Bai (701-762), de l’époque Tang. Pound pensait qu’il fallait ne pas rester coincé dans sa langue et lire d’autres langues, traduire aussi, plaçant l’activité du traducteur au même niveau que l’écriture de poèmes — ce qui est aussi la position d’Alferi. Il reçut en 1913 de sa veuve les carnets d’Ernest Fenollosa qui avait transcrit et traduit littéralement des poètes de la poésie classique chinoise ; sans rien connaître de la langue, Pound travailla à partir de ces notes pour donner une version anglaise, faisant de Rihaku/Li Bai « un précurseur de Make it New, ce modernisme qui prend le contre-pied de l’avant-garde et parie sur le renouvellement de la tradition » (A. Lang). L’édition de L’Ours Blanc reproduit dans sa page titre la disposition de la première édition de Cathay que le lecteur retrouvera aisément par l’internet de Cathay, fort utile si l’on est angliciste pour apprécier les choix d’Alferi*.
Les poèmes de Rihaku sont ancrés dans son temps : on y lit des noms de lieux et de personnages (So-Kin), des allusions (« l’Empereur est à Ko »), des comportements (« À quatorze ans j’ai épousé mon Seigneur »...) ») qui reportent à une époque et à des faits bien étrangers au lecteur d’aujourd’hui. Ce n’est pas l’essentiel, toute poésie ou prose ancienne sur ces points reste peu lisible — sinon comment regarder une pièce d’Euripide ou de Shakespeare ? —, ce qui importe est que « cette distance nous donne avec une immédiateté d’autant plus fulgurante les sentiments les plus communs à l’humanité : la faim et le froid, l’espoir et le désespoir, le désir et l’attente » (A. Lang). Ce sont notamment les difficultés de la vie pendant les troubles et guerres de son époque que Rihaku restitue, « Un déferlement d’hommes de guerre sur tout le royaume du milieu, / ( ...) Et la peine, la peine comme la pluie, / La peine à partir, et la peine, la peine à revenir, / Les champs désolés, désolés / ». Et la restitution n’est jamais simple récit dans la traduction d’Alferi traduisant Pound.
La syntaxe du français oblige à plus de liens qu’en anglais, ce qui peut gêner la simplicité recherchée dans l’expression et surtout briser le rythme des vers ; Alferi, dans le premier poème traduit de Kutsugen (IVe s avant J._C.), choisissant une construction elliptique, supprime pronom et verbe présents dans le texte de Pound :
« Sorrowful minds, sorrow is strong, we are hungry and thirsty, /»
est traduit par
« Âmes attristées, la tristesse est âpre, et la faim, la soif, / »
Dans "Lettre d’un exilé" de Rihaku, la forme du récit fait par l’exilé à un ami est remarquable : dans la traduction de Pound comme dans celle d’Alferi, absence de tout apprêt, vocabulaire et syntaxe sans détours qui font penser aux choix des poèmes objectivistes des années 1930 aux États-Unis : « (...) Le plaisir continu, avec des courtisanes allant et venant sans obstacle. / Avec les flocons qui tombaient des saules comme de la neige, / Et les filles fardées soûles au crépuscule, / ». L’exilé n’obtenant pas de promotion à la cour, doit repartir dans la montagne, c’est-à-dire loin des chansons, loin des échanges, et le lecteur notera le vif de sa réponse à l’ami qui demande comment vivre l’exil : après l’image qui associe à la nature le sentiment de regret éprouvé (« Comme la chute des fleurs à la fin du Printemps / Confuse, tourbillonnante »), deux vers fortement coupés (6/6, 6/5) expriment dans la traduction d’Alferi l’inutilité de toute plainte :
À quoi sert de parler, parler n’a pas de fin,
Il n’y a pas de fin aux choses du cœur.
Ailleurs, dans une énumération, Pound coordonne dans chacun des cinq vers deux groupes, « To high halls and curious food, / To the perfume air and girls dancing [etc.] » ; Alferi construit un autre rythme en supprimant le lien, « Vers les salons vastes, les mets curieux, / vers l’air embaumé, les filles qui dansent » ; dans le vers conclusif de la séquence, c’est le verbe qui est abandonné : « Night and day are given to pleasure » est traduit par « Jour et nuit dédiés au plaisir ».
Alferi suit fidèlement la traduction de Pound, mais construit par de légers décalages un rythme propre au français. Il s’agit bien d’un travail de re-création, pour qui a déjà traduit John Donne à côté de contemporains comme Cole Swensen, J. H. Prynne ou Zukofsky.
Ezra Pound, Cathay, traduction Pierre Alferi, "L’Ours Blanc", n°28, Héros-Limite, automne 2020, 28 p., 5 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 12 janvier 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, cathay, traduction pierre alferi, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2021
Julien Gracq, Nœuds de vie

La terreur des âges obscurs revient. C’est la terreur non plus des forces démoniaques, mais de l’État vampire, de la puissance politique à tout jamais déshumanisée « comme un œil de veau dans la nuit », des œillères sur les paupières, un gourdin à la main, une sébile de l’autre, sorte d’ogre obscène et terrifiant qui titube au milieu d’un immense troupeau d’hommes nus. — Nus comme ils ne l’ont jamais été en face de lui. Nus et seuls, car liés seulement par des liens politiques : syndicats, partis — empêtrés dans des surgeons d’État qui prolifèrent. Et entre lesquels le choix qui leur est laissé finalement importe peu.
Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, terreur, état, politique | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2021
Julien Gracq, Nœuds de vie

Pourquoi ne pas avouer que la poésie connaît aussi auprès de ses lecteurs les plus fervents ses fiascos — ces moments de parfaite atonie où elle glisse sans plus y mordre à la surface de l’esprit désensibilisé, où les vers les plus aimés viennent heurter à la porte de la mémoire sans que s’allume une étincelle, où le doigt, sans que s’éveille un fourmillement, touche le fil soudain inexplicablement déconnecté ? Pourquoi ne pas avouer que la poésie la plus enchanteresse, la plus certaine de son pouvoir, ne met en train ses amants... qu’une fois de temps en temps ?
Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, poésie, atonie, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2021
Julien Gracq, Nœuds de vie

Tout comme le récitatif mozartien (Don Juan par exemple) qui est l’introduction avouée d’un tissu conjonctif entre les vifs moments (les arias) marque dans l’opéra une tentative pour décaler deux niveaux de présence plus ou moins intime de la musique, le dialogue (apparu, semble-t-il, plus tard dans le roman que le récitatif dans le théâtre lyrique) a introduit dans la fiction le problème longtemps inédit du style parlé ! Mais, dans « style parlé », il y a d’abord « style » ; les dialogues de Flaubert n’ont rien de commun avec ceux de Stendhal, ni ceux de Morand, avec ceux de Giraudoux. Dans une œuvre d’art, il n’y a pas à proprement parler de parties, ni de modes d’expression distincts, parce que le tout les infuse et inhibe entièrement. Mais dans la parlerie décousue du lit, de la table et de la rue, il n’y a pas de parties, parce qu’il n’y a pas de tout.
Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 160-161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, récitatif, fiction, dialogue, roman | ![]() Facebook |
Facebook |
08/02/2021
Michel Leiris, Marcel Jouhandeau, Correspondance, 1923-1977
Michel Leiris à Marcel Jouhandeau
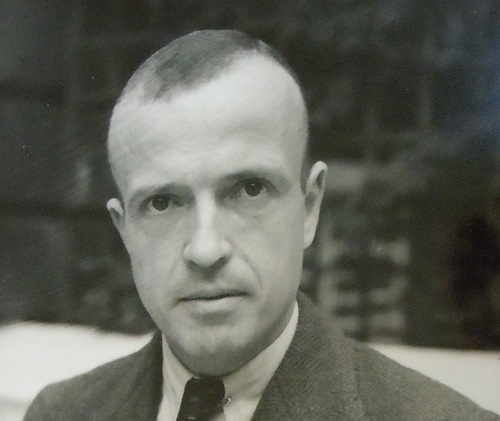
[Beni-Ounif] Dimanche 10 mars [1940]
En ce qui concerne les gens, j’ai eu la chance inouïe — de par la nature même de la formation dont je fais partie — de me trouver en contact avec la foule la plus diverse qui se puisse imaginer : métropolitains, Africains du Nord, gens de toutes régions, de toutes classes, de toutes armes, de tous métiers. Ce que j’ai perçu clairement, c’est que ce qui fait la qualité humaine d’un individu (c’est-à-dire ce qu’il peut y avoir de séduisant, d’émouvant, de respectable) est tout à fait indépendant de sa position sociale, de ses croyances, de ses opinions. Pour m’exprimer dans un autre langage : il y a en chacun quelque chose qui lui est essentiel — une sorte de « part de Dieu » —, radicalement distinct de ce qu’il représente sur le plan des choses purement humaines.
Michel Leiris, Marcel Jouhandeau, Correspondance 1923-1977, éditions Denis Hollier et Louis Yvert, Les cahiers de la nrf, Gallimard, 2021, p. 157.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, marcel jouhandeau, correspondance 1923-1977, position sociale, foule | ![]() Facebook |
Facebook |
07/02/2021
Catherine Pozzi, Paul Valéry, La flamme et la cendre, Correspondance
À Catherine Pozzi
Paris, vendredi 25 février 1921

(...) Tu comprends, mon petit nigaud, que je t’aime comme sœur et comme femme et comme Psyché et comme Éros, comme infiniment intime, et je ne puis rien ôter de ton adorable collier. Je ne peux pas briser le fil qui retient les perles. La rareté incomparable du joyau vient de cette réunion. Une perle considérée me jette à l’autre, et d’orients en orients je te parcours indéfiniment. C’est t’aimer chérie trop complète trop nécessaire trop fermée autour de L.
Donnez-moi mon souci quotidien. N’est-ce pas mon petit et de quoi voulez-vous que je vive ? Je ne pense pas que tu comprennes ce besoin impossible qui tout à coup après une nuit et un demi-jour de peine tendre et sombre, se soulève et me brise contre moi-même car c’est moi aussi qui suis obstacle à moi vers toi, puisque si j’étais autre, peut-être il n’y aurait pas d’obstacle.
Catherine Pozzi, Paul Valéry, La flamme et la cendre, Correspondance, édition Lawrence Joseph, Gallimard, 2006, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, paul valéry, correspondance, aimer, lettre, la flamme et la cendre | ![]() Facebook |
Facebook |
06/02/2021
Honoré de Balzac, Correspondance

À Helmina de Chézy,
Paris, vers le 10 octobre 1833
Je serais bien ingrat, Madame, si je ne répondais à votre aimable lettre ; mon dieu, je désirerais bien avoir l’honneur et le plaisir de vous voir, les âmes nobles sont si rares, qu’il faut se serrer en faisceau, quand on les rencontre et tâcher de les retenir dans la sphère où l’on vit, même quand on est loin d’elles ; mais en ce moment, je plie comme toujours sous mon fardeau de pensées, sous les obligations que je me suis imprudemment faites — Quand vous voyez une pauvre bête prise par la patte, vous allez à elle, mais quand l’animal est un homme, comme ses liens sont moraux, sa cage, une idée, il est difficile d’être pris de la pitié physique qui vous saisit à l’aspect de l’autre.
Honoré de Balzac, Correspondance, I (1809-1835), Pléiade/Gallimard, 2006, p. 870.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : honoré de balzac, correspondance, ingratitude, lien | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2021
Jonathan Swift, Correspondance avec le Scriblerus Club

À Alexander Pope,
Dublin, 20 septembre 1723
(...) J’ai souvent tenté d’établir une amitié entre les hommes de génie, et j’aimerais tellement que cela soit fait. Il y en a rarement plus de trois ou quatre dans une époque, et s’ils pouvaient être unis, ils chasseraient le monde devant eux. Je pense qu’il en était ainsi entre les poètes du temps d’Auguste, mais l’envie, l’esprit de partie et l’orgueil l’ont empêché parmi nous. Je compte pour rien les subalternes, desquels on est rarement sans avoir une vaste tribu, sous les noms de poètes et d’auteurs ; ceux-là même, je suppose, que vous dites vous accommoder de voir quelquefois lorsqu’ils se trouvent être modestes ; ce qui n’était pas fréquent parmi eux quand j’étais dans le monde.
Jonathan Swift, Correspondance avec le Scriblerus Club, traduction David Bosc, Allia, 2005, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jonathan swift, correspondance avec le scriblerus club, amitié, génie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2021
Paul Claudel, Lettres à Ysé

Légation de France au Brésil
Rio de Janeiro, 4 août 1917
(...) Chère R. il est parfaitement vrai que pendant plusieurs mois j’ai été complètement fou, mais je sais aussi qu’aucune femme au monde n’a été /aimée/ par un homme comme vous l’avez été par moi. Ce sentiment ne s’est jamais éteint dans mon cœur, vous êtes la seule femme que j’aie jamais aimée, celle vers qui mes pensées et mes rêves ne cessent de revenir, et il me semble que rien et la mort elle-même ne pourra jamais étouffer le mouvement profond, impétueux, irrésistible, qui entraînait mon être vers le vôtre. Dans mes pires heures de torture, je n’ai jamais eu qu’une seule et véritable souffrance, c’était la pensée que vous aviez cessé de m’aimer. Cette idée me perçait le cœur et elle était à peine soutenable pour moi.
Paul Claudel, Lettres à Ysé, Gallimard, 2017, p. 112-113.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul, CORRESPONDANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, lettres à ysé, femme, fou, souffrance | ![]() Facebook |
Facebook |
03/02/2021
Josseph Joubert, Correspondance générale

À Chateaubriand, septembre 1819
-
-
- Maillet-Lacoste, vrai métromane en prose et en vers et qui est l’homme du monde le plus capable de bien écrire s’il ne voulait pas écrire trop bien et s’il pouvait quelquefois s’occuper d’autre chose que de ce qu’il écrit ; M. Maillet-Lacoste, qui sera jeune jusqu’à cent ans et qui est le meilleur, le plus sensé, le plus honnête, le plus incorruptible et le plus naïf de tous les jeunes gens de tout âge, mais qui donne, par ses manières, un air de théâtre à sa candeur même, parce que sa chevelure hérissée, ses attitudes et le son même de sa voix se ressentent des habitudes qu’il a prises sur le trépied où il est sans cesse monté, quand il est seul, et d’où il ne descend guère, quand il ne l’est pas ; M. Maillet, à qui il ne manque que de la paresse, du relâche et de la détente de tête pour travailler admirablement et avec facilité et qui a travaillé avec autant d’éloquence que de courage, il y a vingt ans, contre la tyrannie du temps, comme l’attestent des opuscules que je vous ai remis, il y a dix ans, un exemplaire qui vous aurait fait connaître son mérite moral, politique et littéraire, si vous l’aviez lu, et que vous n’avez pas lu, parce que, occupé comme vous l’êtes, vous ne lisez rien, et je crois que vous faites bien, par une exception et une prérogative qui n’appartiennent qu’à vous ; (...) M. Maillet qui, avec les plus hautes, mais les plus innocentes prétentions, met à ses fonctions absurdes de professeur autant d’importance que s’il n’était qu’un sot et qui en remplit tous les devoirs avec la conscience et le dévouement d’un Rollin ; M. Maillet, qui excelle à tout enseigner, qui enseigne tout ce qu’on veut, depuis le rudiment jusqu’à l’arithmétique, en passant par tous les degrés intermédiaires, humanités, rhétorique et philosophie ; (...)
-
Joseph Joubert, Correspondance générale, III, édition Rémi Tessonneau, Art et arts, William Blake and Co, 1996, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, correspondance générale, chateaubriand, recommandation | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2021
Madame du Deffand, Correspondance avec Voltaire

Voltaire, 9 mai 1764
(...) Quant à la mort, raisonnons un peu, je vous prie : il est très certain qu’on ,ne la sent point, ce n’est point un moment douloureux, elle ressemble au sommeil comme deux gouttes d’eau, ce n’est que l’idée qu’on ne se réveillera plus qui fait de la peine, c’est l’appareil de la mort qui est horrible, c’est la barbarie de l’extrême-onction, c’est la cruauté qu’on a de nous avertir que tout est fini pour nous. À quoi bon venir nous prononcer notre sentence ? Elle s’exécutera bien sans que le notaire et les prêtres s’en mêlent. Il faut avoir fait ses dispositions de bonne heure, et ensuite n’y plus penser du tout. On dit quelquefois d’un homme, il est mort comme un chien, mais vraiment un chien est très heureux de mourir sans tout cet abominable attirail dont on persécute le dernier moment de notre vie. Si on avait un peu de charité pour nous on nous laisserait mourir sans nous en rien dire.
Madame du Deffand, Correspondance avec Voltaire, des femmes, 1987, p. 140.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : madame du deffand, correspondance avec voltaire, mort, chien | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2021
Károly Bari, Incendies oubliés

Soir d’hiver
Les chiens du vent hurlent,
les dents du gel, affolées,
mordent l’échine des prés blancs,
une branche morte gît sous la neige ;
sa poitrine est parcourue
par les soupirs froids des montagnes,
aussi lourds que des coups de massue.
Oh ! une barbe de givre
a aussi poussé aux pins verts !
Nuit crissant de fleurs de glace
immergée dans la blancheur éclatante,
cernés par les forêts les cerfs pleurent,
entre leurs bois frissonne la lune.
Károly Bari, Incendies oubliés, traduction du hongrois Cécile A. Holdban, dans la revue de belles-lettres, 2020, 1-2, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : károly bari, incendies oubliés, soir d'hiver, givre | ![]() Facebook |
Facebook |





