31/12/2020
Vladimir Pozner, Un pays de barbelés : recension
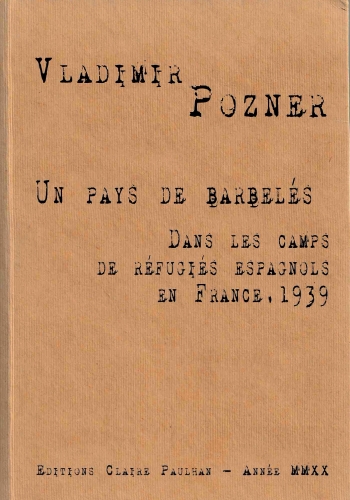
La guerre d’Espagne et la défaite de la République espagnole ont suscité une abondante bibliographie : essais, témoignages, œuvres de fiction ; moins de livres portent sur l’exil des républicains (la Retirada) en France qui a suivi la guerre et, surtout, sur leur enfermement dans des camps — d’abord nommés "camp de concentration", puis "d’hébergement", "d’accueil", enfin "camp" — par un gouvernement du Front populaire débordé et qui craignait la diffusion d’idées considérées "dangereuses". Un pays de barbelés est un document sur ces camps ; la préface présente Vladimir Pozner et précise quel a été son rôle avant de donner à lire ses archives.
Il est en effet indispensable de disposer du contexte pour comprendre ce que furent les camps de réfugiés. Vladimir Pozner (1905-1992), né à Paris de parents qui avaient fui la Russie tsariste, était cependant retourné à Moscou et avait connu la Révolution de 1917 ; poète, il a alors fréquenté le milieu littéraire russe et, de retour à Paris dans les années 1920, il a traduit par exemple Victor Chklovski. Devenu journaliste et écrivain, il a publié dans les revues littéraires de l’entre-deux guerres et dans la presse de gauche ; après l’accession de Hitler au pouvoir, il a aidé les réfugiés antifascistes allemands au sein de l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, proche du Parti communiste fondée en 1932 et dirigée par Paul Vaillant-Couturier ; il est devenu secrétaire de rédaction de Commune, revue de l’association.
C’est en février 1939 qu’un Comité d’accueil aux intellectuels espagnols est formé, présidé par Renaud de Jouvenel ; Aragon, par le biais du journal communiste Ce soir, qu’il dirige avec Jean Richard-Bloch, a lancé un appel international aux dons après avoir constaté l’état de dénuement des réfugiés dans les camps : l’argent était indispensable puisqu’un réfugié ne pouvait sortir d’un camp qu’avec un « permis spécial » payé 2000 francs. Jean Cassou écrivait dans Ce soir le 20 juin 1939, « En aidant les intellectuels espagnols à vivre, c’est nous-mêmes que nous défendons, c’est le meilleur de notre histoire que nous réhabilitons » — allusion transparente au fait que le gouvernement français n’avait rien fait contre l’attaque de la République espagnole par l’armée franquiste et que, selon les mots de Pozner, il n’offrait aux réfugiés qu’ « un morceau de sol français entouré de barbelés français ».
Vladimir Pozner est arrivé à Perpignan le 23 mars 1939, chargé par le Comité d’accueil de visiter les camps pour tenter d’en faire sortir des intellectuels ; tâche difficile, les autorités n’étant que rarement prêtes à coopérer : Alexis Buffet rapporte dans la préface la diplomatie dont a su faire preuve Pozner. Il analyse également comment « Dans le sillage des Choses vues de Victor Hugo, les notes et descriptions de Pozner construisent une fiction d’instantanéité. Nerveuses, brutes de décoffrage, elles (...) révèlent la réalité des camps ».
Les documents réunis dans le livre sont de plusieurs types : lettre, article de journal, carnet de notes, rapport, photographie. Le premier ensemble est constitué de 16 cartes postales, chacune commentée par Pozner ; ne sont retenus dans les descriptions que quelques détails : bras dans le plâtre fixé avec du fil de fer, un rideau sur les épaules contre le froid, et pour un décor : « Une impasse, une cour, un bout de rue, de toute façon dehors » ; dans un camp sur la plage, des tentes faites de trous dans le sable recouverts de morceaux de bois et l’immense foule des réfugiés espagnols en face des officiers de la garde mobile. Ces brèves notations sont complétées par celles, le plus souvent elles aussi lapidaires, d’un "Carnet de notes" tenu de mars à mai 1939, base des rapports de Pozner sous forme de lettres à Renaud de Jouvenel, de ses articles dans la presse et, plus tard, de Espagne premier amour (1965).
Tout ce qui se rapporte aux réfugiés, observé au cours de ces deux mois, est relevé : de la discussion à propos de la prononciation du latin à la recherche d’un vacher parmi les réfugiés par un éleveur. Pozner voit des réfugiés menottés, il apprend qu’un jeune espagnol est frappé par un policier qui l’accuse d’avoir tué cinquante ( !) prêtres, il recopie les paroles d’une chanson écrite dans le camp de Saint-Cyprien, dont il reproduira dans un article deux strophes qu’il a traduites ; on y lit : « Que je serais heureux / Si je pouvais me reposer /Dans les bras de la France / Et de son Front populaire ». Il décrit ce qui précède le départ pour le Mexique d’un ensemble de réfugiés, l’entassement des femmes et des enfants dans les Haras de Perpignan dans la paille et les parasites, avec
les valises que les gardes mobiles fouilleront une fois de plus, une dernière fois, ces misérables valises en simili, en toile cirée, en papier mâché, ces nœuds de linge sale, de couvertures déchirées, cette chair à poubelles, articles pour chiffonniers, témoins de trois ans de guerre, de l’exode, des camps de concentration que les mobiles fouilleront une fois de plus — pour laisser aux partants un bon souvenir de la France.
Il rencontre dans un ancien hôpital militaire de Perpignan un réfugié menuisier qui passe son temps à réparer ce qui peut l’être avec pour outil un couteau de poche, il n’oublie pas le petit cahier avec des dessins et de courts textes politiques qui circule au camp de Barcarès, il présente le consul mexicain, Fernando Gamboa, dont l’amical Buen viaje, compañeros accompagne ceux qui rejoignent le navire vers le Mexique.
On retrouve l’essentiel des informations du "Carnet de notes" dans les trois rapports, sous forme de lettres, envoyés à son ami Renaud de Jouvenel. On lit aussi d’autres exemples de la violence manifestée vis-à-vis des réfugiés, un chef de cabinet de préfet assurant qu’ « ils sont bien à Bram [camp dans l’Aude], trop bien même, à mon avis, puisqu’ils ne veulent pas retourner en Espagne ». On comprend que Pozner doit être — et il l’est — fin diplomate pour obtenir ce qu’il veut, des listes d’intellectuels espagnols et la possibilité de les sortir des camps. L’indifférence, au mieux, quant au sort de réfugiés est partagée par une partie de la population, si l’on en juge par un article paru dans la presse locale après le déplacement d’un camp : « Les camps, les réfugiés, la troupe, la police donnaient beaucoup d’animation au Roussillon ». Dans le même texte inédit où il a recopié cet extrait, Pozner relate sa visite du camp de Montolieu et l’on devine sa rage quand il écrit : « [Les réfugiés] dormaient sur la paille, mangeaient des lentilles et, après avoir combattu les avions italiens et les tanks allemands, luttaient contre le plus impitoyable des ennemis, la vermine française. » `
Outre une substantielle bibliographie, plusieurs annexes prolongent les textes de Pozner : les plans de travail des réfugiés — enseignements dispensés, conférences, préparation pour le départ au Mexique —, le rapport de Jean Cassou (juin 39) qui insiste notamment sur le fait qu’ « il s’agit d’accueillir une armée vaincue qui s’est battue pour un idéal semblable à celui qu’a toujours défendu la nation française ». De nombreuses illustrations et fac-similés aident à se représenter des situations trop oubliées aujourd’hui. Tout le livre aide aussi à réfléchir sur le sort des immigrés d’aujourd’hui qui tentent de rejoindre ce qu’ils pensent être un lieu d’accueil.
Voilà un livre politique, c’est-à-dire qui concerne les citoyens, à lire et faire lire.
Vladimir Pozner, Un pays de barbelés, édition établie et préfacée par Alexis Buffet, éditions Claire Paulhan, 2020, 288 p., 33 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 27 novembre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir pozner, un pays de barbelés : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2020
Georges Perros, Poèmes bleus

Entre nous
Alors quoi de neuf cher ami ?
Ça va ça va ça va merci.
Et le prochain livre il s’annonce
Bien ? Non ? — Maizoui, maizoui, maizoui.
J’ai relu par temps clair, le tome
Premier de l’œuvre de cet homme,
Ah son nom dites-moi son nom
Ma mémoire est comme un poisson
Elle saute vole et replonge
Allez-y voir. Mais quand j’y songe
Vous écrivez. C’était fort bien
Votre article, oh pas moins que rien.
Vous donnez là votre mesure
On s’entend mieux quand on rassure
L’amour-propre de son prochain
À bientôt cher ami machin
Mais les noms vraiment je m’y perds
Bast rien ne sert à rien. J’espère
Que nous reverrons bientôt
Botzaris 22-cigalo...
La solitude est éphémère
Comme le coq de ce clocher
Elle s’en va s’en vient. Ma mère
Aurait dû me laisser plié
Dans son ventre. J’aurais poussé
Jusqu’à ne plus me reconnaître
Elle non plus. C’en est assez
Pour aujourd’hui. À d’main peut-être.
Gorges Perros, Poèmes bleus, Le Chemin /
Gallimard, 1962, p. 100-101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gorges perros, poèmes bleus, nom | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2020
Serguei Essenine, Journal d'un poète

Caravelles-haridelles
I
Si le loup hurle à l’étoile, c’est
que les mers ont englouti le ciel.
Haridelles éventrées,
noires voilures des corbeaux.
Des hoquets nauséabonds du blizzard
l’azur ne sortira pas ses serres ; il plane
sur un jardin de crânes jonché d’aiguilles d’or,
sous le hennissement des tempêtes.
Entendez-vous ? entendez-vous ce cliquetis ?
Ce sont les râteaux de l’aube dans les bosquets.
Avec des rames de mains coupées
vous souquez vers le futur.
Voguez, voguez vers les hauteurs !
De l’arc-en-ciel craillez corneilles !
L’heure vient où la feuillée jaune de ma tête
va se muer en arbre blanc.
(...)
Serguei Essenine, Journal d’un poète, traduction
Christiane Pighetti, éditions de la Différence,
2014, p. 183.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serguei essenine, journal d’un poète, caravelles, haridelles, corbeaux | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2020
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À UNE ROSE
Rose, rose-d’amour vannée,
Jamais fanée,
Le rouge-fin est ta couleur,
Ô fausse-fleur !
Feuille où pondent les journalistes
Un fait-divers,
Papier-Joseph, croquis d’artistes :
— Chiffres ou vers —
Cœur de parfum, montant arôme
Qui nous embaume…
Et ferait même avec succès,
Après décès ;
Grise l’amour de ton haleine,
Vapeur malsaine,
Vent de pastille-du-sérail,
Hanté par l’ail !
Ton épingle, épine-postiche,
Chaque nuit fiche
Le hanneton-d’or, ton amant…
Sensitive ouverte, arrosée
De fausses-perles de rosée,
En diamant !
Chaque jour palpite à la colle
De la corolle
Un papillon-coquelicot,
Pur calicot.
Rose-thé !… — Dans le grog, peut-être ! —
Tu dois renaître
Jaune, sous le fard du tampon,
Rose-pompon !
Vénus-Coton, née en pelote,
Un soir-matin,
Parmi l’écume… que culotte
Le clan rapin !
Rose-mousseuse, sur toi pousse
Souvent la mousse
De l’Aï..... Du BOCK plus souvent
— À 30 Cent.
— Un coup-de-soleil de la rampe !
Qui te retrempe ;
Un coup de pouce à ton grand air
Sur fil-de-fer !…
Va, gommeuse et gommée, ô rose
De couperose,
Fleurir les faux-cols et les cœurs,
Gilets vainqueurs !
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
Gladys frères, 1873, p. 47-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, à une rose | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2020
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À MON CHIEN POPE
— GENTLEMAN-DOG FROM NEW-LAND —
mort d’une balle.
Toi : ne pas suivre en domestique,
Ni lécher en fille publique !
— Maître-philosophe cynique :
N’être pas traité comme un chien,
Chien ! tu le veux — et tu fais bien.
— Toi : rester toi ; ne pas connaître
Ton écuelle ni ton maître.
Ne jamais marcher sur les mains,
Chien ! — c’est bon pour les humains.
… Pour l’amour — qu’à cela ne tienne :
Viole des chiens — Gare la Chienne !
Mords — Chien — et nul ne te mordra.
Emporte le morceau — Hurrah ! —
Mais après, ne fais pas la bête ;
S’il faut payer — paye — Et fais tête
Aux fouets qu’on te montrera.
— Pur ton sang ! pur ton chic sauvage !
— Hurler, nager —
Et, si l’on te fait enrager…
Enrage !
Île de Batz. — Octobre.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Gladys frères,
1873, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, chien, domestique | ![]() Facebook |
Facebook |
26/12/2020
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

MIRLITON
Dors d’amour, méchant ferreur de cigales !
Dans le chiendent qui te couvrira
La cigale aussi pour toi chantera,
Joyeuse, avec ses petites cymbales.
La rosée aura des pleurs matinales ;
Et le muguet blanc fait un joli drap…
Dors d’amour, méchant ferreur de cigales.
Pleureuses en troupeau passeront les rafales…
La Muse camarde ici posera,
Sur ta bouche noire encore elle aura
Ces rimes qui vont aux moelles des pâles…
Dors d’amour, méchant ferreur de cigales.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
Gladys frères, 1873, p. 336.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, mirliton, cigale | ![]() Facebook |
Facebook |
25/12/2020
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

FÉMININ SINGULIER
Éternel Féminin de l’éternel Jocrisse !
Fais-nous sauter, pantins nous payons les décors !
Nous éclairons la rampe… Et toi, dans la coulisse,
Tu peux faire au pompier le pur don de ton corps.
Fais claquer sur nos dos le fouet de ton caprice,
Couronne tes genoux !… et nos têtes dix-cors ;
Ris ! montre tes dents ! mais… nous avons la police,
Et quelque chose en nous d’eunuque et de recors.
… Ah tu ne comprends pas ?… — Moi non plus — Fais la belle
Tourne : nous sommes soûls ! Et plats : Fais la cruelle !
Cravache ton pacha, ton humble serviteur !…
Après, sache tomber ! — mais tomber avec grâce —
Sur notre sable fin ne laisse pas de trace ! …
— C’est le métier de femme et de gladiateur. —
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Gladys frères,
1873, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, féminin singulier, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
24/12/2020
Sylvia Majerska, Matin sur le soleil

Écume
Tu veux quitter les hommes pour toujours. La vague aussi fuit sur la mer, mais elle y revient à chaque fois. Puis il est des jours où elle n’essaie même plus.
Et la mer, elle, paraît si seule que tu as envie d’appeler tous ceux que tu connais et rire avec eux ne serait-ce que de tes étranges comparaisons.
Si seulement leurs sourires n’étaient pas blancs comme l’écume comme si la mer montrait les dents à quelqu’un.
Sylvia Majerska, Matin sur le soleil, Le Cadran ligné, 2020, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia majerska, matin sur le soleil, écume, vague | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2020
Danielle Collobert, Dire II

la seule chose – recommencer encore – si possible – encore une fois des mots – l’quivalent d’une mort – ou le contraire même – ou peut-être rien
être ici – le calme – épuisant de tension – le monde autour qui ne s’arrête pas – mais pourrait s’arrêter – le souffle qui pourrait s’arrêter maintenant – un instant après l’autre – même égalité plane –même dureté froide – même goût fade et doux – supporter encore d’aller vers d’autres moments pareils – continuer seulement le souffle – la respiration – prolonger le regard – simplement
sans doute – une certaine confusion –auparavant – chaque événement détruit par lui-même – passant d’une chose à l’autre – revenant en arrière – avançant – imprévisible – dans un avenir imaginé – s’acccrochant autour de lui à toutes les rugosités – à tous les angles
Danielle Collobert, Dire II, dans Œuvres I, P. O. L., 2004, p. 211.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, dire ii, confusion | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2020
Danielle Collobert, Dire II

Corps là
noué
noué aux mots
l’étranglement du souffle
perte du sol
pendu
balancement à l’intérieur des mots – trouées –
vide
approche de la folie
peur continuelle de la fuite verticale
les mots en spirale fuyante – aspirée
sans prise
sans arrêt
tremblement
un cri
peur continuelle – absence de mots – gouffre
ouvert – descente – descente
mains accrochées au visage
toucher
corps là
résistance –
entendre encore le souffle – quelquepart
à l’instant savoir – souffle là
à l’écoute du bruit
affolement
tendu pour entendre
tendu pour résister
jusqu’à la limite – l’immobilité
sursaut
cassure
encore sombrer – descendre – ou aspiré au loin
– ou fatigue – désespoir
Danielle Collobert, Dire II, dans Œuvres I, P. O. L., 2004, p. 256-257.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, dire ii, souffle, folie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2020
Virginia Woolf, Journal d'adolescence, 1897-1909

Samedi 13 mai [1905]
Un silence aussi inquiétant signifie— comme je l’ai reconnu précédemment — que ce Journal se dirige vers une mort prématurée. C’est une entreprise impossible : noircir tous les jours une page supplémentaire, alors que j’ai écrit tellement par nécessité, me casse les pieds & ce que je raconte est sans intérêt.
Mercredi 31 mai
Nous allons solennellement renoncer à ce Journal à présent que nous arrivons à la fin du mois & que, par bonheur, ce cahier n’a plus de pages — car elles seraient restées vierges.
Un exercice comme celui-ci n’est concevable que s’il émane d’une volonté & que les mots viennent spontanément. L’écriture directe est un travail — pourquoi, se demande-t-on, s’ infliger pareil châtiment ? Les bienfaits s’annulent. Mais ce genre de réflexion n’a point lieu d’être. Ces quelques 6 mois trouvent ici une espèce de miroir d’eux-mêmes ; de l’image reflétée, on tire un enseignement ou un plaisir.
Virginia Woolf, Journal d’adolescence, 1897-1909, traduction Marie-Ange Dutartre, Stock, 1993, p. 426.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, journal d’adolescence, 1897-1909, écriture, page | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2020
André Frénaud, La Sainte Face

La femme de ma vie
Mon épouse, ma loyale étoffe,
ma salamandre, mon doux pépin,
mon hermine, mon gros gras jardin,
mes fesses, mes vesses, mes paroles,
mon chat où j’enfouis mes besoins,
ma gorge de bergeronnette.
Ma veuve, mon essaim d’helminthes,
mes boules de pain pour mes mains,
pour ma tripe sur tous mes chemins,
mon feu bleu où je cuis ma haine,
ma bouteille, mon cordial de nuit,
le torchon pour essuyer ma vie,
l’eau qui me lave sans me tacher.
Ma brune ou blanche, ma moitié,
nous n’aurions fait qu’une couleur,
un soleil-lune à tout casser,
à tous les deux par tous les temps,
si un jour je t’avais reconnue.
André Frénaud, La Sainte Face, Poésie /
Gallimard, 1985, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, la femme de ma vie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2020
André Frénaud, Haeres

Ce si peu
Ce si peu. La tendresse qui me consolait parfois,
et pour toujours la vie traversière,
les échos précoces et les équipées,
les vains obstacles à la mort et la mort même.
André Frénaud, Haeres, dans Nul ne s’égare,
précédé de H, Poéssie/Gallimard, 2006, p. 177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, haeres, tendresse, écho | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2020
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance 1920-1959 : recension
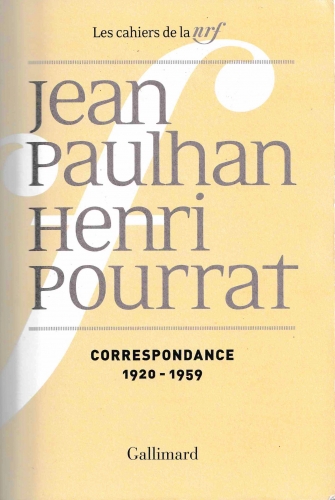
La correspondance commence avec une lettre de Paulhan du 19 avril 1920, demandant à Pourrat une note, pour La NRF, à propos d’un livre de Francis Jammes ; la note est écrite et les deux écrivains s’envoient leurs livres. Paulhan regrette l’éloignement de Pourrat, qui vit à Ambert, et sollicite rapidement une collaboration régulière. Après quelques échanges d’éléments plus personnels — mais les lettres de Pourrat sont absentes jusqu’au 26 septembre —, Paulhan termine sa longue lettre du 15 juin 1920 par « Je suis votre ami » et débute la suivante par « Mon ami », à quoi répond un « Cher ami » suivi, comme ce sera souvent le cas, de nouvelles développées.
Tout semblait séparer les deux hommes, outre l’éloignement géographique : Paulhan (1884-1968) avait un métier, en même temps qu’il assurait le secrétariat de La NRF avant d’en prendre la direction, en 1925, à la mort de Jacques Rivière ; cette fonction lui faisait rencontrer le milieu littéraire, de Gide et Valéry aux surréalistes : il écrivit dans Littérature, la revue d’André Breton. Henri Pourrat (1887-1959), souffrant de la tuberculose, avait dû abandonner sa formation d’agronome et vivre à Ambert ; il publia très tôt des poèmes, collaborait à des journaux régionaux en Auvergne et trouva sa voie avec la publication de Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes en 1921. Les différences ont été mises entre parenthèses et les deux hommes se sont vite découvert des motifs d’échanger.
Pourrat exprime souvent un lien très fort, vivant, à la nature qui l’environne, soucieux d’aménager un potager, de planter des arbres fruitiers, et il écrit à propos des changements dans la montagne au fil des saisons, de la dureté des hivers, des plaisirs simples de la campagne (« Je cueille des champignons rosés dans de jolis prés »). Toute son œuvre est écrite principalement « sur les gens d’Auvergne, leurs coutumes, leurs mœurs », c’est-à-dire à propos du monde paysan dont, en observateur avisé, il observe la mort possible et, écrit-il dès 1928, « Ce pourrait être intéressant (...) ces transformations qu’on a sous les yeux, et [de] se séparer de tout un régionalisme. » Ses descriptions du quotidien, comme ses livres, ont toujours été très favorablement accueillis par Paulhan qui était également un observateur de la nature. Il raconte qu’à Paris une marchande de journaux gardait dans son kiosque une salamandre qu’elle nourrissait de salade, ou que Paul Éluard lui « a apporté un caméléon de Tunisie » ; lui-même élevait des lézards verts, des poissons rouges. Il note qu’au moment de la migration des hirondelles, les plus anciennes s’occupent des plus jeunes et, qu’au mois de juin, son jardin est « pris d’une sorte de folie bien plus animale que végétale, et lance de tous côtés des fleurs et des tiges que l’on reconnaît à peine ». Il serait aisé de multiplier les traces du souci de la nature dans leur correspondance ; en octobre 1937 encore, Pourrat ajoute à la fin d’une lettre, « Hier nous avons vu une si belle monstrueuse salamandre. J’ai pensé à la capturer pour toi. »
Les échanges portent aussi régulièrement sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourrat et Paulhan se font part de leurs problèmes de santé, de ceux de leurs proches : pour le premier, il souffrira beaucoup de la mort de sa fille aînée, âgée de dix ans, en mai 1940, pour le second, il voit l’évolution de la maladie de Germaine, son épouse, qui perd toute sa mobilité. Les rationnements au cours de la guerre ont donné à Pourrat l’occasion d’apporter à Paulhan, alors installé à Paris, une aide efficace en lui expédiant des sacs de charbon de bois pour le chauffage et des vivres, pommes de terre, topinambours et miel. On lit des deux côtés une attention constante à l’autre et les témoignages réciproques d’amitié sont aussi nombreux en ce qui concerne leur travail, chacun tenant l’autre au fait de ce qu’il écrit.
Dès le début de leur relation, en 1920, Pourrat remercie Paulhan d’avoir publié dans La NRF quelques poèmes qui contribuent à le faire connaître ; il ne cessera les décennies suivantes de lui savoir gré de ses lectures attentives et critiques. On peut voir par les remarques de Paulhan ce que pouvait être alors un éditeur ; à propos d’un roman de Pourrat, Le Mauvais garçon, il détaille tout le bien qu’il en pense (délicatesse, justesse, poésie) et, ensuite, précise ce qui lui paraît à reprendre — « Il faut que je te tracasse sur deux ou trois points » —, à alléger ou supprimer dans la première partie, etc. Cet éditeur savait découvrir dans Pourrat autre chose qu’un écrivain "régional", lisant dans un récit un « sentiment d’horreur ou d’effroi (...) qui donne à ton œuvre une raison tragique ». Il ne se posait pas pour autant en supérieur, insistant sur le rôle positif de Pourrat pour lui, «Tu es mon homme libre ; il y a beaucoup de choses que je choisis ou que je juge à partir de toi, ou de ce que je serais si j’étais toi », projetant d’écrire deux romans ensemble lors d’une rencontre, lui demandant son avis quand il publiait un livre ou l’écrivait (« Ça ne t’ennuie pas que je te parle un peu des Fleurs de Tarbes ? »). Pourrat, de son côté, a toujours sollicité et apprécié les remarques et conseils de son ami : « Je pense à toi comme à celui qui m’a donné le sens de la qualité et comme au meilleur des témoins, des juges, des parrains », lui écrit-il, et il a régulièrement commenté les livres de Paulhan dans ses lettres et dans des articles*, très intéressé notamment par l’art du récit.
Pourrat publiait beaucoup (c’était son gagne-pain), en partie aux éditions Gallimard, et il a souvent sollicité l’aide de Paulhan pour régler des problèmes de tirage, de promotion de ses livres, et il était parfois furieux par la désinvolture — le mépris ? — manifesté par certains membres des éditions, comme Brice Parain ; ses lettres reviennent régulièrement sur ces difficultés, accrues par son éloignement de Paris. Paulhan intervient chaque fois qu’il le peut et, par ailleurs, lui donne des nouvelles de la vie de l’édition (en 1931, « Tout va vraiment très mal pour les livres »), des revues. Tous deux échangent à propos des écrivains qu’ils apprécient, Francis Jammes, Cingria, Bove, Ramuz, Joë Bousquet, etc., de Vialatte, que Pourrat a présenté à Paulhan.
Pendant la période de la guerre les confidences se font plus rares. Paulhan s’est engagé très vite dans la résistance, fondant notamment dès 1941 avec Jacques Decour Les Lettres françaises, alors que La NRF était passée sous la direction de Drieu La Rochelle en novembre 1940. Il batailla après la guerre contre les excès de l’épuration, sachant que sa revue, « souillée » sous l’occupation, ne pouvait reparaître — ce sera La Nouvelle Nouvelle Revue française en 1953. Pourrat, de son côté, a d’abord vu dans Pétain celui qui résistait au nazisme ; il recueillit des Juifs dans les années sombres et, plus tard, reconnut qu’il avait été en partie aveugle, « je pense à tout ce que j’aurais dû comprendre mieux auprès de toi ». La maladie gâcha ses dernières années et il voyait la disparition accélérée du monde qu’il avait décrit, « l’homme vient travailler à Ambert pour bénéficier des lois sociales », écrivait-il en 1957.
Ce fort volume est une traversée de quarante ans d’histoire littéraire ; on y découvre l’acharnement de Paulhan pour que sa revue se développe et devienne une référence dans le monde des lettres, l’énorme travail de Pourrat pour restituer la vie et les mœurs d’une région rurale. On y suit également les développements d’une belle amitié.
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance, 1920-1959, édition Claude Dalet et Michel Lioure, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2020, 816 p., 45 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 novembre 2020.
* On lira la liste de ses recensions en appendice et celle des Fleurs de Tarbes reprise intégralement.
Publié dans Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, henri pourrat, correspondance, 1920-1959, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
17/12/2020
Léon-Paul Fargue, Espaces

CHANSON DU PLUS LÉGER QUE LA MORT
À toute vitesse par assises chaudes
Qui se cristallisent dans la hauteur
Nous coupons la fête ! Ce n'est pas Montmartre !
Ce n'est pas en bas
Quand le canon tonne !
Ce n'est pas la guerre
Aux parcs mugissants !
Nous sommes les hommes sans murailles !
Nous montons en chœur dans la musique !
Chacun a sa baraque
Les dieux font la parade
Petits dieux qui racolent
Le feu qui dans l'espace
Mêle les vérités !
Par ici la mystique
Ici la vraie la seule
Le sanhédrin spirite
Le polypier des schismes
La scissiparité
Du concile de Trente
Le pet des manitous
Le pas des cannibales
Les massacres d'idoles
La sang de Coligny !
Par ici les beaux-arts
Le basalte de Bach
Le bûcher de Wagner
Rembrandt et Michel-Ange
La foudre faite chair !
Par ici les penseurs
Les bouteilles des doctrines
Les aludels des systèmes
Les flacons des hypothèses
Les spirochètes d'idées
Qui vont à toute vitesse
Sur l'ardente glace, assez !
Léon-Paul Fargue, Espaces,
Gallimard, 1929, p. 199-200.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, chanson du plus léger que la mort | ![]() Facebook |
Facebook |





