13/07/2012
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie
c'est refuser la vie — partie par partie —
pour l'accepter tout entière —
que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.
La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile
*
Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,
ne se réveille pas —
*
le poème sort avec sa lie
hors de sa gangue d'angoisse
et de toute la boue qui le charrie
*
la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,
de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière
il y a cette révélation de l'insipide
— de cette clarté
qui court en avant d'elle-même
ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité
qui n'est suscité que pour être incinéré
l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.
Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.
Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.
on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle
le vent dont nous sommes affublés
le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —
l'image n'est suscitée que pour être incinérée.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2012
Louis Aragon, Les Poètes

La Tragédie des poètes
La chambre de Don Quichotte
Comme un cheval d'os de poil et de feu sera toujours au cavalier préférable à toute monture fictive
De même à celui qui ne se soucie aucunement de cavalcade et que n'émeut ni la sueur de la robe ni le hennissement
Un cheval de pierre est plus grand là debout sur son socle à tout jamais qui se cabre
Plus enivrant dans cette inutilité de la crinière qui bouge avec la lenteur du soleil
Et cette couleur blafarde aux ombres variables
Que la bête chaude et glacée entre les cuisses de l'homme qui s'envole
La bête à qui le poignet fait mal où la main le retient
Ainsi les mots dans ma bouche sont le cheval de pierre
Et ils sonnent de tous ces grelots mis aux harnais imaginaires
Ils sont le cuir férocement qui arrête l'élan de la pensée
Ils entrent dans la chair de ce que je dis
Et c'est moi qui souffre où la raison me blesse déjà dépassant ce qu'elle permet d'entendre
Déjà mis en sang par la bride et chaque parole n'est plus
Ce qu'elle était mise en branle Elle dit autre chose que ce qu'elle dit
Que ce qu'elle disait Je m'enivre
De l'emploi que je fais des vocables humains et tremble
Je ne sais trop moi-même de quelle profanation commise de quel forfait
Que je signe de quelle dénonciation du langage
Et pourtant quand le caillou roule et m'échappe et tombe et rebondit
Ce n'est point le sens qui meurt mais autre chose qu'il devient
Qu'un autre que moi ne lui aurait point donné licence d'être
Autre chose que ce galop suivant les règles du pavé que cette course
D'ici à là et pas plus loin
Autre chose qu'une liaison de poste avec son horaire et la ville à chaque bout nommée
Autre chose que le cheminement de la pensée autre chose
Que midi forcément à la fin de la matinée
Autre chose autre chose n'en fût-il point d'autre et je m'entends
Moi-même avec étonnement moi-même dans l'écho redoublé des syllabes
Comme celui dans la montagne qui avance le pied sur l'éboulis
Et sent fuir à peine posé toute la terre sous sa semelle en vain prudente
Les mots l'un l'autre qui s'entraînent dans la chute et on ne peut plus rien arrêter
Ni le bond des blocs et leur presse et le déclenchement du vertige
Ni l'énorme suintement de poussière fuyante fine affolée
Ni l'écho sauvage qui répond de falaise en falaise comme une image de miroir en miroir
Et plus rien ne se borne à soi désormais mais tout vocable porte
Au-delà de soi-même une signification de chute une force révélatrice
Où ce que je ne dis pas perce en ce que je dis
Où plus fort est l'entraînement des paroles que le rêve qui les précède
Où je suis emporté comme un fétu de paille sur une mer démontée
Où je suis le jouet qui ne se peut retenir d'une nécessité nouvelle
Nouvellement dans sa marche inventée
Et je n'ai plus maîtrise de ma langue à la fois torrent et ce qu'il roule
Je n'ai plus le choix de ne point proférer ces sons chargés d'ivresse comme le grain d'un raisin noir
Je ne puis faire que je ne les ai point prononcés
Avec toute la violence de l'élocution surhumaine qui me roule me tourne me renverse
Et que vous expliquez bien mal avec ce pauvre mot de poésie
Auquel on en fait voir de toutes les couleurs
[...]
Aragon, Les Poètes, dans Œuvres poétiques complètes, II, édition sous la direction d'Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 357-359.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, les poètes, don quichotte, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
07/07/2012
Jacques Dupin, La mèche

La mèche
Éteinte dans sa tombée
une phrase épanouie
frissonne dans l'aléa
des copeaux qui se dispersent
L'armature du tonneau
se tend à crever la panse
du gueux assoiffé de mots
l'intérieur du vin ouvert
comme un théâtre de consonnes
tangue dans les vertèbres
le hoquet est sublimé
par la secousse de l'air
sous la voûte du cellier
il reste à jeter au feu
les douelles du tonneau
et la griffe du poème
N'ayant rien à dire
étant sous le charme
je partage
l'accablement du murier
couvert de mouches qui parlent
l'idiome
des lointains carbonisés
étant sous le charme
de la vibration d'un peuple
de guêpes
avant de tomber de l'assiette en l'air
sur une lèvre éclatée
Je suis revenu
par le sentier des falaises
tordant le mouchoir heurtant
le caillou
riant sous le manteau pour éparpiller
la parole
avant d'être à la fin le mort dans la lettre
et la lettre dans la mort
[...]
Jacques Dupin, La mèche, dans Europe, "Jacques Dupin", n° 998-999, juin-juillet 2012, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, la mèche, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2012
André Suarès, Sur la vie

Suarès par Georges Rouault
Pensées du temps sans dates
Assurément, la poésie est un art en soi-même, et qui se suffit. De là, les surprises de la forme, les chefs-d'œuvre de l'expression et la beauté du métier : il peut être si fort ou si plaisant qu'on n'y résiste pas ; on cède à la fougue de l'artiste ou à son charme. Mais le métier le plus accompli ne donne pourtant pas cet accès aux sommets de l'âme, où est le lieu naturel de la grande poésie. Le rythme et la mélodie populaires ne sont pas plus la musique de Bach, que le plus savant contrepoint, si la pensée de Bach est absente. Pensée qui trempe toujours dans le sentiment.
Ni le métier seul ni la seule émotion ne font le grand poète. Il faut de la pensée, là comme ailleurs. Il n'est pas vrai qu'une citrouille bien peinte vaille l'École d'Athènes, mais il peut être vrai qu'un faux Raphaël d'Académie ne vaille pas une belle citrouille : c'est que les idées académiques ne sont pas plus vivantes, ni plus fécondes, ni plus propres à nous émouvoir et nous faire penser qu'une citrouille, une pipe au bord d'une table et une demi-guitare. On peut dire aussi de Chardin qu'il est plus peintre que Léonard de Vinci ou Rembrandt parce qu'il n'est que peintre. Rembrandt, Raphaël, Jean Fouquet sont de grands poètes qui s'expriment au moyen des couleurs et des lignes.
André Suarès, Sur la vie, essais, éditions Émile Paul, 1925, p. 287-288.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, sur la vie, poésie, peinture, bach, raphaël | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2012
Georges Bataille, La Littérature et le mal : Baudelaire

La poésie est toujours en un sens un contraire de la poésie (à propos du Baudelaire de Sartre)
[...] Inhérente à la poésie, il existe une obligation de faire une chose figée d'une insatisfaction. La poésie, en un premier mouvement, détruit les objets qu'elle appréhende, elle les rend, par une destruction, à l'insaisissable fluidité de l'existence du poète, et c'est à ce prix qu'elle espère retrouver l'identité du monde et de l'homme. Mais en même temps qu'elle opère un dessaisissement, elle tente de saisir ce dessaisissement. Tout ce qu'elle put fut de substituer le dessaisissement aux choses saisies de la vie réduite : elle ne put faire que le dessaisissement ne prît la place des choses.
Nous éprouvons sur ce plan une difficulté semblable à celle de l'enfant, libre à la condition de nier l'adulte, ne pouvant le faire sans devenir adulte à son tour et sans perdre par là sa liberté. Mais Baudelaire, qui jamais n'assuma les prérogatives des maîtres, et dont la liberté garantit l'inassouvissement jusqu'à la fin, n'en dut pas moins rivaliser avec ces êtres qu'il avait refusé de remplacer. Il est vrai qu'il se chercha, qu'il ne se perdit, qu'il ne s'oublia jamais, et qu'il se regarda regarder ; la récupération de l'être fut bien, comme l'indique Sartre, l'objet de son génie, de sa tension et de son impuissance poétique. Il y a sans nul doute à l'origine de la destinée du poète une certitude d'unicité, d'élection, sans laquelle l'entreprise de réduire le monde à soi-même, ou de se perdre dans le monde, n'aurait pas le sens qu'elle a. Sartre en fait la tare de Baudelaire, résultat de l'isolement où le laissa le second mariage de sa mère. C'est en effet le « sentiment de solitude, dès mon enfance », « de destinée éternellement solitaire », dont le poète lui-même a parlé. Mais Baudelaire a sans doute donné la même révélation de soi dans l'opposition aux autres, disant : « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie ». On ne saurait trop attirer l'attention sur une certitude d'irremplaçable unicité qui est à la base non seulement du génie poétique (où Blake voyait le point commun — par lequel ils sont semblables — de tous les hommes), mais de chaque religion (de chaque Église), et de chaque patrie.
Georges Bataille, La littérature et le mal, "Baudelaire", dans Œuvres complètes, IX, Gallimard, 1955, p. 197-198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, la littérature et le mal, baudelaire, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2012
Yves Bonnefoy, Genève 1993

Il est vrai qu'on peut supposer que quand la voix se fait [...] chant, et que de mot en mot les éléments sonores s'unissent pour une musique et donc un bonheur, c'est peut-être d'abord parce que le désir qui gouverne notre inconscient — et là y écoute les sons autant que le sens, nous le savons et les retient dans sa propre langue — s'est mis à rêver à l'harmonie possible de celle-ci, à imaginer de par le leurre des nombres qu'elle peut s'étendre sans rencontrer résistance à tous les objets qui l'attirent. Des mots musicalisés ne naîtraient alors, et ainsi, que ce que "L'invitation au voyage" appelle « la douce langue natale », celle du pays d'avant la nécessité, du « là-bas » où l'on peut « aimer à loisir ». Et quand Baudelaire, dans un autre de ses poèmes, et d'ailleurs à propos de la musique — celle des instruments, mais qu'il sait parente de son travail sur les mots —, écrit : « La musique souvent me prend comme une mer », après quoi il se dit « bercé », on ne peut certes douter que le son du mot "mer" a fait plus qu'être pour lui, il a signifié — la présence maternelle —, et que c'est partiellement au moins pour cela que ce poète s'est laissé "prendre", "bercer" par la vague de la musique. Ce serait ainsi l'éros qui contrôlerait le son des mots, ce serait encore le moi qui s'exprimerait par sa voix, en bref l'intuition de l'indéfait du monde, de l'unité n'aurait pas survécu au passage du simple mot à la phrase : le désir d'être ayant dû céder le pas à cet autre, l'éros, qui tient en main le langage.
Peut-être. Mais demeure ce fait qu'au moment premier, celui où l'enfant, ou l'adulte, ont pleinement entendu le son d'un mot, y ont perçu l'appel de la réalité indivise, y ont désiré qu'elle fasse toute présence, eh bien, le désir ordinaire, l'éros, aura donc bénéficié, en son moment de reprise, d'un regard sur l'objet moins pauvrement réduit à un signifié, moins de l'abstraction et du réifié, que dans sa pratique antérieure. Il a appris qu'il pouvait y avoir bien plus, dans la rencontre de son objet, que les aspects discontinus, irréels qu'il en connaissait, il en a entrevu une plus grande richesse, au plan cette fois de leur appartenance, non plus aux réseaux du fantasme, mais au réel, à la beauté du réel. Et que la musique des mots soit celle ou non de l'éros ensuite, un peu de l'immédiat s'est maintenu dans le poème — où il va peut-être être médité, être rappelé.
Yves Bonnefoy, Genève 1993, L'Herne, 2010, p. 40-42.
Publié dans Bonnefoy Yves, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, genève 1993, poésie, éros, musique, langue natale | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2012
Aragon, Les Chambres, et : J'appelle poésie cet envers du temps...
Chambres
Un bras autour de toi
Le second sur mes yeux
L'un t'empêche de fuir
L'autre maintient mes songes
Ce lieu fermé de nous
Soudain si je m'éveille
Du sommeil des voleurs
La nuit noire m'y noie
Tout m'est plus que mémoire
À ce moment d'oubli
Dans la forêt du lit
Tout n'est plus que murmure
Et notre tragédie
Au long jeu de dormir
À demi-mots amers
L'obscurité la dit
Absente mon absente
Si faussement que j'ai
Dans mes bras étrangers
Comme une image peinte
Absente mon absente
Si faussement plongée
En mes bras étrangers
Comme une image feinte
J'ai des yeux pour pleurer
Quelle que soit la chambre
Les plafonds s'y ressemblent
Pour être malheureux
Ailleurs sans doute ailleurs
Aussi bien qu'où je suis
Oreille à tous les bruits
Qui braillent le malheur
Au grand vent dans un port
Comme un amant quitté
Au bout de la jetée
Espère et désespère
Et les barques à sec
La grève à marée basse
Et là-bas de mer lasse
Échoués les varechs
[...]
Aragon, Les Chambres, Poème du temps qui ne passe pas,
Éditeurs Français Réunis, 1969, p. 25-27 , repris dans
Œuvres poétiques complètes, II, p. 1097-1098.
 J'appelle poésie cet envers du temps, ces ténèbres aux yeux grands ouverts, ce domaine passionnel où je me perds, ce soleil nocturne, ce chant maudit aussi bien qui se meurt dans ma gorge où sonne à la volée les cloches de provocation... J'appelle poésie cette dénégation du jour, où les mots disent aussi bien le contraire de ce qu'ils disent que la proclamation de l'interdit, l'aventure du sens ou du non-sens, ô paroles d'égarement qui êtes l'autre jour, la lumière noire des siècles, les yeux aveuglés d'en avoir tant vu, les oreilles percées à force d'entendre, les bras brisés d'avoir étreint de fureur ou d'amour le fuyant univers des songes, les fantômes du hasard dans leurs linceuls déchirés, l'imaginaire beauté pareille à l'eau pure des sources perdues...
J'appelle poésie cet envers du temps, ces ténèbres aux yeux grands ouverts, ce domaine passionnel où je me perds, ce soleil nocturne, ce chant maudit aussi bien qui se meurt dans ma gorge où sonne à la volée les cloches de provocation... J'appelle poésie cette dénégation du jour, où les mots disent aussi bien le contraire de ce qu'ils disent que la proclamation de l'interdit, l'aventure du sens ou du non-sens, ô paroles d'égarement qui êtes l'autre jour, la lumière noire des siècles, les yeux aveuglés d'en avoir tant vu, les oreilles percées à force d'entendre, les bras brisés d'avoir étreint de fureur ou d'amour le fuyant univers des songes, les fantômes du hasard dans leurs linceuls déchirés, l'imaginaire beauté pareille à l'eau pure des sources perdues...
J'appelle poésie la peur qui prend ton corps tout entier à l'aube frémissante du jouir... Par exemple.
l'amour l'amour l'amour l'amour l'amour
[...]
Aragon, J'appelle poésie cet envers du temps, dans Œuvres poétiques complètes, II, édition publiée sous la direction d'Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 1407.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, poésie, temps, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2012
Julien Gracq, Carnets du grand chemin
 Étrange siècle, que le dix-huitième. Au moment même où la poésie semble en lui faire définitivement faux bond à l'art des vers, la littérature, elle, se met dans toute la France à rimailler à propos de bottes, de la lettre de château jusqu'à la satire vengeresse, du pamphlet politique jusqu'au traité de jardinage et de sylviculture. Cette métromanie galopante qui au XVIIe siècle obligeait déjà Boileau à suer sang et eau sur ses Satires et ses Épîtres, devient au siècle suivant une vraie épidémie. L'encaisse-or de la poésie volatilisée, l'encaisse-papier circule partout en nourrissant une inflation de mauvais aloi ; là aussi le XVIIIe siècle est bien celui qui commence avec la rue Quincampoix.
Étrange siècle, que le dix-huitième. Au moment même où la poésie semble en lui faire définitivement faux bond à l'art des vers, la littérature, elle, se met dans toute la France à rimailler à propos de bottes, de la lettre de château jusqu'à la satire vengeresse, du pamphlet politique jusqu'au traité de jardinage et de sylviculture. Cette métromanie galopante qui au XVIIe siècle obligeait déjà Boileau à suer sang et eau sur ses Satires et ses Épîtres, devient au siècle suivant une vraie épidémie. L'encaisse-or de la poésie volatilisée, l'encaisse-papier circule partout en nourrissant une inflation de mauvais aloi ; là aussi le XVIIIe siècle est bien celui qui commence avec la rue Quincampoix.
Dans le prestige qui entoure à cette époque les petits vers, le "chant", la musique verbale, atteint à sa teneur la plus faible, et même s'élimine complètement comme élément de valeur, toutes les images sont des clichés (et même surexposés) ; ne reste que la difficulté artificielle imposée par le mètre et la rime : simple exercice d'assouplissement et de musculation abusivement tenu par toute une époque pour la beauté, dont il est un accessoire insignifiant. Une bonne partie de l'œuvre rimée de Voltaire, capable d'écrire une prose si déliée et si acérée, nous fait l'effet de gammes acrobatiques, où la virtuosité du doigté nous reste encore sensible, mais dont on se demande pourquoi on a jugé les notes dignes de s'inscrire sur une portée.
Julien Gracq, Carnets du grand chemin, José Corti, 1992, p. 236-237.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, carnets du grand chemin, xviiième siècle, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2011
René Char, Fenêtres dormantes sur le toit

Le poème sur son revers, femme en besogne à qui les menus objets domestiques sont indispensables. La richesse et la parcimonie.
Avant de se pulvériser, toute chose se prépare et rencontre nos sens. Ce temps de préparatifs est notre chance sans rivale.
Il en faut un, il en faut deux, il en faut... Nul ne possède assez d'ubiquité pour être son contemporain souverain.
Peindre l'intimité par le défaut du fumeux intérieur. Nos yeux filtrants s'y essaient.
La poésie ose dire dans la modestie ce qu'aucune autre voix n'ose confier au sanguinaire Temps. Elle porte aussi secours à l'instinct en perdition. Dans ce mouvement, il advient qu'un mot évidé se retourne dans le vent de la parole.
La grâce d'aller chaque fois plus avant, plus nu en nommant le même objet de demi-jour qui amplement nous figure, c'est à la lettre reprendre vie.
René Char, Fenêtres dormantes et portes sur le toit, Gallimard, 1979, p. 12, 13, 16, 17, 18-19, 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené car, fenêtres dormantes sur le toit, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2011
Louis Zukofsky, Un objectif & deux autres essais, traduction Pierre Alféri
 On a toujours trouvé la poésie plus littéraire que la musique, mais la prétendue musique pure, en tant que communication, peut être littéraire. Les voix d’une fugue, disait Bach, doivent se comporter comme des hommes raisonnables dans une conversation sérieuse. Pourtant, la musique ne dépend pas principalement, comme la poésie, d’une voix humaine qui sache la rendre. Et l’imagination peut dépouiller la parole de tout élément graphique pour qu’elle devienne un pur mouvement sonore. C’est en vertu de cet horizon musical de la poésie (jamais atteint, sans doute, par les poèmes) que n’importe qui peut écouter la poésie d’Homère sans connaître le grec et en tirer quelque chose ; se mettre « sur la même longueur d’onde » que la tradition humaine, que sa voix mûrie parmi les sons de la nature, et ainsi échapper à l’emprise d’une époque et d’un lieu comme on n’a guère de chance d’y échapper en étudiant la grammaire homérique. En ce sens, la poésie est internationale.
On a toujours trouvé la poésie plus littéraire que la musique, mais la prétendue musique pure, en tant que communication, peut être littéraire. Les voix d’une fugue, disait Bach, doivent se comporter comme des hommes raisonnables dans une conversation sérieuse. Pourtant, la musique ne dépend pas principalement, comme la poésie, d’une voix humaine qui sache la rendre. Et l’imagination peut dépouiller la parole de tout élément graphique pour qu’elle devienne un pur mouvement sonore. C’est en vertu de cet horizon musical de la poésie (jamais atteint, sans doute, par les poèmes) que n’importe qui peut écouter la poésie d’Homère sans connaître le grec et en tirer quelque chose ; se mettre « sur la même longueur d’onde » que la tradition humaine, que sa voix mûrie parmi les sons de la nature, et ainsi échapper à l’emprise d’une époque et d’un lieu comme on n’a guère de chance d’y échapper en étudiant la grammaire homérique. En ce sens, la poésie est internationale.
Si quelque chose a un sens, la poésie a le sens de tout. Ce qui veut dire : sans elle, la vie n’aurait guère de présent. Écrire des poèmes ne suffit pas s’ils ne gardent pas la vie enfuie. Écrire des poèmes semble toujours insuffisant quand ils parlent d’une vie enfuie. Le poète peut cesser visiblement d’écrire, mais il se mesure secrètement à chaque mot de poésie jamais écrit. S’il est d’une profondeur constante, il pense, en outre, à ceux qui ont vécu, vivent et vivront pour dire les choses qu’il ne peut dire. Qui fait cela travaille sans cesse et ne craint pas de paraître oisif. L’effort de poésie se reconnaît, tranchant sur la plupart des textes au goût du jour, malgré l’habit et les retards des poètes. La poésie n’a pas tel visage aujourd’hui pour faire mauvaise figure demain. On trahit une pensée bien courte en disant que la poésie s’oppose — parce qu’elle ajoute — à la science. La poésie s’explique sur-le-champ, sauf aux paresseux et aux insensibles.
Louis Zukofsky, Un Objectif & deux autres essais, traduit de l’américain par Pierre Alféri, Un Bureau sur l’Atlantique / Éditions Royaumont, 1989, p. 47-48 et 26-27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis zukofsky, pierre alféri, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2011
Paul Valéry, Littérature (Œuvres II)
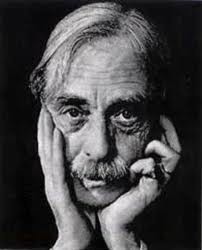
Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.
Dans le poète :
L’oreille parle,
La bouche écoute ;
C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;
C’est le sommeil qui voit clair ;
C’est l’image et le phantasme qui regardent,
C’est le manque et la lacune qui créent.
La poésie n’est que la littérature réduite à l’essentiel de son principe actif. On l’a purgée des idoles de toute espèce et des illusions réalistes ; de l’équivoque possible entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création », etc.
Et ce rôle quasi créateur, fictif du langage — (lui, d’origine pratique et véridique) est rendu le plus évident possible par la fragilité ou par l’arbitraire du sujet.
L’idée d’Inspiration contient celle-ci : Ce qui ne coûte rien est ce qui a le plus de valeur.
Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter.
Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.
Quelle honte d’écrire, sans savoir ce que sont langage, verbe, métaphores, changements d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’ouvrage, ni les conditions de sa fin ; à peine le pourquoi, et pas du tout le comment ! Rougir d’être la Pythie…
Paul Valéry, Littérature, dans Œuvres II, édition établie et annotée par Jean Hytier, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 546, 547, 548 et 550.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, littérature, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/08/2011
Cesare Pavese, Le Métier de vivre
18 octobre [1938]
Décrire la nature en poésie, c’est comme ceux qui décrivent une belle héroïne ou un puissant héros.
10 novembre [1938]
La littérature est une défense contre les offenses de la vie. Elle lui dit : « Tu ne me couillonnes pas ; je sais comment tu te comportes, je te suis et je te prévois, je m’amuse même à te voir faire, et je te vole ton secret en te composant en d’adroites constructions qui arrêtent ton flux. »

16 avril 1940
Il doit être important qu’un jeune homme toujours occupé à étudier, à tourner des pages, à se tirer les yeux, ait fait sa grande poésie sur les moments où il allait sue le balcon, sous le bosquet, sur la colline ou dans un champ tout vert. (Silvia latini, Vie solitaire, Souvenirs) La poésie naît non de l’our life’s work, de la normalité de nos occupations mais des instants où nous levons la tête et où nous découvrons avec stupeur la vie. (La normalité, elle aussi, devient poésie quand elle se fait contemplation, c’est-à-dire quand elle cesse d’être normalité et devient prodige.)
On comprend par là pourquoi l’adolescence est grande matière à poésie. Elle nous apparaît à nous — hommes — comme un instant où nous n’avions pas encore baissé la tête sur nos occupations.
20 février
La poésie est non un sens mais un état, non une compréhension mais un être.
Cesare Pavese, Le Métier de vivre, traduit de l’italien par Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 103, 113, 153, 255.
Publié dans MARGINALIA, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/08/2011
Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers
 Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.
Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.
Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers, Fata Morgana, 1985, p. 9-10.
Publié dans MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, celle qui vien tà pas légers, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2011
René Crevel, Le Clavecin de Diderot
 Pour la France officielle la poésie c’est, avant tout, un jeu, un exercice d’éloquence. Et il ne s’agit même plus de la faconde méridionale. Le soleil, l’ail, l’accent, le mélange de sperme, de coquillage secret et de fruits trop mûrs, dont se trouve naturellement parfumée toute vieille cité phocéenne, voilà qui a été corrigé par la tristesse septentrionale.
Pour la France officielle la poésie c’est, avant tout, un jeu, un exercice d’éloquence. Et il ne s’agit même plus de la faconde méridionale. Le soleil, l’ail, l’accent, le mélange de sperme, de coquillage secret et de fruits trop mûrs, dont se trouve naturellement parfumée toute vieille cité phocéenne, voilà qui a été corrigé par la tristesse septentrionale.
Langue d’oc et langue d’oïl, l’une en l’autre fondue, et, l’Europe a eu sa langue diplomatique. Quant aux autochtones, ils se sont consacrés au culte d’un verbalisme décoloré. De Racine (Andromaque, le fameux discours à Pyrrhus : avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix) à Lamartine (la phrase sur le drapeau tricolore qui a fait le tour du monde et le drapeau rouge qui n’a fait que le tour du champ de Mars), les leçons que reçoivent, de leurs grands ou petits maîtres, à propos de textes rimés, lycéens et étudiants, ne sont que leçons de ruses oratoires.
Quant à la connaissance intime et générale de l’homme, certains ne font profession de lui vouer leurs travaux, leurs existences qu’à seule fin de lui dénier, de l’intérieur, toute chance de progrès.
En vérité, depuis des siècles, on se contente de répéter les mêmes expériences et considérations sur certains réflexes à fleur de peau, avec une volonté d’agnosticisme ou, au moins, le désir de conclure qu’il n’y a rien de changé sous le soleil. Et que se produise, quelque part, ce changement dont ne veulent pas les classes favorisées, elles crieront à la monstruosité. De toute source, il faut, sur le champ, faire une eau de table, et, si le geyser ne veut se laisser mettre en bouteille, qu’on l’écrase des plus lourdes pierres. Ainsi, un égocentrisme à courtes vues décide les individus à l’individualisme, les nations au nationalisme.
René Crevel, Le Clavecin de Diderot, 1932, présentation de Claude Courtot, collection Libertés, n° 38, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1966, p. 51-52.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené creve, le clavecin de diderot, poésie, individualisme | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2011
Henri Kréa, La Révolution et la poésie sont une seule et même chose
Morale de l’histoire

L’heure brisée par le gel de la patience
Une attente mortelle
Les larmes prises par la fatigue
Trop voir ceux que je hais
Pour ma peine victorieuse
Avec toujours au bout la lassitude
Le poing serré
Comme un parjure somnambule
Qui s’égare aux bouches des métros
Je calcule un mal qui se fait centenaire
À quoi rime la vie
Conçue à partir du malheur
À quoi rime ce présent
Où l’assassinat est de règle
J’avoue ma honte d’être vivant
J’oublie ceux qui m’aiment
Ceux qui ne m’aiment plus
Je reste sur l’espace qui nous est coutumier
Je peste contre l’histoire
Et je demeure contemporain
Des caprices des saisons
Des mœurs des intrigues
J’avoue je suis perméable
À tout ce qui tressaille sur ce globe
Et parfois je songe
Qu’il faudrait changer de vie
Changer de mort
Rester de marbre face aux événements
Oui tout ça existe c’est horrible
Mais mon peuple est solide comme un immense plan d’eau
Il me montre le droit chemin
Je lui sais gré de sa bonté
Je le regarde comme un être infini
Qui me tient lieu de père
Moi qui fus orphelin avant que de naître
Dans ma cité infirme
Je sais l’aube est lucide
Mortelle impatience
Le peu de prix D’un seul sourire
La même fin
Le même recommencement
La même angoisse
De te perdre à jamais
Toi
Insaisissable trop belle
Qu’une lèvre remémore
Henri Kréa, La Révolution et la poésie sont une seule et même chose, Pierre Jean Oswald, 1957, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri kréa, révolution, poésie, éditions oswald | ![]() Facebook |
Facebook |





