15/03/2023
Oswald Egger, Rien qui soit

Jour et nuit font deux ans
Je ne suis pas un vagabond, n’ai dieu merci rien d’autre
à faire. Maintenant j’ai avancé me suis assis sur l’heure
héliocentré, comme fonte des prés des taches claires, debout (à
ce moment), écoutai épiant des clins d’instants (éventails
de champs). Je veux teindre des tons (ils appellent). Alors j’ai vu
plus belles larves de plis (fleurs de gorges, avec textures
d’incises fusionnaires) émaillées sur quenouilles.
Leur jeu aussi est mimant (remarquable), au jour elles s’ef
feuillent, se scindent roulent leurs roues solaires, et finalement
ne reste qu’une glume membraneuse, une translucide
robe de points (fleurs ?) sur rosettes pressées en nid velu
et les jeunes pousses y folâtrant dominos (calendage avec
aigrettes. Maintenant se tiennent en lignes (inclinent têtes
et commencent un ton plaintif loquetant en lilas trilles leur
pariade chantée. (…)
Oswald Egger, Rien, qui soit, traduction René-René Lassalle, éditions Grèges, 2016, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald egger, rien, qui soit, vagabond@ | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2023
Oswald Egger, Rien, qui soit

Au milieu de la vie je me retrouvai comme dans une forêt (sans chemin). Je marchais entre les ronces qui à gauche, à droite, à gauche rougeoyaient. Les arbres gris cendre se dressaient, lisses et droits, flamboyant comme des colonnes écorcées ou des fumées s’élevant sans vent, leurs pousses distantes entre eux de trois quatre pas formaient rempart de bois, aux surfaces bombées ou planes, rocs et sapins, ondulations sans tige ni hampe, pendulations dans une forêt de paille, coupé du sentier, ou étais-je ? étais-je ? encore piétinai monte-pente, ne sachant si le chemin ressurgirait, en raidillon qui toujours s’engendre lui-même, arbre après arbre, quand la forêt elle-aussi se rangea et agrandit le champ de la vision devant elle, vers l’ouvert.
Oswald Egger, Rien, qui soit, traduction Jean René Lassalle, éditions Grèges, 2016, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald egger, rien, qui soit, traduction jean rené lassalle | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2023
Rehauts, n° 49, 2022
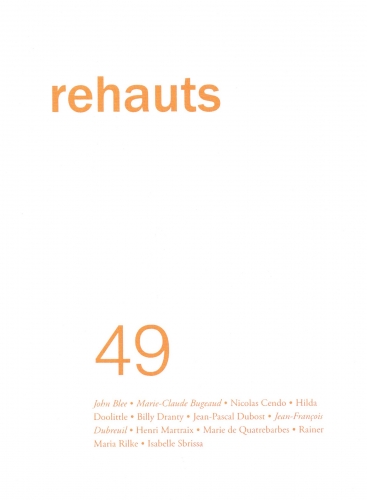
Le mythe d’Orphée est probablement l’un de ceux qui ont le plus fasciné les humains : le retour possible à la vie terrestre après la mort touche quelque chose de profond dans l’imaginaire. Les créateurs se sont attachés à ce thème dans tous les domaines, dès Ovide. L’opéra a très régulièrement repris le thème ; depuis 1600 (L'Euridice, favola drammaticade Giulio Caccini et Jacopo Peri) et, surtout, l’Orfeo de Monteverdi (1607), le drame a inspiré de nombreux compositeurs jusqu’à Philip Glass (Orphée, 1991, à partir du film de Cocteau) ou Pascal Dusapin (Passion, 2008) ; le théâtre, la peinture et le cinéma ont aussi illustré le mythe tout comme la poésie, de Tristan L’Hermitte et Apollinaire aux Sonnets à Orphée de Rilke. Ouvrant cette livraison de Rehauts, Patrick Beurard-Valdoye a choisi de traduire un poème de Rilke, un autre de H. D. ; cette fois, c’est le regard d’Eurydice qui occupe les poèmes à propos de la tentative d’Orphée de la sortir des Enfers. Chez Rilke c’est un narrateur qui rapporte la remontée des Enfers et le comportement d’Eurydice : « son état de morte / la satisfaisait », elle semble ne rien attendre, elle marche sur le « chemin qui remontait à la vie » sans penser à qui l’attend, elle avance « le pas contraint par de longs bandeaux de corps / incertaine, placide et sans nulle impatience » ; quand Orphée se retourne et qu’Eurydice doit redescendre vers les Enfers, ces deux vers, repris, terminent le poème. Dans le poème de H. D. (Hilda Doolittle), c’est Eurydice qui raconte l’épisode en s’adressant à Orphée ; il lui aurait ôté la possibilité de regagner la terre « à cause de son arrogance », et c’est ce thème qu’annonce le premier vers du poème, « Donc tu m’as rejetée en arrière / moi qui aurais pu marcher parmi les âmes vives ». Le tort d’Orphée, puisqu’il a perdu Eurydice en se retournant, c’est justement de ne pas l’avoir laissée où elle était (« je t’aurais oublié / et le passé aussi ») puisque, répète-t-elle comme s’il était présent, « l’enfer n’est pas pire que ta terre ». Grand chant lyrique entre nostalgie des fleurs et acceptation du destin, « Au moins ai-je mes fleurs à moi, / et mes pensées aucun dieu / ne peut prendre ça ». On souhaiterait lire les textes originaux avec les deux traductions pour mieux apprécier le passage d’une langue à l’autre, dans le poème de Rilke quand on lit la restitution de tels vers ((« sylve et val / et voie et ville, fleuve et pré et bête ») ou l’emploi d’un mot rare (« nastié ») à propos du sexe d’Eurydice, dans le poème de H. D. pour la restitution du ton véhément et familier d’Eurydice. Les poèmes sont suivis de deux dessins de John Blee, figures abstraites d’Orphée, Eurydice et Hermès.
Il s’agit d’une toute autre mort dans les proses de Jean-Pascal Dubost, "Animaleries, Un bestiaire de la souffrance", la destruction des espèces animales sans même l’"excuse" d’une raison économique, il s’agit aussi de souffrances gratuites pour le plaisir (?) de spectateurs, de leur disparition provoquée par le "progrès" (automobiles, agriculture intensive). Dubost change d’approche dans chacune des dix proses, ce qui fait l’intérêt de la lecture. La première, non ponctuée, comme les suivantes, cite au début un texte du moyen français et, dans la dernière partie, la pratique des sauniers — clouer un goéland mort sur un piquet pour éloigner les oiseaux de leur saline — se justifie selon eux par son ancienneté : « pourquoi croyez-vous que c’est une pratique ancestrale ? » ; on n’oublie pas quelques mots archaïques, les assonances et allitérations « ça (= les déjections) cause trop de gros dégâts graves dégradant les parcelles et le sel de leurs sales selles ».Dans la cinquième prose, les huit courtes séquences s’ouvrent par « Pensée pour », suivi d’une brève description de la violence faite à tel animal : « Pensée pour el toro aux cornes goudronnées paniquant dans les rues d’Espagne c’est un spectacle pyrotechnique dit sanglant wiki ». La huitième prose retient des "performances" fondées sur la souffrance animale ou leur destruction ; après leur description, l’adjectif « heureux » est repris, précédé d’un intensif (« très, plus que, super », etc.) : « (…) follement heureux le chien errant maigre et décharné exposé en galerie jusqu’à sa mort de faim par Habacue (…) ». La prose s’achève avec une allusion à un sonnet de du Bellay (« Heureux qui comme Ulysse… »). Pas de sensiblerie : des variations de la forme pour refuser que « des discours conceptuels objectifient [la mort] c’est de l’art ».
On souhaite, à en lire des extraits, la publication du récit d’Isabelle Sbrissa, "Jmanvè" (= Je m’en vais ; transcription des échanges entre les deux personnages). Il met en scène Lucile, jeune fille qui ramasse sur les chemins des fossiles et des pierres avec selon elle une forme particulière ; elle rencontre Enzel qui voudrait comme elle chercher de petits trésors, « le monde des cailloux forme petit à petit un double au monde des humains ». Enzel part au village voisin pour une fête foraine, prise en route dans le pickup d’un groupe qui acheté une maison pour la rénover avec « la certitude d’inventer un monde nouveau » ; elle a choisi d’être seule, avec le « besoin d’un retrait pour exister avec les autres (…), pour regarder au-dedans d’elle-même. » Le lecteur est curieux de la suivre, qui garde dans sa poche un caillou en forme de cœur, petit cadeau de Lucile, autre personnage énigmatique.
Marie de Quatrebarbes propose plus de jeux avec les formes que de détails météorologiques avec ses "Poèmes de pluie" : 12 strophes de 3 vers pour "Traversée", 8 ensembles de 3+3 vers, "Suite", qui débutent tous par « Débris de cœur sur la plage », 9, 7 et 8 distiques pour "Première giboulée", "Seconde…" et "Troisième…".Il est question dans le premier poème du passé, de l’enfance, de l’absence et d’une disparition — thèmes récurrents ce l’auteure —, mais aussi de la mer, présente également dans le second poème avec des goémoniers une plage, des mouettes. Les giboulées sont liées à la venue du printemps (« mars », « forsythia ») ; la présence de la neige, affirmée dans le premier ensemble, ne l’est plus ensuite (« je ne sais dire au juste / s’il neige ou quoi… », « est-ce que dehors il neige véritablement »). On est dans un monde sans véritable assise, sans rien qui puisse être tenu pour stable, et même réel avec une « lumière grise », le « silence », qui ne semble habité que par des tourterelles, des chenilles et des fleurs.
Il faut reprendre la lecture de Rehauts, pour les poèmes et proses de N. Cendo, B. Dranty et H. Moutrais, aussi pour les longues recensions de Guennadi Aïgui et Muriel Pic par Jacques Lèbre. C’est une des caractéristiques d’une revue d’exclure une lecture continue, on l’abandonne un temps, nourri par un texte, pour y revenir et, à nouveau, y trouver matière à plaisir.
Rehauts, n° 49, 2022, 96 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 février 2023/
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, 2022 | ![]() Facebook |
Facebook |
12/03/2023
Yves di Manno, Lavis

(l’estampe) (exergue)
longtemps j’ai cherché dans
le poème l’ombre
d’une mémoire plus vaste`
que la mienne
aujourd’hui sans oser
écrire j’attends — l’encre l’estampe ?
lz forme vers laquelle
me conduit la strophe
inscrire la — poésie peinte ?
au revers d’une
vie nouvelle — toile mentale
inaugurale ? — augurant d’un
temps sans dessein — abolissant
essence & sens — signes destins ?
Yves di Manno, Lavis, Flammarion,
2023, p.9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manna, lavis, estampe, forme | ![]() Facebook |
Facebook |
11/03/2023
Yves di Manno; Lavis

une vue
cheminant vers
quel paysage effacé
enfermant la vison
dans les plis
du papier
*
une mue ?
s’acheminant
vers un corps sans
passé ni lendemain
une peinture sans paysage
un poème
hors du langage
Yves di Manno, Lavis,
Flammarion, 2023, p. 106-107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manna, lavis, paysage, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2023
Elisabeth Browning, dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais

Si tu dois m’aimer, que cela soit pour rien
Que l’amour même. Ne dis pas : « Je l’aime pour
Son regard... son sourire... ou les doux discours
Qu’elle peut formuler ... ou parce qu’elle tient
Le même tour que moi de pensée, qui fut bien
Source d’agréments importants, tel ou tel jour »,
Car ces choses, Aimé, peuvent changer toujours,
En soi, ou bien pour toi — et l’amour, ainsi teint,
Peut être aussi déteint. Ne va non plus m’aimer
Du fait que ta pitié sèche mes joues — car celle
Que tu réconfortais, oubliant de pleurer,
Perdrait aussi ton affection conditionnelle !
Aime-moi pour l’amour de l’amour : qu’à jamais
Tu continues d’aimer dans l’amour éternel.
Elisabeth Browning, dans Le Chaos dans 14 vers,
anthologie bilingue du sonnet anglais composée et
traduite par Pierre Vinclair, lurlure, 2023, p. 197.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elisabeth browning, dans le chaos dans 14 vers, amour, éternité | ![]() Facebook |
Facebook |
09/03/2023
John Donne, Le Chaos dans 14 vers

C’est la scène finale de ma pièce ; ici
Les choix fixent l’ultime borne du chemin ;
Ma course, oisive mais brève, a ses dernier pas,
Dernier pouce à mon empan, dernières secondes ;
La mort gloutonne va tout de suite disjoindre
Mon âme de mon corps, je vais dormir un temps ;
Mais ma part éveillée pourra voir ce visage
Dont la peur déjà secoue toutes mes jointures.
Puis, mon âme au ciel, son premier siège, s’envole,
Et mon corps, né de terre en la terre retourne ;
Que tombent mes péchés, tous obtenant leur dû,
Où ils sont nés et m’auraient pressé : en enfer.
Faisant de moi un juste, ainsi purgé du mal :
Car je quitte ce monde, la chair, le démon.
John Donne, dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue
du sonnet anglais composée et traduite par Pierre Vinclair,
lurlure, 2023, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, dans le chaos dans 14 vers, sonnet anglais, âme, enfer, péché | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2023
Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux

Tous les blés flambent
et la brève alouette
est un fragment ascendant de ce feu.
Elle ne gravit tous les paliers de l’air
que parce que le sol est trop brûlant.
Il est une beauté que les yeux et les mains touchent
et qui fait faire au cœur un premier degré dans le chant.
Mais l’autre et dérobe et il faut s’élever plus haut
jusqu’à ce que nous autres ne voyions plus rien,
la belle cible et le chasseur tenace
confondus dans la jubilation de la lumière.
Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux,
Gallimard, 2021, p. 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le dernier livre de madrigaux, alouette, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2023
Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux
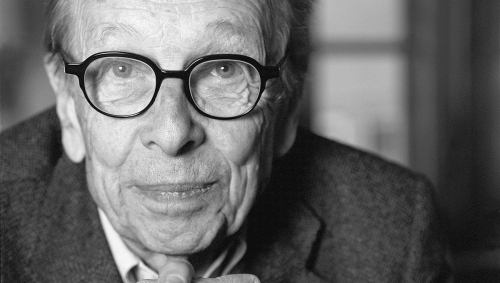
En écoutant Claudio Monteverdi
On croirait, quand il chante, qu’il appelle une ombre
qu’il aurait entrevue un jour dans la forêt
et qu’il faudrait, fût-ce au prix de son âme, retenir :
c’est par urgence que sa voix prend feu.
Alors , à sa lumière d’incendie, on aperçoit :
une pré nocturne, humide, et par-delà
où il avait surpris cette ombre tendre,
ou beaucoup mieux et plus tendre qu’une ombre :
Il n’y a plus que chênes et violette maintenant.
La voix qui a illuminé la distance retombe.
Je ne sais pas s’il a franchi le pré.
Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux,
Gallimard, 2021, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le dernier livre de madrigaux, monteverdi, chant, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2023
Jacques Réda, Mes sept familles : recension
Joue-t-on encore au jeu des sept familles ? Le jeu a pour but de rassembler le plus de fois possible six cartes dont les figures forment une des sept familles — le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille —, c’est-à-dire un groupe homogène. Retenons qu’aux sept poètes retenus, qui apparaissent par ordre alphabétique, manière de ne pas en privilégier un (Jean Follain, André Frénaud, Lorand Gaspar, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu), en est ajouté un huitième (Raymond Queneau), en dehors de l’ordre adopté : contrairement aux premiers, Réda l’a connu trop tard pour que des liens d’amitié se créent. De ces écrivains réunis, seul Gaspar (1925-2019) appartient à sa génération ; tous se rencontraient régulièrement et sont « appréciés tant comme poètes qu’en tant qu’hommes » par Jacques Réda.
Très tôt dans sa vie d’écrivain, Réda a publié des notes critiques ; on pense au Premier livre des reconnaissances (1985), en vers (avec notamment Follain, Perros, Armand Robin), livre maintenant dans un ensemble dont la dernière pièce a été donnée en 2021 (Quart livre des reconnaissances), on pense aussi à son Ferveurs de Borges (1988) et à son activité de chroniqueur de jazz pour Jazz magazine (1). On n’oublie pas qu’il a souvent précisé ce qu’était dans sa pratique le vers et la poésie, depuis Celle qui vient à pas légers (1985) jusqu’aux échanges avec Alexandre Prieux, dans l’Entretien avec Monsieur Texte (2020). La part de chaque écrivain retenu dans ce livre est différente, Réda reprend des recensions ou un texte lu en public, l’ensemble ayant été revu, corrigé et, si besoin était, augmenté.
Les liens d’amitié expliquent que Réda mêle les réflexions à propos des livres et les portraits de leurs auteurs ; son art de la digression le conduit à en introduire d’autres, par exemple celui de Pierre Seghers qui, éditeur, avait publié son premier ensemble de proses dans sa collection à compte d’auteur "Poésie 52". Lisant un livre de Follain, une autre digression lui fait percevoir un poème comme un idéogramme « ouvrant dans la multitude des choses et des mots une sorte de perspective ouvragée sur l’’immensité de son paysage » ; de là, glissement et discussion sur Dieu et le monde pour conclure que « l’homme n’est plus qu’une chose parmi les choses », puis retour au livre. Ces digressions sont partie prenante de la manière de lire de Réda, tout comme les brefs récits de rencontre avec tel ou tel écrivain devenu un ami proche avec le temps, c’est dire qu’un livre n’est pas un objet détaché de celui qui l’a écrit ou de ce que l’on a appris du monde, ce dont la recension tient compte.
Ainsi la lecture de Chef-lieu de Follain se développe en se référant à ce que l’on connaît (ou prétend connaître) de la relation entre les mots et les chose ; dans l’enfance,
La perception pure des choses n’a pas encore été troublée par le sentiment de l’énigme de leur présence et les explications que l’on reçoit : elles sont là et ne font qu’acquérir un surcroît de réalité quand nous apprenons à les nommer, de sorte que les mots qui les désignent sont la chose même et le resteront avec le regard de Follain.
Décalage pour le lecteur entre la lecture critique et les échappées vers d’autres sujets ? Réda s’en amuse, « Je m’excuse de ces considérations que je n’aurais pas osé exposer en présence de Follain et Frénaud. Dans un autre article, il revendique ces sorties de route, « Je reviendrai peut-être tout à l’heure (peut-être : je ne suis pas un commentateur très cohérent) ».
Ses lectures ont un point commun, il se préoccupe toujours du rythme. Frénaud : « il engendre, hors de toute référence par le fourmillement ou l’allitération de ses timbres, le déboité de ses cadences, le refus de la mélodie au profit de l’allure plus souple et plus austère du récitatif » ; Grosjean : « diversité dans la prosodie des vers ». Dans le préambule, Réda relève que les chansons ont conservé « vers rimé et mesuré », ce qui est retrouver quelque chose des origines de la poésie, les liens entre rythme et mélodie étant alors étroits. Liens abandonnés, selon Réda, par la poésie d’aujourd’hui fustigée, « Il y a (...) depuis pas mal d’années une telle prostitution de ce que ses souteneurs appellent « la poésie » que je me refuse à situer les poèmes de Grosjean par rapport à ce trottoir ». On ne peut être plus clair. Réda, depuis longtemps, voit dans l’abandon progressif du vers régulier une marque, « un symptôme de l’affaiblissement de [notre langue] ». S’ajoutent des usages aberrants de l’anglais, quand rien ne semble justifier.
Déclin ou non de la langue, le débat est loin d’être clos. Pour la poésie, Réda ne s’embarrasse pas de précautions et, lecteur pendant des décennies aux éditions Gallimard, il relève que la poésie actuelle oscille « entre une dégénérescence du syllabisme et une prose indigente mise en morceaux sans nécessité prosodique » — c’est sans aucun doute une affirmation à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. On discuterait son refus du marché de la poésie, même si l’on apprécie son humour ; la poésie ? « on lui a voué un mois, comme à la Vierge Marie » et « dans une saine politique consumériste, un marché ». Réda n’a jamais mâché ses mots dans une société où c’est le consensus qui prime, on peut refuser de le suivre — encore faut-il argumenter.
1) Parmi les livres à propos du jazz : L’Improviste, une lecture du jazz, Gallimard, coll. « Le Chemin » (1980), Jouer le jeu (L’Improviste II), id., 1985, Le Grand Orchestre, (Sur Duke Ellington), Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2011.
.
Jacques Réda, Mes sept familles, collection Théodore Balmoral, fario, 2022, 200 p., 19 €.
Joue-t-on encore au jeu des sept familles ? Le jeu a pour but de rassembler le plus de fois possible six cartes dont les figures forment une des sept familles — le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille —, c’est-à-dire un groupe homogène. Retenons qu’aux sept poètes retenus, qui apparaissent par ordre alphabétique, manière de ne pas en privilégier un (Jean Follain, André Frénaud, Lorand Gaspar, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu), en est ajouté un huitième (Raymond Queneau), en dehors de l’ordre adopté : contrairement aux premiers, Réda l’a connu trop tard pour que des liens d’amitié se créent. De ces écrivains réunis, seul Gaspar (1925-2019) appartient à sa génération ; tous se rencontraient régulièrement et sont « appréciés tant comme poètes qu’en tant qu’hommes » par Jacques Réda.
Très tôt dans sa vie d’écrivain, Réda a publié des notes critiques ; on pense au Premier livre des reconnaissances (1985), en vers (avec notamment Follain, Perros, Armand Robin), livre maintenant dans un ensemble dont la dernière pièce a été donnée en 2021 (Quart livre des reconnaissances), on pense aussi à son Ferveurs de Borges (1988) et à son activité de chroniqueur de jazz pour Jazz magazine (1). On n’oublie pas qu’il a souvent précisé ce qu’était dans sa pratique le vers et la poésie, depuis Celle qui vient à pas légers (1985) jusqu’aux échanges avec Alexandre Prieux, dans l’Entretien avec Monsieur Texte (2020). La part de chaque écrivain retenu dans ce livre est différente, Réda reprend des recensions ou un texte lu en public, l’ensemble ayant été revu, corrigé et, si besoin était, augmenté.
Les liens d’amitié expliquent que Réda mêle les réflexions à propos des livres et les portraits de leurs auteurs ; son art de la digression le conduit à en introduire d’autres, par exemple celui de Pierre Seghers qui, éditeur, avait publié son premier ensemble de proses dans sa collection à compte d’auteur "Poésie 52". Lisant un livre de Follain, une autre digression lui fait percevoir un poème comme un idéogramme « ouvrant dans la multitude des choses et des mots une sorte de perspective ouvragée sur l’’immensité de son paysage » ; de là, glissement et discussion sur Dieu et le monde pour conclure que « l’homme n’est plus qu’une chose parmi les choses », puis retour au livre. Ces digressions sont partie prenante de la manière de lire de Réda, tout comme les brefs récits de rencontre avec tel ou tel écrivain devenu un ami proche avec le temps, c’est dire qu’un livre n’est pas un objet détaché de celui qui l’a écrit ou de ce que l’on a appris du monde, ce dont la recension tient compte.
Ainsi la lecture de Chef-lieu de Follain se développe en se référant à ce que l’on connaît (ou prétend connaître) de la relation entre les mots et les chose ; dans l’enfance,
La perception pure des choses n’a pas encore été troublée par le sentiment de l’énigme de leur présence et les explications que l’on reçoit : elles sont là et ne font qu’acquérir un surcroît de réalité quand nous apprenons à les nommer, de sorte que les mots qui les désignent sont la chose même et le resteront avec le regard de Follain.
Décalage pour le lecteur entre la lecture critique et les échappées vers d’autres sujets ? Réda s’en amuse, « Je m’excuse de ces considérations que je n’aurais pas osé exposer en présence de Follain et Frénaud. Dans un autre article, il revendique ces sorties de route, « Je reviendrai peut-être tout à l’heure (peut-être : je ne suis pas un commentateur très cohérent) ».
Ses lectures ont un point commun, il se préoccupe toujours du rythme. Frénaud : « il engendre, hors de toute référence par le fourmillement ou l’allitération de ses timbres, le déboité de ses cadences, le refus de la mélodie au profit de l’allure plus souple et plus austère du récitatif » ; Grosjean : « diversité dans la prosodie des vers ». Dans le préambule, Réda relève que les chansons ont conservé « vers rimé et mesuré », ce qui est retrouver quelque chose des origines de la poésie, les liens entre rythme et mélodie étant alors étroits. Liens abandonnés, selon Réda, par la poésie d’aujourd’hui fustigée, « Il y a (...) depuis pas mal d’années une telle prostitution de ce que ses souteneurs appellent « la poésie » que je me refuse à situer les poèmes de Grosjean par rapport à ce trottoir ». On ne peut être plus clair. Réda, depuis longtemps, voit dans l’abandon progressif du vers régulier une marque, « un symptôme de l’affaiblissement de [notre langue] ». S’ajoutent des usages aberrants de l’anglais, quand rien ne semble justifier.
Déclin ou non de la langue, le débat est loin d’être clos. Pour la poésie, Réda ne s’embarrasse pas de précautions et, lecteur pendant des décennies aux éditions Gallimard, il relève que la poésie actuelle oscille « entre une dégénérescence du syllabisme et une prose indigente mise en morceaux sans nécessité prosodique » — c’est sans aucun doute une affirmation à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. On discuterait son refus du marché de la poésie, même si l’on apprécie son humour ; la poésie ? « on lui a voué un mois, comme à la Vierge Marie » et « dans une saine politique consumériste, un marché ». Réda n’a jamais mâché ses mots dans une société où c’est le consensus qui prime, on peut refuser de le suivre — encore faut-il argumenter.
1) Parmi les livres à propos du jazz : L’Improviste, une lecture du jazz, Gallimard, coll. « Le Chemin » (1980), Jouer le jeu (L’Improviste II), id., 1985, Le Grand Orchestre, (Sur Duke Ellington), Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2011.
Jacques Réda, Mes sept familles, collection Théodore Balmoral, fario, 2022, 200 p., 19 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 24 janvier 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, mes sept familles | ![]() Facebook |
Facebook |
05/03/2023
Franco Fortini, Feuille de route

Sagesse
Il n’y a qu’une femme que j’ai aimée
Comme dans les rêves on s’aime soi-même
Et de bien et de mal je l’ai comblée
Comme font les hommes avec eux-mêmes.
C’était elle que j’avais choisie
Pour être appelé par mon nom :
Et elle le disait lorsque je l’ai perdue.
Mais peut-être n’était-ce pas mon nom.
Et je vais par d’autres saisons et pensées
Cherchant autre chose par-delà son visage ;
Mais plus je me fatigue par de nouveaux sentiers
Plus nettement je connais son visage.
Peut-être est-ce vrai, et les plus sages l’ont écrit :
Au-delà de l’amour il y a encore l’amour.
La fleur se perd et puis se voit le fruit :
Nous nous perdons et c’est l’amour qu’on voit.
Franco Fortini, Feuille de route, édition bilingue,
traduction de l’italien Giulia Camin et Benoît Casas,
préface Martin Rueff, NOUS, 2002, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franco fortini, feuille de route, nom, amour, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
04/03/2023
Bernard Noël, Monlogue du nous

Nous avons perdu nos illusions et chacun de nous se croit fortifié par cette perte. Fortifié dans as relation avec les autres. Nous savons cependant que nous y avons égaré quelque chose car la buée des illusions nous était plus utile que leur décomposition. Nous oublions ce gain de lucidité dans son exercice même. Nous n’en avons pas moins de mal à mettre plus de raison que de sentiment dans notre action. Nous aurions dû depuis longtemps donner toute sa place au durable, mais la séduction s’est toujours révélée plus immédiatement efficace.
Bernad Noël, Monologue du nous, P. O. L, 2015, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, monologue du nous, illusion, oubli, séduction | ![]() Facebook |
Facebook |
03/03/2023
Hans Morgenthaler; « Moi-même », suivi de huit poèmes

La taupe II
A travers l’obscurité j’écoute
S’il ne m’arriverait pas un son, quelque écho
De la taupe ma bien aimée
Creusant dans la même nuit
En quête de sa propre lumière.
S’il ne m’arriverait pas un salut, un signe
D’un compagnon qui me ressemble...
Je fouille seul et me hisse en vain
Pour devenir humain...
Pas un mot, pas un son, pas un écho
De sympathie ne frappe mes oreilles.
Seulement au milieu des champs vides
Balancé par la tempête
Dans un crépuscule pâle et oblique
Portant l’habit gris de l’ermite
Forcé de rejoindre la mort
Pendu à une barre ployée en arc,
Le cadavre d’un pauvre frère taupe !
Hans Morgenthaler, « Moi-même », suivi de
huit poèmes, traduction de l’allemand
Renata Weber, La Revue de Belles-Lettres,
2022, II, p.37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans morgenthaler, « moi-même », suivi de huit poèmes, humain, taupe | ![]() Facebook |
Facebook |
02/03/2023
L'Île rebelle, Anthologie de poésie britannique au tournant du XXIe siècle

Le titre est clair, il ne s’agit pas d’une anthologie de la poésie britannique, mais de poésie britannique, donc d’un choix qui rassemble 49 poètes. Le plus ancien, Edwin Morgan (1920-2010), ouvre l’ensemble consacré à l’Écosse (huit poètes), la plus jeune, Fiona Sampson (née en 1968) ferme le choix des poètes d’Angleterre, les plus nombreux, et trois noms sont retenus pour le Pays de Galles. On pourra toujours signaler que tel poète est absent, par exemple David Constantine (né en 1944), mais sauf s’il suit de près ce qui est édité au Royaume Uni (qui le fait ?), un lecteur français aura une idée précise de la variété de ce qui s’y publie. Un ou deux poèmes sont retenus, rarement plus, pour chaque auteur ; on relève le nombre important d’auteures et pas seulement de la nouvelle génération.
Pour qui connaît seulement les auteur(e)s largement reconnus, comme Carol Ann Duffy ou Derek Walcott, la lecture de la préface, ‘’Modernisme et insularité’’ est une excellente entrée dans l’anthologie : la poésie britannique contemporaine s’appuie sur des traditions fort différentes de la poésie française. Il existe au Royaume Uni un ‘’poète lauréat’’, c’est-à-dire officiel (actuellement Simon Armitage) ; par ailleurs, The Poetry Society, née en 1909, publie depuis1912 The Poetry Review, enfin le Times Literary Supplement donne au moins deux poèmes inédits et propose des recensions dans chacune de ses livraisons hebdomadaires. Pour la publication, les Britanniques sont bien servis avec d’excellents éditeurs, mais le réseau français n’a rien à leur envier. Les différences sont ailleurs. Jacques Darras note que « le lecteur (…) risque de se sentir décontenancé s’il recherche à tout prix le « travail de langue » auquel l’a habitué depuis si longtemps la poésie française. Rien de semblable ici, le poème se veut presque toujours narratif, discursif et consécutif, se gardant dans la majorité des cas de laisser l’initiative aux mots ». Parmi bien d’autres, lisons le début d’un poème de Lachlan Mackinson (né en 1956), ‘’ Petit jour’’ :
Quelqu’un vient de lire
le Livre de la Semaine.
mais la radio s’est tue. J’ai entendu l’avis de tempête
en mer, au sud de chez nous.
(…)
Il faut être un familier de T S. Eliot, de Pound, de W. H. Auden ou de Philip Larkin, notamment, pour repérer au fil de la lecture leur influence, et c’est tout l’intérêt de la préface d’informer le lecteur sur les liens entre les poètes de générations différentes. Ainsi, Tony Harrison, vrai héritier d’Eliot, « analyse dans son long poème « V » « (dont un extrait figure dans le livre) « le clivage de plus en plus net entre populisme anti-élitaire et mauvaise conscience petite-bourgeoise. » D’autres, comme Geoffrey Hill, et Jeremy Prynne, se sont écartés de ces influences pour « parvenir à un hermétisme clos plus clos sur lui-même que celui de Mallarmé. » À l’inverse, la simplicité et la fantaisie dominent dans les textes retenus des poètes femmes. Il est en effet intéressant de reconnaître dans la poésie britannique un humour pour le moins étranger à la poésie française, à quelques exceptions près au XXe siècle (Tardieu, Queneau, Frénaud) ; on le relève plutôt chez des auteures, comme Wendy Cope, Selima Hill ou Carol Ann Duffy qui, par exemple, fait revivre à sa manière le petit chaperon rouge ou rapporte dans un long poème comment Eurydice, qui ne veut pas quitter les Enfers, réussit à obliger Orphée à se retourner ; voici la fin de ce poème :
Il était à un mètre de moi.
Je lui dis avec des tremblements dans la voix —
Orphée ton poème est un chef-d’œuvre.
Je brûle de l’entendre à nouveau.
Il souriait avec modestie
lorsqu’il se retourna,
lorsqu’il se retourna et me regarda.
Que dire d’autre ?
J’ai remarqué qu’il ne s’était pas rasé.
J’ai fait un signe de la main avant de disparaître.
(…)
Il faut également signaler la présence de poètes qui écrivent en anglais, mais qui, venant d’ailleurs, n’utilisent pas la langue anglaise comme un natif de Londres ou de Birmingham ; on pense à Derek Walcot (originaire de Sainte-Lucie), Daljit Nagra (Inde) ou George Szirtes (Hongrie). Toutes ces voix coexistent et illustrent « la vigoureuse vivacité de la langue anglaise ». C’est cette grande variété des voix qui est restituée dans cette anthologie dont, sans l’avoir encore lue entièrement, on apprécie la précision et l’élégance des traductions.
Chaque auteur(e) est brièvement présenté(e) avant le choix de ses poèmes ; un dossier énumère les sources utilisées et, ensuite, propose une bibliographie sélective pour chaque auteur(e), une bibliographie générale et une autre qui donne quelques études sur la poésie.
L’Île rebelle, Anthologie de poésie britannique au tournant du XXIe siècle, édition bilingue, Choix de Martine De Clerq, préface de Jacques Darras, tous deux traducteurs, Poésie/Gallimard, 2022, 560 p., 15 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 14 janvier 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’Île rebelle, anthologie de poésie britannique au tournant du xxie siècle | ![]() Facebook |
Facebook |
01/03/2023
Pascal Quignard, Les Paradisiaques

La voix paradisiaque
Si la préférence pour la voix féminine maternelle précède en nous le premier jour, cette perte se répète tragiquement à l’adolescence chez les garçons. Ils quittent l’aigu pour le grave. L’activité de la voix maternelle externe chez les mâles à partir de la puberté devient perpétuellement initiale. Cette perte définit le tragique. Les anciens Grecs nommaient tragôdiale dédoublement vocal de la mue masculine, faisant passer le petit humain de la néoténie à la puberté.
La voix de jadis est la voix soprano.
La voix maternelle externe a un impact rythmique dans le comportement de succion du nouveau-né.
Il y a des anorexies natales dues à des défauts de voix.
Anorexies « tragiques »
Faims affamées dues au non-rappel de la voix interne.
Pascal Quignard , Les Paradisiaques, Folio/Gallimard, 2007, p. 273.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, les paradisiaques, voix, soprano | ![]() Facebook |
Facebook |





