15/11/2011
Giuseppe Conte, L'Océan et l'Enfant

Il y a le verre, le sable et le vide
le vase, l'entonnoir, la jonction
le miroir, la pluie, les dunes
en cônes de velours clivés par l'éclipse
Il y a la mer à sec, la grève
le soleil fluet d'un asphodèle
le froissement d'or de tout brocart
l'intime déroute des choses
la chute, le long déclin, la naissance
la cime renversée en plaine
et la digue des astres, scintillante
clepsydre*, sonnet baroque, structure
du luth et de l'ombre, paraphe de sel
pour quelle mort est ta mesure ? Pour quelle mort ?
(26. XII. 1980, entre 1 heure et 2 heures du matin)
C'è il vetro, la sabbia, ed il vuoto
l'ampolla, l'incontro, l'imbuto
le specchio, la pioggia, le dune
e coni di velluto sfaldati dal topo
eclisse, c'è il mare prosciugato, il
greto, il flebile sole della plumosa
l'oro gualcito di ogni broccato
l'essere sgominato di una cosa
la caduta, il lungo assottigliamento, la
nascita, la vetta ribaltata in pianura
e gli astri, diga di scintillamento
clessidra, sonetto barocco, struttura
del liuto e dell'ombra, sigla di sale
per quale morte è la tua misura, per quale morte ?
(26. XII. 1980, tra l'una e le due di notte)
* En italien, clessidra désigne à la fois l'horloge à eau et le sablier. En dépit de son impropriété, le maintien du mot clepsydre en français nous a semblé nécessaire (N.d.T.)
Giuseppe Conte, L'Océan et l'Enfant, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para, Arcane 17, 1989, p. 113 et 112.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe conte, jean-baptiste para, l'océan et l'enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2011
Ludovic Janvier, La mer à boire
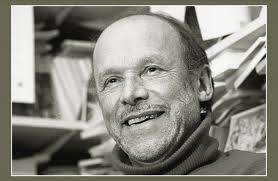
On voit les chiens
On voit les chiens tirant leurs maîtres vers mourir
suivant les voies imprévisibles de l'odeur
ou les freinant — selon — pour obéir
aux manigances incalculables du regret
Nous marchons retournés comme chez Dante les pleureurs
mais au lieu d'arroser nos fosses avec des larmes
c'est nos chiens nous qu'on trempe de repentirs
pendant que les clébards eux compissent le chemin
où notre temps se ralentit se précipite
Paris terre promise à tous les rêveurs des gourbis
Leur Chanaan ce soir est dans l'eau sombre
ils ont gémi sous la pluie mains sur la nuque
c'est mains dans le dos qu'on en retrouve ils flottent
enchaînés pour quelques jours à la poussée du fleuve
c'est la pêche miraculeuse ah pour mordre ça mord
on en repêche au pont d'Austerlitz
on en repêche au pont de Bezons la France dort
on repêche une femme canal Saint-Denis
les rats crevés les poissons ventre en l'air les godasses
ne filent plus tout à fait seuls avec les vieux cartons
et les noyés habituels venus donner contre les piles
on peut dire qu'il y a du nouveau sous les ponts
la Seine s'est mise à charrier des Arabes
avec ces éclats de ciel noir dans l'eau frappée de pluie
Ludovic Janvier, La mer à boire, Gallimard, 1987, p. 60 et 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic janvier, la mer à boire, arabes en octobre 1961 | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2011
Jean Paulhan, À poésie rêveuse, poète chétif
À poésie rêveuse, poète chétif
 J'imagine qu'un ange, un Persan, un homme tombé d'une autre planète vît d'un trait (comme il est naturel à ces personnages) toute la poésie française — et l'allemande ou l'anglaise tout aussi bien — du XIIe au XXe et de Théroulde, ou simplement de Chênedollé à Paul Éluard. Voici, en gros, ce qu'il observerait : c'est que la poésie nous paraît aujourd'hui chose infiniment plus grave et précieuse qu'elle ne paraissait jadis : sacrée, peu s'en faut ; c'est aussi qu'elle est devenue misérable et dépouillée, à proportion même qu'elle nous semblait précieuse — ainsi perdant chaque année en moyens ce qu'elle gagnait en mérites.
J'imagine qu'un ange, un Persan, un homme tombé d'une autre planète vît d'un trait (comme il est naturel à ces personnages) toute la poésie française — et l'allemande ou l'anglaise tout aussi bien — du XIIe au XXe et de Théroulde, ou simplement de Chênedollé à Paul Éluard. Voici, en gros, ce qu'il observerait : c'est que la poésie nous paraît aujourd'hui chose infiniment plus grave et précieuse qu'elle ne paraissait jadis : sacrée, peu s'en faut ; c'est aussi qu'elle est devenue misérable et dépouillée, à proportion même qu'elle nous semblait précieuse — ainsi perdant chaque année en moyens ce qu'elle gagnait en mérites.
Car il est commun de nos jours d'entendre prononcer par des gens d'allure très raisonnable, des écrivains et même des critiques, par exemple qu'un poème suffit à ébranler les forces secrètes du cosmos, qu'un mot imprudemment rythmé s'en va susciter au loin des îles et des forêts, qu'un vers a le pouvoir d'engendrer la substance et qu'il suffirait de penser sur la première lettre de l'alphabet pour assez vite ruer dans la folie.1 Oui, cela se dit tous les jours, et personne ne s'évanouit ; cela, et mille autres choses subtiles, si profondes qu'on ne se défend pas de l'impression que leurs auteurs les savent, sans doute, puisqu'ils les disent. Mais sont-ils parvenus à les croire ? On se demande comment ; on fait en ce sens quelques timides essais. On continuera. Quant à aller plus loin qu'eux dans la hardiesse et dans l'invention, chacun voit bien qu'il n'y faut pas songer. Ce serait déjà très beau si l'on arrivait à les comprendre — à les réaliser (comme nous disons à présent). Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'au pris de tels rêves une simple petite poésie de deux sous, comme il s'en est fait de tout temps, comme il s'en invente par dizaines à chaque repas de noces, jeu d'enfants ou banquet d'anciens militaires, devient une merveille d'innocence et de clarté — de naturel. C'est qu'il nous prend grande envie d'en imaginer nous-mêmes quelques-unes (ne fût-ce que pour échapper aux thèses et explications dont il s'agit). Et je dois bien supposer que c'est là un sentiment tout à fait naturel et commun, puisque l'on voit en fait les poèmes devenir sous nos yeux d'autant plus simples, et même simplistes, et décharnés en tout cas, que les théories sont plus flatteuses. Le poète découvre un beau jour que la poésie est prière, et ce même jour abandonne les rimes empierrées, les empérières et les couronnées, la poésie sacrée et la villanelle. Il invente que la poésie, au comble de la création, survole toute morale, et aussitôt renonce à l'épopée. Que le poète est mage et voyant, et le discours en vers, l'épître, la satire lui semblent désormais des genres mesquins. Qu'Orphée avec Amphion mettent en branle les animaux et les pierres — et que ferait-il encore d'une épigramme ou d'un petit triolet ? Que le poème est conscience de l'inconscient, conversion du Rien dans le Tout, exercice spirituel, frénétique apprentissage de l'aventure mystique, et le voilà qui balance le madrigal avec le rondeau. Que la poésie est ascèse et magie, assez d'épithalames et de dithyrambes ! qu'elle est identité des contraires, au diable les métagrammes, les monologues et les tercets ! Mise en question de notre condition humaine, finis les centons, équivoques et contrepèteries. À la fois création et créature, plus de tragédies en vers, plus de sonnets ni de proverbes ! [...]
Jean Paulhan, À demain la oésie, Introduction à une anthologie, dans Œuvres complètes II, L'art de la contradiction, Gallimard, 2009.
Publié dans Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, à poésie rêveuse, poète chétif, l'art de la contradiction | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2011
Pierre Bergounioux, Le Matin des origines
 Je ne devrais pas me souvenir. D'ailleurs je ne me rappelle pas que la Corrèze dont je suis originaire et où j'ai vécu dix-sept années durant, ait été à aucun moment revêtue d'azur et d'or comme le Lot où j'ai pu passer une quinzaine de jours en six ans, les premiers. Elle a dû l'être, portant, mais les jours, les années, la clarté pâle et froide où nous nous avançons, l'habitude ont oblitéré, emporté le lustre éclatant dont une puissance mystérieuse pare d'abord toute chose afin que nous restions. Et si le Quercy se dresse, dans ma mémoire, comme ma demeure véritable et la terre des merveilles, c'est parce que je l'ai quitté sans retour avant que le temps, l'âge ne le dépouillent, lui aussi, de la splendeur que je suppose uniformément répandue sur la terre aux yeux de ceux dont les yeux s'ouvrent.
Je ne devrais pas me souvenir. D'ailleurs je ne me rappelle pas que la Corrèze dont je suis originaire et où j'ai vécu dix-sept années durant, ait été à aucun moment revêtue d'azur et d'or comme le Lot où j'ai pu passer une quinzaine de jours en six ans, les premiers. Elle a dû l'être, portant, mais les jours, les années, la clarté pâle et froide où nous nous avançons, l'habitude ont oblitéré, emporté le lustre éclatant dont une puissance mystérieuse pare d'abord toute chose afin que nous restions. Et si le Quercy se dresse, dans ma mémoire, comme ma demeure véritable et la terre des merveilles, c'est parce que je l'ai quitté sans retour avant que le temps, l'âge ne le dépouillent, lui aussi, de la splendeur que je suppose uniformément répandue sur la terre aux yeux de ceux dont les yeux s'ouvrent.
Je possède quelques images de l'époque où s'éveille en nous le sentiment de l'existence. Plus exactement, le sentiment de la vie, de la mienne, à ce qu'il paraît, a fixé l'image de lieux où je ne devais plus revenir, de l'instant où l'on s'éveille aux lieux, aux instants.
Elle n'est que pour moi. Ceux qui étaient alors dans la force de l'age n'ont rien vu que d'habituel. Ils n'ont rien vu. Je n'ai même pas la ressource d'obtenir d'eux — les survivants — un élément de preuve, une confirmation. La vie réelle, la leur, alors, a traversé ces éblouissements sans en garder trace. Ils n'ont pas transfiguré, pour elle, une fleur en forme de balustre, une odeur, un chemin à midi qui, maintenant encore, malgré l'éloignement et la destruction, m'exaltent parce que je les ai découverts à l'instant critique où l'on est tenté de ne pas vouloir, de dormir toujours. Alors la vie s'avance à notre rencontre dans sa gloire et sa magnificence pour nous éveiller tout à fait.
Pierre Bergounioux, Le Matin des origines, éditions Verdier, 1992, p. 9-11.
© photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, le matin des origines, souvenir, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/11/2011
Jean-Pierre Verheggen, Porches, Porchers

1.
Nous détestions les fermes.
Les fermiers.
Replets.
Satisfaits.
Les métayers et leurs ouvriers.
Saisonniers.
Dupés.
Exploités.
Leurs aoûterons.
Leurs tâcherons.
Leurs souillons.
Leur promiscuité.
Acceptée.
Entérinée.
Avalisée.
Nous détestions leurs messiers.
Leurs palefreniers ou valets.
Laquais. Laids.
Envoyés valdinguer.
Étriller ou faucher.
Aider les faucheurs armés.
Arnachés ou épongés.
Irrelevés.
Nous détestions les travailleurs des champs tous entiers.
Puants.
Infâmants.
Paysans.
Les peaussiers.
Plaigneurs.
Quémandeurs.
Les taupiers.
Les faneurs.
Suants.
Gagneurs.
Les échardonneurs.
Les échenilleurs.
Les soigneurs attitrés.
Bousés. Bouseux.
Beaucoup trop courageux.
Jean-Pierre Verheggen, Porches, Porchers dans Porches, Porchers, Pubères, Putains, Stabat Mater, ou Pour l'amour d'un porc, préface de Norge, lecture de Jean-Marie Klinkenberg, Bruxelles, éditions Labor, 1991, p. 13-15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre verheggen, porches, porchers, paysans énumération. | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2011
Henri Lefebvre, Les Unités perdues
 [...] Perdu l'atelier de Guy Levis Mano, 6 rue Huyghens à Paris · Cervantès disait de lui-même qu'il fallait aussi l'admirer pour ce qu'il n'a pas écrit · On ne sait où, ni comment, Baruch de Spinoza apprit à polir les verres optiques ; à la fin de sa vie, le philosophe écrit un Traité de l'iris qu'il jette ensuite au feu, sans doute pour un problème de censure · En 1889, Fernand Drujon publie Essai bibliographique sur la destruction volontaire des livres ou Bibliolytie · Il n'existe aucun ouvrage en français sur l'insurrection ouvrière de l'été 1951 à Berlin Est · Les dix-huit derniers mois de sa vie, le peintre suisse Andréas Walser les dépense à Paris, peignant près de deux cents tableaux ; il meurt en 1930 à vingt-deux ans, les deux tiers de son œuvre ont disparu. · Les manuscrits déchirés par W. B. Yeats pour obtenir les versions «heureuses» de Deirdre et de On Baile's Strand · Out in the World, roman inachevé et non publié de Jane Bowles · Chinese Series, film inachevé de Stan Brakhage · La plupart des œuvres de jeunesse de Nicolas de Staël ont été détruites · Les réponses écrites de Gisèle Prassinos aux lettres de son éditeur Henri Parisot ont été perdues · La Société des Auteurs de Grande-Bretagne publie une enquête menée auprès de neuf cent cinquante-quatre écrivains sur les relations entretenues avec leurs éditeurs ; au premier rang des plaintes : la perte ou le vol des manuscrits · «Est-il mort le secret perdu dans Atlantis ? », question sans réponse posée par les poètes du Grand Jeu · [...]
[...] Perdu l'atelier de Guy Levis Mano, 6 rue Huyghens à Paris · Cervantès disait de lui-même qu'il fallait aussi l'admirer pour ce qu'il n'a pas écrit · On ne sait où, ni comment, Baruch de Spinoza apprit à polir les verres optiques ; à la fin de sa vie, le philosophe écrit un Traité de l'iris qu'il jette ensuite au feu, sans doute pour un problème de censure · En 1889, Fernand Drujon publie Essai bibliographique sur la destruction volontaire des livres ou Bibliolytie · Il n'existe aucun ouvrage en français sur l'insurrection ouvrière de l'été 1951 à Berlin Est · Les dix-huit derniers mois de sa vie, le peintre suisse Andréas Walser les dépense à Paris, peignant près de deux cents tableaux ; il meurt en 1930 à vingt-deux ans, les deux tiers de son œuvre ont disparu. · Les manuscrits déchirés par W. B. Yeats pour obtenir les versions «heureuses» de Deirdre et de On Baile's Strand · Out in the World, roman inachevé et non publié de Jane Bowles · Chinese Series, film inachevé de Stan Brakhage · La plupart des œuvres de jeunesse de Nicolas de Staël ont été détruites · Les réponses écrites de Gisèle Prassinos aux lettres de son éditeur Henri Parisot ont été perdues · La Société des Auteurs de Grande-Bretagne publie une enquête menée auprès de neuf cent cinquante-quatre écrivains sur les relations entretenues avec leurs éditeurs ; au premier rang des plaintes : la perte ou le vol des manuscrits · «Est-il mort le secret perdu dans Atlantis ? », question sans réponse posée par les poètes du Grand Jeu · [...]
Henri Lefebvre, Les Unités perdues, Manuella éditions, 2011, p. 82-84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2011
Jude Stéfan, Génitifs

p. de novembre
sa femme au sexe d'araignée
où grimpe une souris elle
crie
elles sautent par la fenêtre
ou le charme le plus doux
/ou les pelletées de neige
ou la brune au coquart/ou
une reine sans gardes
en style journal
par un temps suave, crachoteux,
charmant ou même délicat à la
Tous les saints
Ils se tuent ils s'inclinent sur
les routes les tombes par
deux fois l'an
au bonheur cambrioleur
les morts les pauvres morts les
scrutent d'en bas
Jude Stéfan, Génitifs, Gallimard, 2001, p. 48.
ah crier !
Novembre, rien
sinon le meurtre des animaux à saler
plus d'oiseaux belges qui atterris-
saient ou tourterelles turque la
Terre vomit son vertige en cratères
en séismes en odeurs d'impiété :
ah renversons les présages
abrégeons les mots sans apostrophe
remontons nos âges pour
cueillir de tes jaunes fleurs
à ne plus t'étreindre
de rage fouir quelque Autre
ah crier à la Morte
Jude Stéfan, Désepérance, Déposition, Gallimard, 2006, p. 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, poème de novembre, génitifs, désespérance, déposition | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2011
Eugène Savitzkaya & Alain Le Bras, Quatorze cataclysmes
 La montagne a bougé. La montagne est en morceaux. La maison, cassée. Sous terre sont les merisiers et leurs brindilles, le mélèze, le feuillage dispersé, le mouton, le mammouth musclé, la bonne mouture de froment, les ordures, les os, les machines sans roues, les quartiers de meule, les faisceaux de paille mouillée, les rayons de miel, le minerai si vif et le manganèse, il n'y a plus de musc, plus de chair molle, rien que de la matière morcelée et du morfil en quantité.
La montagne a bougé. La montagne est en morceaux. La maison, cassée. Sous terre sont les merisiers et leurs brindilles, le mélèze, le feuillage dispersé, le mouton, le mammouth musclé, la bonne mouture de froment, les ordures, les os, les machines sans roues, les quartiers de meule, les faisceaux de paille mouillée, les rayons de miel, le minerai si vif et le manganèse, il n'y a plus de musc, plus de chair molle, rien que de la matière morcelée et du morfil en quantité.
De la montagne effondrée, frappée au cœur, trois coups de maillet sur le toit, le sucre n'est plus en tas, la foudre l'a brûlé, la maison est dans la cave, craie sur le charbon, ciel dans l'eau.
C'était une montagne en roche dure et en poussière, poussière qui recouvre les étangs, luisante et savoureuse, poudre et farine, le grand moulin fonctionnait, le grenier se remplissait, l'osier était blanc, blanches les planches et le lattis. La maison était une cage aérée entourée de roseaux, l'ombre de la montagne filtrait entre les claies.
Eugène Savitzkaya et Alain Le Bras, Quatorze cataclysmes, Le temps qu'il fait, 1985, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2011
Pierre de Marbeuf, Le Miracle d'amour

Sonnet
Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage,
Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en amour aussi bien qu'en la mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer
Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.
La mère de l'amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau,
Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l'on pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
Pierre de Marbeuf, Le Miracle d'amour, Obsidiane, 1983, p. 130.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre de marbeuf, le miracle d'amour, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
06/11/2011
Paul Blackburn, Villes, suivi de Journaux

La proposition
Après qu'elle
s'est plainte des
hommes
pendant une bonne heure
à la mère de sa copine
elle
rendait visite à sa copine
et à la mère de sa copine
à la campagne, son
amie était sortie
chercher le chat
et elle
continuait la ré-
pétitive lamentation que
la mère de sa copine
écoutait patiemment
sans rien dire
jusqu'à ce que (pendant que)
sa fille était sor
tie (chercher
le chat)
et elle dit pour la
centième fois combien vraiment
les hommes étaient
de purs bâtards et est-ce qu'elle croyait
pas (la mère) qu'il
EXISTAIT
d'autres choses in-
téressantes, ou
qu'il était
temps d'essayer quelque chose
de nouveau, la mère
après un long silence
dit : « ça serait
pas vraiment nouveau
pour moi, mais je suis
prête quand tu le seras. »
La copine de
retour (avec le chat)
fut pas qu'un peu sur-
prise quand son amie in-
sista pour rentrer par le dernier bus (elle
devait ABSOLUMENT corriger un
texte). « J'espère que je l'ai
pas offensée, ou rien.»
La mère, après avoir
reconduit la copine au bus,
expliqua
à sa fille, sur
le chemin du retour la plus que
probable raison qui
avait fait fuir
vers la ville son amie
si brutalement
L'OBSCURITÉ EST SUR LE MONDE ET L'AMOUR
est parti ail-
leurs, mon esprit, ganté et épuisé
même le hall est obscur tandis
que je me gerbe sur le lit
Ce n'est pas que
je ne t'aime
pas, ma chérie, nous
sommes tous les deux ailleurs.
Paul Blackburn, Villes suivi de Journaux, traduit par Stéphane Bouquet, Série américaine, José Corti, 2011, p. 128-129, 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul blackburn, stéphane bouquet, villes, journaux | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2011
Roger Gilber-Lecomte, Haïkaïs, dans Œuvres complètes II

Haïkaïs
L'aube — Chante l'alouette. —
Le ciel est un miroir d'argent
Qui reflète des violettes.
Le soleil en feu tombe dans la mer ;
des étincelles :
Les étoiles !!
Oh ! la pleine lune sur le cimetière.—
Noirs les ifs — Blanches les tombes —
Mais en dessous ?...
Les yeux du Chat :
Deux lunes jumelles
Dans la nuit.
La nuit. — L'ombre du grand noyer
est une tache d'encre aplatie
au velours bleu du ciel.
Vie d'un instant...
J'ai vu s'éteindre dans la nuit
L'éternité d'une étoile.
La cathédrale dans les brumes :
Un sphinx à deux têtes, accroupi
dans une jungle de rêve.
J'ai vu en songe
Des splendeurs exotiques de soleil
Matin gris. — Le ciel est une chape de plomb.
Morte la Déesse,
dansons en rond !!
Mais, mes rêves aussi sont morts...
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes II, édition établie par Jean Bollery, avant-propos de Pierre Minet, Gallimard, 1977, p. 127-128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, haïkaïs, pierre minet | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2011
Philippe Soupault, Georgia, Épitaphes, Chansons

Frères aveugles
Pensez à tous ceux qui voient
vous tous qui ne voyez pas
où vont-ils se laissez conduire
ceux qui regardent leur bout de nez
par le petit bout d'une lorgnette
Pensez aussi à ceux qui louchent
à ceux qui toujours louchent vers l'or
vers la mer leur pied ou la mort
à ceux qui trébuchent chaque matin
au pied du mur au pied d'un lit
en pensant sans cesse au lendemain
à l'avenir peut-être à la lune au destin
à tout le menu fretin
ce sont ceux qui veillent au grain
Mais ils ne voient pas les étoiles
parce qu'ils ne lèvent pas les yeux
ceux qui croient voir à qui mieux mieux
et qui n'osent pas crier gare
Pensez aux borgnes sans vergogne
qui pleurent d'un œil mélancolique
en se plaignant des moustiques
Pensez à tous ceux qui regardent
en ouvrant des yeux comme des ventres
et qui ne voient pas qu'ils sont laids
qu'ils sont trop gros ou maigrelets
qu'ils sont enfin ce qu'ils sont
Pensez à ceux qui voient la nuit
et qui se battent à coups de cauchemars
contre scrupules et remords
Pensez à ceux qui jours et nuits
voient peut-être la mort en face
Pensez à ceux qui se voient
et savent que c'est la dernière fois
Philippe Soupault, Georgia, Épitaphes, Chansons, préface de Serge Fauchereau, Poésie / Gallimard, 1984, p. 254-255.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe soupault, serge fauchereau, georgia, épitaphes, chansons | ![]() Facebook |
Facebook |
03/11/2011
Bernard Noël, la face du silence, dans Poésie I

au ciel de tête
mon ombre mûre a fait mûrir l'oubli
qui fut moi
cet autre attaché à la roue
ou ce sourire pour mémoire
flottant
laissé
quelqu'un rêve d'une journée durable
vague culminante qui ne retomberait
mais le sang s'arrête à la lisière
et l'idée recule
amer repli
qui préfère la cendre
au diamant immobile
et le seuil aperçu se vitrifie sous l'ongle
tandis que la nuit close se transforme en cri blanc
Bernard Noël, la face du silence [1963-1964], dans Poèmes 1, textes / flammarion, 1983, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la face du silence, oubli, bernard noël, la face du silence, oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
02/11/2011
Jacques Roubaud, Tombeaux de Pétrarque, dans Dors
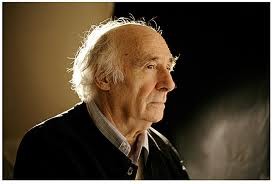
Tombeaux de Pétrarque
cobla I
Ou le soleil mange les étoiles dans l'aube
ou dans la neige tes cheveux prendront rive
comme les vents aux fleuves liés de glace
si des écueils but amer de ma voile
une lumière de collines entre branches
m'écarte neuf j'aborde au cours d'un bois
contre la lune dans tes bois c'est le soir
pas une fleur que la trame de ces notes
poisse les nuits comme rimes à la mort
cobla II
Poisse des fleurs ou dans le style joyeux
si la forêt d'un seul jour sur la terre
s'éveille force de ces vers qui voient l'air
vibrer des yeux s'emplir d'années-laurier
qu'ainsi la pente (la nuit jette les eaux
à ces vallées soit de pluie soit de brume)
partout légère (c'est le prix de ce lieu
nommé le port mais sans navires) : la vie
la nôtre Temps du ciel gavé de feuilles
Jacques Roubaud, Dors, précédé de Dire la poésie, Gallimard, 1981, p. 109-110.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, pétrarque, tombeau, cobla | ![]() Facebook |
Facebook |
01/11/2011
Aragon, Théâtre / Roman
Il y a Marie...
Rien ne vient à sa place dans l'homme, ni les rêves ni sa vie. Si je ferme les yeux, je commence une histoire ou je la reprends. Quelque part, dans la mémoire ou dans l'imagination. La pièce , je me la joue. Peut-être bien seul à la voir. Rien n'est à sa place, rien. Ni l'anecdote ni les années. Ah la chronologie, la chronologie en prend un bon coup. Y mettre de l'ordre. À commencer par le commencement : je suis né en 1926. Je suis un petit meuble d'après l'Exposition des Arts Décoratifs, voilà. Tout de même, quand est-ce donc, par exemple, que j'ai rêvé toute cette affaire dans les bois vers Paris, et ce fichu bordel qui, révérence parlée, surgit les doigts dans le nez. Il n'y a pas d'ordre pour les souvenirs, on y saute à la corde des années... il ne s'agit guère de replacer les faits, j'entends les miens, dans le déroulement des septennats, qui pouvait bien être président de la République quand j'ai perdu ma virginité ? J'essaie plutôt de disposer mon passé suivant le déroulement des femmes, femmes ou pas d'ailleurs, des petites qui sont depuis devenues des femmes, mais pour compter les jours, les années, ce ne serait pas une si mauvaise façon de faire, d'aller de fille en fille. Si on pouvait se souvenir, ne pas en passer. Il n'y a pas, à toutes les époques, la même densité de points de repère. On mêle, on mêle. Par quel bout prendre ma vie, mon théâtre ? Il y a des jours, j'oublie la veille. Pour ne plus voir qu'un temps lointain, soudain réveillé. Je me dis... Qu'est-ce que je me dis ?
Je ne me dis rien du tout. Ce sont elles qui renaissent, celle-ci, celle-là, Morgane, une autre, et l'heure de succession des choses n'en demeure pas moins hasardeuse. C'est tout le temps comme si, à je ne sais quel jeu de cartes, je laissais tomber les miennes, et les ramenant au hasard je ne savais plus trop où j'en étais, dans les années, les amours, le travail, les malheurs. Tout à coup, un paysage, un parfum s'impose. Une chanson revient. Ou une phrase qu'on ne savait même pas avoir entendue, retenue. Les phrases et les femmes, c'est tout un. On croirait pouvoir dater les étapes de la vie. Puis on se souvient d'une robe ou d'un mot : il s'agissait d'une autre. Qui frappe à la porte ? Pas forcément ce personnage sans doute imaginaire. Pas forcément. Une maison. Une couleur, une saison.
Aragon, Théâtre / Roman, Gallimard, 1974, p. 113-114.
Aragon vers 1926
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, théâtre roman, souvenir, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |





