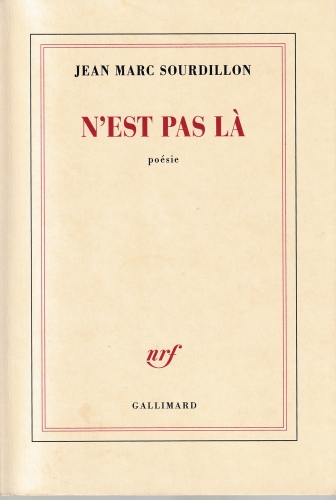15/09/2025
Paul de Roux, Carnets
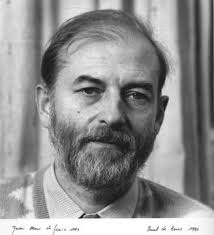
Si je n’écris pas, je me défais. Je me fais d’autant plus en écrivant que j’écris contre le désert, l’impuissance, l’ennui, le dégoût : une horde de bêtes hideuses dont le mufle est plat, le plus banal, le plus terne, le plus impalpable qui soit : cette même puissance qui alourdit et ferme mes paupières, fait dodeliner ma tête — jette sur moi l’envie de dormir comme un filet.
Paul de Roux, Au jour le jour, Carnets 1974-1979, Le temps qu’il fait, 1986, p. 26.
Je relis des poèmes d’Henri Thomas à l’âcreté magnifique. Ici le mot poésie dérape. (Poème est déjà mieux.)
C’est la poésie qui vous tient par la main, le temps d’un poème. Le poète n’existe pas. Car il n’a aucun pouvoir sur la poésie. (Un sabotier mérite d’être appelé sabotier en ce qu’il a le pouvoir de faire des sabots quand il décide de se mettre à son établi.)
Paul de Roux, Au jour le jour, 3, Carnets 1985-1989, Le temps qu’il fait, 2002, p. 141, 142.
On écrit toujours accoté à la mort. On ne le sait pas. On a l’impression que l’on ne pourrait pas écrire accoté à la mort, mais on n’a jamais écrit qu’accoté à la mort. Sans le savoir. Mais le sachant peut-être obscurément ?
Paul de Roux, Au jour le jour, 4, Carnets 1989-2000, Le temps qu’il fait, 2005, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, carnets, se défaire, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2025
Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société

On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s’est fait cuire qu’une main et n’a pas fait plus, pour le reste, que de se trancher une fois l’oreille gauche,
dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et mis en rage,
tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel.
Et ceci n’est pas une image, mais un fait abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la terre.
Et c’est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient dans sa vieille atmosphère de stupre, d’anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d’inertie bourgeoise, d’anomalie psychique (car ce n’est pas l’homme mais le monde qui est devenu un anormal), de malhonnêteté voulue et d’insigne tartufferie, de mépris crasseux de tout ce qui montre race,
de revendication d’un ordre tout entier basé sur l’accomplissement d’une primitive injustice,
de crime organisé enfin.
Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie.
C’est ainsi qu’une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient.
Gérard de Nerval n’était pas fou, mais il fut accusé de l’être afin de jeter le discrédit sur certaines révélations capitales qu’il s’apprêtait à faire,
et outre que d’être accusé, il fut encore frappé à la tête, physiquement frappé à la tête une certaine nuit afin de perdre la mémoire des faits monstrueux qu’il allait révéler et qui, sous l’action de ce coup, passèrent en lui sur le plan supra-naturel, parce que toute la société, occultement liguée contre sa conscience, fut à ce moment-là assez forte pour lui faire oublier leur réalité.
Non, Van Gogh n’était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l’angle de vision, à côté de toutes les peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III.
Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société [début], dans Œuvres, édition établie, présentée et annotée par Évelyne Grossman, Quarto/Gallimard, 2004, p. 1439-1440.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, van gogh, le suicidé de la société, psychiatrie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2025
Antonin Artaud, Silence
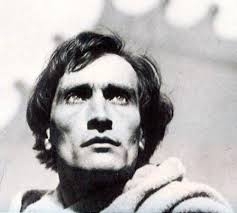
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, silence, ventre | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2025
Antonin Artaud, L'anarchie sociale de l'art
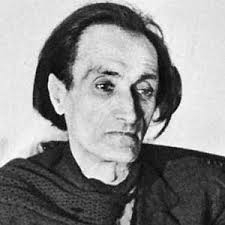
Au cours de la première Révolution Française on a commis le crime de guillotiner André Chénier. Mais dans une époque de fusillades, de faim, de mort, de désespoir, de sang, au moment où se jouait rien de moins que l’équilibre du monde, André Chénier, égaré dans un rêve inutile et réactionnaire, a pu disparaître sans dommage ni pour la poésie ni pour son temps.
Et les sentiments universels, éternels d’André Chénier, s’il les a éprouvés, étaient ni tellement universels ni tellement éternels qu’ils puissent justifier son existence à une époque où l’éternel s’effaçait derrière un particulier aux préoccupations innombrables. L’art, justement, doit s’emparer des préoccupations particulières et les hausser au niveau d’une émotion capable de dominer le temps.
Or tous les artistes ne sont pas en mesure de parvenir à cette sorte d’identification magique de leurs propres sentiments avec les fureurs collectives de l’homme.
Et toutes les époques ne sont pas en mesure d’apprécier l’importance sociale de l’artiste et cette fonction de sauvegarde qu’il exerce au profit du bien collectif.
Antonin Artaud, L’Anarchie sociale de l’art, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1971 et 1980, p. 233.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, l'anarchie sociale de l'art, andré chénier | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2025
Georges Bataille, Le Surréalisme au jour le jour (Sur Antonin Artaud)
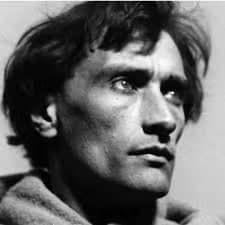
Antonin Artaud
Je le [Antonin Artaud] rencontrai avec Boris Fraenkel dans une brasserie de la rue Pigalle : il était beau, efflanqué, sombre ; il avait assez d’argent, que lui rapportait le théâtre, mais il n’en avait pas moins l’air famélique ; il ne riait pas, il n’était jamais puéril, et bien qu’il parlât peu, il y avait quelque chose de pathétiquement éloquent dans le silence un peu grave et terriblement agacé qu’il observait. Il était calme : cette éloquence muette n’était pas convulsive, elle était triste, au contraire, abattue, intérieurement rongée. Il ressemblait à un rapace trapu, de plumage poussiéreux, ramassé au moment de prendre son vol, mais figé dans cette position. Je l’ai représenté silencieux. Il faut dire que Fraenkel et moi étions alors les personnages les moins loquaces qui soient : cela pouvait être contagieux, de toute façon cela n’entraînait pas à parler. [...]
Quelques années plus tôt, j’avais entendu une conférence de lui à la Sorbonne (mais je n’avais pas été le voir à la fin). Il parlait d’art théâtral et, dans la demi-somnolence où je l’écoutais, je le vis soudain se lever : j’avais compris ce qu’il disait, il avait résolu de nous rendre sensible l’âme de Thyeste comprenant qu’il digère ses propres enfants. Devant un auditoire de bourgeois (il n’y avait presque pas d’étudiants), il se prit le ventre à deux mains et poussa le cri le plus inhumain qui soit jamais sorti de la gorge d’un homme : cela donnait un malaise semblable à celui que nous aurions éprouvé si l’un de nos amis avait brusquement cédé au délire. C’était affreux (peut-être plus affreux de n’être que joué).
Georges Bataille, Le Surréalisme au jour le jour, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1976, p. 179 et 180.
tr
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, le surréalisme au jour le jour, antonin artaud | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2025
Ezra Pound, Cantos et poèmes choisis
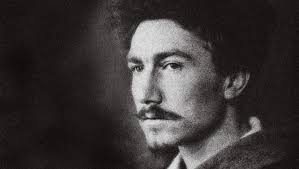
Canto XII
Et nous, assis ici
sous le mur,
Arena romana, de Dioclétien, les gradins
quarante-trois rangées de calcaire
Baldy Bacon
accapara tous les petits sous de Cuba :
Un centavo, des centavos,
disait à ses péons de les « ramasser ».
« Ramenez-les à la grosse cabine », disait Baldy,
Et les péons les ramenaient ;
« Vers la grosse cabine les ramenaient »
Comme aurait dit Henry.
Nicolas Castaño à Habana,
Lui aussi, avait quelques centavos, mais les autres
Devaient payer un pourcentage.
Pourcentage quand ils voulaient des centavos,
Des centavos d’État.
L’intérêt de Baldy
Était dans l’argent.
« Pas d’intérêt pour rien sinon pour le trafic d’argent »,
Disait Baldy.
(…)
Ezra Pound, Cantos et poèmes choisis, traduction
René Laubies, Pierre-Jean Oswald, 1958, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, cantos et poèmes choisis, argent | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2025
verlaine, Sagesse
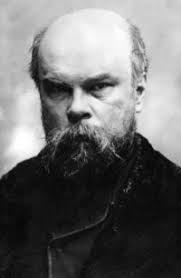
La tristesse, la langueur du corps humain
M’attendrissent, me fléchissent, m’apitoient,
Ah ! surtout quand des sommeils noirs le foudroient,
Uand des draps zèbrent la peau, foulent la main !
Et que mièvre sans la fièvre du demain,
Tiède encor du bain de sueur qui décroît,
Comme un oiseau qui grelotte sur un toit !
Et les pieds, toujours douloureux du chemin,
Et le sein, marqué d’un double coup de poing,
Et la bouche, une blessure rouge encor,
Et la chair frémissante, frêle décor,
Et les yeux, les pauvres yeux si beaux où point
La douleur de voir encore du fini…
Triste corps ! combien faible et combien puni !
Verlaine, Sagesse, illustrations Maurice Denis,
Gallimard, édition fac-similé, 2025, p. 86
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, sagesse, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2025
Verlaine, Sagesse
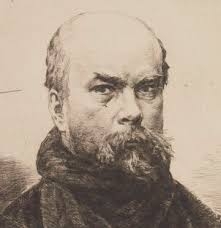
Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D’une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D’une aile d’effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?
Mouette à l’essor mélancolique.
Elle suit la vague, ma pensée,
À tous les vents du ciel balancée
Et biaisant quand la marée oblique
Mouette à l’essor mélancolique.
Ivre de soleil
Et de liberté,
Un instinct la guide à travers cette immensité.
La brise d’été
Sur le flot vermeil
Doucement la porte en un tiède demi-sommeil.
Parfois si tristement elle crie
Qu’elle alarme au lointain le pilote
Puis au gré du vent se livre et flotte
Et plonge, et l’aile toute meurtrie
Revole, et puis si tristement crie !
Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D’une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D’une aile d’effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?
Verlaine, Sagesse, illustrations Maurice Denis,
Gallimard, édition fac-similé, 2025, p. 83-84.
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2025
Paul Verlaine, Sagesse
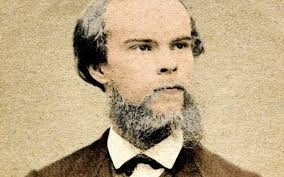
Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles,
Vers les hommes grandes villes,
Ils ne m’ont pas trouvé malin.
À vingt ans un trouble nouveau
Sous le nom d’amoureuses flammes,
M’a fait trouver belles les femmes :
Elles ne m’ont pas trouvé beau.
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave ne l’étant guère,
J’ai voulu mourir à la guerre :
La mort n’a pas voulu de moi.
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Qu’est-ce que je fais en ce monde ?
O vous tous ma peine est profonde :
Priez pour le pauvre Gaspard !
Verlaine, Sagesse, illustrations Maurice Denis,
Gallimard, édition fac-similé, 2025, p. 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, sagesse, orphelin | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2025
Jean-Marc Sourdillon, N'est pas là, : recension
« mords dans le citron vert »
L’absence la plus douloureuse à vivre est sans doute celle d’un proche — compagne ou compagnon, mère ou père, enfant — disparu : le manque de ce qui était vécu dans la vie quotidienne rappelle constamment une présence. Jean-Marc Sourdillon écrit à propos de deux vides de nature différente : d’abord, le départ d’un fils qui n’a plus de raison de rester dans le foyer familial, fils auquel on s’est efforcé de transmettre ce qui pouvait l’aider à être lui-même, conscient de ce qu’il était, qui disparaît brutalement ; ensuite, la mort d’une mère avec qui s’étaient construits un regard sur les choses du monde, peut-être une conception de l’amour, et certainement une partie de ce qu’il était. Le dernier ensemble, plus général et qui donne son titre au livre, s’attache à cerner ce qu’est le manque de repères lié à l’absence.
Un poème prologue, "Nos années-lumière" — 4 strophes de trois vers non comptés — s’écarte de ce qui suit : y est mis en avant le couple qui s’est construit avec, toujours, « Toutes les fenêtres ouvertes sur la terre (…) dans l’immense nuit stellaire sans fin ni commencement (…) et notre œil bien vivant, bien ouvert ». C’est à partir de ce socle, celui de la présence, que sont estimés les vides et d’abord le départ du fils. La rupture est d’autant plus sensible qu’elle a lieu à l’aube, en avion, éléments contraignants pour ceux qui restent puisque le temps de la séparation est compté, sans recours possible. En même temps, cette rupture est dite positive, la vie du fils ne sera plus celle d’un enfant mais d’un adulte autonome et elle est pensée comme telle lors du parcours vers l’aéroport ; le transport est vécu comme une « naissance dans la lumière », la voiture est comme « lavée par la lumière », et pour finir « Nous décollions tous les trois, lui, elle, moi, vers le ciel, cet avenir, cette lumière. La lumière de septembre. »
La disparition met en cause l’existence même de celui qui reste en ce qu’il ne peut penser l’Autre, le fils, comme Autre, mais comme une partie de lui-même, « de tu à l’intérieur ». Le narrateur transforme les rôles, le fils représentant pour lui au plein sens du mot « La fin de [s]a naissance », « comme si c’était lui [le fils] le père ». Ce qui est répété sous différentes formes comme « Je suis né avec lui », « il m’a donné mon nouveau moi ». L’insistance du père à mettre en avant une relation caractérisée par l’idée que le fils est à la source de sa re-naissance explique la violence des effets de la rupture, restituée par le vocabulaire : il devient « coque vide abandonnée », il est « brisé », « explosé », « effondré ». Cette destruction provoquée par le manque s’oppose à la relation heureuse où se vivait la transparence, traduite par une série d’anaphores (« Avoir + partagé, logé, habité, senti », etc.), l’une marquant sans ambiguïté le désir du père — ou sa certitude — d’avoir été "lisible" pour le fils : « Avoir avec lui, devant lui, déposé les armes, les masques, les postures, et surtout celles du langage qui sont les plus dures et qui font mal ». Il est certain que la douleur provoquée par ce vide change tous les aspects de la vie, d’autant plus vivement que rien ne le laissait prévoir, « Avion en plein vol désintégré ». Comment vivre après ?
Là où il n’y avait eu rien, l’absence de tous et de quelqu’un, il y avait de nouveau quelque chose. Quelque chose d’intensément lumineux, mais de révolu, de lointain, d’oublié. Pas pour autant perdu, pas encore perdu. Rappel à l’ordre, à la vie, à la naissance sous la forme d’un deuil, d’un presque deuil.
La lumière du début revient, parce que « l’amour continue. en mémoire ». Il est toujours là aussi pour la mère, « même morte, une mère ne s’efface pas ». Le narrateur a vu sa mère malade, épuisée, acceptant sa solitude et, jusqu’au bout, avec « la faim de vivre » ; il a vu aussi le corps maternel mort, « Du vide sous la forme du plein, une absence de pierre gelée ». Comme son fils, il était parti parce que la rupture était nécessaire, « parce qu’il le fallait, parce que c’est ça, vivre ». Le fils permettait de re-naître, la mère disparue il faut « réapprendre à marcher, c’est-à-dire à faire ressurgir l’origine », reconnue dans une petite photographie — comme si le nouveau-né ne pouvait-être que sur une image à sa taille — où l’enfant et la mère semblent se "reconnaître" comme unité. Une paronomase exprime clairement ce lien, « Tout part de là, tout parle de là ». Aussi forts que l’image témoin, le lien est traduit par la voix, le cri de la naissance et, tout au long de la vie, la voix de la mère, la voix de l’aimée, la voix du père, et encore par la voix de ceux /celles qui font regarder autrement le monde — ici Philippe Jaccottet, Maria Zembrano* — qui, chacune à leur manière, apportent la lumière. L’anaphore, comme dans la première partie, met en valeur cette fonction de la voix, voix « par quoi je se fait et se défait quand il dit qu’il aime ou qu’il le voudrait », une voix « pour sortir de soi ».
La prose du dernier ensemble devient verset, avec la reprise continue de « n’est pas là » : celui, celle qui, comme la mère, a disparu mais reste à tous les moments de la vie présent en soi, donnant toujours sa "lumière", sa voix toujours entendue. C’est pourquoi cette méditation sur l’absence est du côté des vivants. Pour Jean-Marc Sourdillon, la vie demande à sans cesse renaître, à dire « mords dans le citron vert ».
- Jean-Marc Sourdillon a écrit sur l’œuvre de Jaccottet et de Maria Zembrano, qu’il a traduite.
Jean-Marc Sourdillon, N'est pas là, Gallimard, 92 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 juin 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-marc sourdillon, n'est pas là : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2025
Jean Tardieu, Da capo
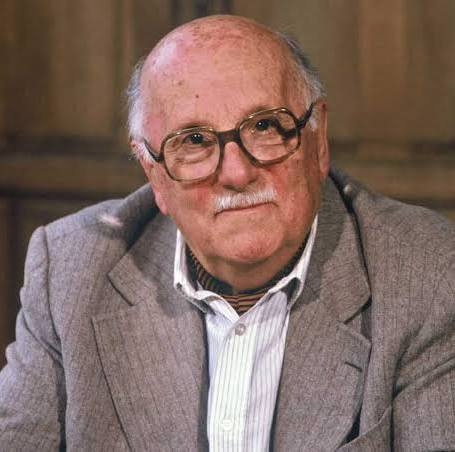
Litanie du « sans »
Et sans visage et sans image
et sans entendre
sans rien attendre
Partout ce rien
partout ce seuil
et sans recours
Mais la splendeur
jamais perdue
qui la retrouve ?
Sans les merveilles
sans les désastres
plus rien qui vaille
Et sans parler
et sans se taire
et la fureur ?
et les délices ?
Et sans rien d’autre
que le même
et qui s’en va
et qui revient
et qui s’en va.
Jean Tardieu, Da capo,
Gallimard, 1995, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, litanie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/09/2025
Jean Tardieu, Da capo
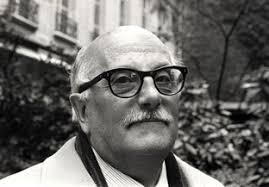
À l’air libre
Pour Marie-Laure
Non je n’exige rien
Vous serez à l’air libre
qui vous protège et vous porte
Prolongé près de cent ans
Je veux dormir sous tes fougères
et non pas caché dans un coffre
sous la pierre
Dans la vapeur de l’Aube
Que la rencontre soit sans fin
près de la forêt légère
où nous avons rêvé souvent
main dans la main
sous un arbre tutélaire
L’espérance de toute vie
c’est l’étendue indéfinie
et non un châtiment
C’est notre lieu de rencontre
Récompense
Vérité
Jean Tardieu, Da capo,
Gallimard, 1995, p. 31-32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, à l'air libre | ![]() Facebook |
Facebook |
03/09/2025
Antoine Emaz, Lichen encore
Photo T. H., 2007
L’émotion laisse sans voix ; le but du poème est de se colleter avec cette expérience de bouleversement, de retrouver les mots comme on reprend pied après avoir été submergé par une vague. C’est pour cela qu’il n’est pas de poésie sans risque. Ce qui s’impose à partir de cette expérience pour ce poème, n’est pas reproductible. D’où la nécessité d’être le plus transparent possible, pour laisser le poème s’écrire. Je ne sais pas ce que ça va être, ce que doit être le poème avant de l’avoir écrit.
Antoine Emaz, Lichen encore, Rehauts, 2009, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, lichen encore, émotion | ![]() Facebook |
Facebook |
02/09/2025
George Oppen, Poèmes retrouvés
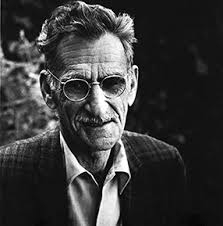
Le nouveau peuple
Occupant de toutes parts
Avec colère peut-être
Le monde des vérandas
Le nouveau peuple des jeunes
Avec leur nouveau style, les pantalons étroits
Des garçons et la coiffure en choucroute
Des filles cette année on dirait une horde
D’envahisseurs
Et c’est bien ce qu’ils sont !
Mais chacun est unique : faille
Tragique. Car ils ne sont pas la véritable
Forêt
Vierge, l’immensité
Le monde minéral
D’où ils proviennent.
George Oppen, Poèmes retrouvés, traduction
Yves Di Manno, Corti, p. 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poèmes retrouvés | ![]() Facebook |
Facebook |
01/09/2025
Jean-Patrice Courtois, Théorèmes de la nature
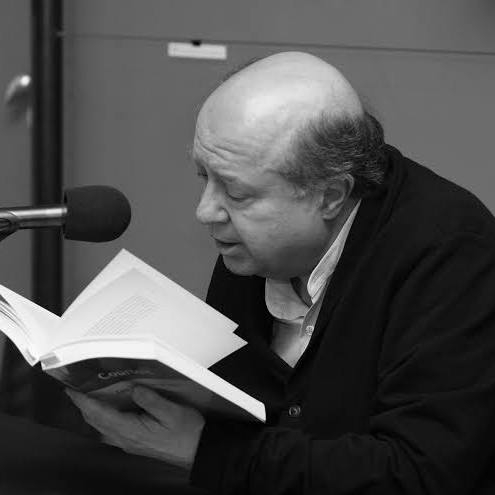
Si le corps est la cachette de la vie au milieu de la carte du monde posée au sol montrant les continents surmontés d’écrans proéminents, d’unités centrales de claviers en rang, de bancs d’immeubles, de régiments pavillons, de dédales urbains, de bidonvilles ratés, de verrues sans identité, carte d’artiste qui ne nomme pas le corps, la cachette ou la vie non plus, casiers blocs sans case s’ajoutant surmontant la carte, alors le nom nommant la carte en image sans lumière n’est pas tourné vers nous. Mais j’ai vu des cartes comme des tribus sans syntaxe.
Jean-Patrice Courtois, Théorèmes de la nature, éditions NOUS, 2025, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean patrice courtois, théorèmes de la nature, cachette, vie | ![]() Facebook |
Facebook |