26/09/2016
Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance

Photo André Perlstein
Une autre fois, il me semble qu’avec plein d’autres enfants, nous étions en train de faire les foins, quand quelqu’un vint en courant m’avertir que ma tante était là. Je courus vers une silhouette vêtue de sombre qui, venant du collège, se dirigeait vers nous à travers champs. Je m’arrêtai pile à quelques mètres d’elle : je ne connaissais pas la dame qui était en face de moi et qui me disait bonjour en souriant. C’était ma tante Berthe ; plus tard, je suis allé vivre presque un an chez elle ; elle m’a peut-être alors rappelé cette visite, ou bien c’est un événement entièrement inventé, et pourtant je garde avec une netteté absolue le souvenir, non de la scène entière, mais du sentiment d’incrédulité, d’hostilité et de méfiance que je ressentis alors ; il reste, aujourd’hui encore, assez difficilement exprimable, comme s’il était le dévoilement d’une « vérité » élémentaire (dorénavant, il ne viendra à toi que des étrangères ; tu les chercheras et tu les repousseras sans cesse ; elles ne t’appartiendront pas, tu ne leur appartiendras pas, car tu ne sauras que les tenir à part…) dont je ne crois pas avoir fini de suivre les méandres.
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994, p. 137-138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d'enfance, guerre, inconnu, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2015
Hilda Doolittle, Pour l'amour de Freud

[...] Le choc réel que m’avait personnellement infligé la guerre de 1914-1919 n’avait pas une chance de guérir. Mes séances avec le Professeur [= Freud] étaient à peine commencées que déjà apparaissaient les signes avant-coureurs et les symboles de l’épreuve qui approchait. Et la chose que je voulais essentiellement combattre à découvert, la guerre, ses causes et effets, avec ses inévitables répercussions de dépressions nerveuses et de désordres neurologiques, fut réactivée en profondeur. Devant la tête de mort de la croix gammée marquée à la craie sur le trottoir et menant à la porte même du Professeur, je dois, en toute décence, calmer aussi bien que je puis ma phobie personnelle, et même avec le peu de pouvoir dont je pourrais disposer, lui ordonner, pour le temps présent en tout cas, de retourner dans sa caverne souterraine.
Là il grandit et mordit ses chaînes et se détacha seulement à la fin, quand les terreurs pleinement apocryphes du feu et du soufre, de la trombe et du déluge et de la tempête, du Jour biblique du Jugement et de la Dernière Trompette, cessèrent d’être des abstractions, de mortelles terreurs inconcevables, mais devinrent des choses qui arrivaient chaque jour, chaque nuit, et pendant un moment à chaque heure du jour et de la nuit, à moi-même et à mes amis, à tout le merveilleux comme à tout le terne et ordinaire peuple de Londres.
Hilda Doolittle, Pour l’amour de Freud, traduit de l’anglais par Nicole Casanova, préface d’Elisabeth Roudinesco, Des femmes, 2009, p. 140-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilda doolittle, pour l’amour de freud, analyse, guerre, nazi, croix gammée | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2015
Jacques Moulin, Journal de campagne : recension
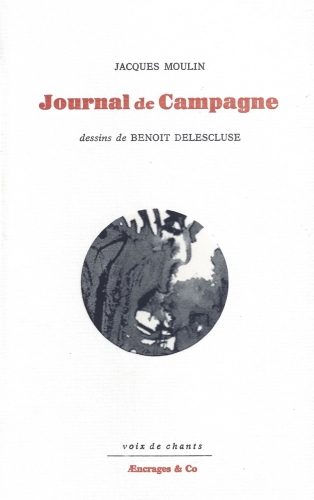
Un journal de campagne, on sait bien que cela évoque les opérations militaires plus que la nature, même si elle est présente : la guerre, quand elle est évoquée, c’est la Grande, celle de 14-18, et sont précisément rappelés des lieux bien champêtres qui furent des lieux de mort, tel le Hartmannswillerkopf, souvent désigné par ses initiales HWK (conservées ici pour titrer 4 poèmes) ou nommé "la montagne de la mort" : éperon rocheux au-dessus de la plaine d’Alsace — « Hécatombe et massacre / Double V pas de veine est ma vie ». Cependant, à travers les souvenirs discrets des combats, l’évocation de paysages de vignobles et de réunions autour d’un verre de Sylvaner, le lecteur est surtout attentif au motif lyrique de la mémoire et, comme à la lecture des recueils précédents, à la manière qu’a Jacques Moulin d’exploiter les ambiguïtés de la langue — c’est-à-dire les ressources avec lesquelles on peut écrire.
Tout d’abord la construction du livre est rigoureuse, ce que l’on ne comprend qu’après la lecture du premier ensemble titré "Cheminement" qui réunit deux poèmes ("Avancée" et "Abri") : le second ensemble, titré "Approches", s’ouvre avec "Place forte" où sont rassemblés une série de termes utilisés pour décrire une forteresse dont quelques-uns, en caractères gras, sont retenus comme titres des poèmes du livre, par exemple ceux que j’ai cités. La variation autour de quelques mots est signalée dans les vers d’un rondel — « On tombe sur des mots qu’on peut envisager / L’alexandrin revient pour chacun les nommer / Canon bastion redoute archère et contrefort / Barbacane bonnette [...] — et, à nouveau, avec humour, dans un « Lexique des titres fortifiés » qui clôt le livre.
On pourrait craindre que des poèmes écrits à partir d’un vocabulaire militaire soient bien peu séduisants, suite de poèmes en vers libres prenant pour prétexte des mots dont le sens, pour la plupart d’entre eux, n’est plus compréhensible à cause de leur technicité, comme "réduit" ou "banquette", mais on voit bien que l’on peut jouer sur leur polysémie. Quand il est difficile d’emprunter des voies de traverse avec un mot, il est toujours possible de s’attacher à la forme même ; ainsi du nom commun "fort" : « F.O.R.T. avec un T qui ne se lie pas. T en tourelle on dit gabion et c’est du guet. Que veut-il prendre aux rets des langues ? », etc. ; « lie » ici se prendra en même temps pour « lit ». Et "fort" appelle évidemment "for", mais Jacques Moulin dans le poème titré "For intérieur" multiplie l’emploi de termes relatifs à la forteresse (fort, fossé, barbelés, ronde, courtines, etc.), y compris à la fin du poème dans la synthèse de ce qu’est ce jugement de la conscience : « Tout est fragile. Vigilance encore mais en fort détaché. »
Dans la série se glisse un rondel, signalé comme tel (« Le rondel bat la brèche et se joue des rebords / Sur le chemin de ronde au plus près des fossés ») ; construit en alexandrins et sur deux rimes selon la règle, son refrain ne comporte cependant qu’un vers et n’est répété qu’une fois. On relève que la reprise d’un vers, dans le livre, est un des moyens de lier les poèmes entre eux — par exemple on notera le retour dans plusieurs poèmes de « On entend la poussière ». Il en est d’autres propres à la poésie de Jacques Moulin. Je pense à son usage des phrases nominales, fréquentes, en cascade, qui donnent mouvement, nervosité(1). Je pense aussi aux jeux phoniques qui consistent à rapprocher des mots qui ne se distinguent que par un son : vestige / vertige ; calvaire /calcaire ; résider / résidu ; pans / pas, ou que l’on rapproche comme enceintes / empreinte ; cisaille /zigzague. Il y a parfois dans ce reprise de cellules sonores un souvenir des Grands Rhétoriqueurs du xve siècle, quand on lit : « Sous l’aile de l’abri bris de mur à coups sûrs . Et s’écoulent les fleuves dans le mugir des plaines » (souligné par moi), ou si l’on prononce : « Si ça te dit ça me dit aussi / Stammtisch ici ».
On pourrait penser à Ponge dans la manière qu’a Jacques Moulin de s’attacher à la lettre du mot, qui ne désigne pas une chose de façon arbitraire, comme tout autre mot, mais parce que sa forme évoquerait cette chose ; ainsi pour "redoute" : « R.E.D.O.U.T.E. comme une redite destinée à souligner un chemin de retrait [...] », ou pour "fort" : « On ne voit guère plus loin que le bout de son T ». Mais un seul poète est nommé, Jaccottet, dont un fragment de prose (d’ailleurs entre parenthèses dans Éléments d’un songe) devient un vers dans le dernier poème : « Tout étoilé d’obscure ignorance / Signé Jaccottet ». Il faut ajouter, en note, François de Sales, à qui est emprunté la graphie "abril" pour "avril", retour au xvie siècle et au jeu des sons avec « Être à l’abri jusqu’à l’avril / L’abril d’avril ». Voilà un livre dans la continuité des livres publiés par Jacques Moulin, avec en ouverture de chacune des quatre séquences un fort suggestif dessin de Benoît Delescluse. Une réussite.
________________________
1. Phrases nominales très nombreuses par exemple dans À vol d’oiseaux, L’Atelier contemporain, 2013.
Jacques Moulin, Journal de campagne, dessins de Benoît Delescluse, Æncrages, 2015, non paginé, 18 €. Cette recension a été publiée en juillet 2015 dans Les Carnets d'eucharis.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, journal de campagne, guerre, ambiguïté, rondel, rhétorique | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2015
Gertrude Stein, Les guerres que j'ai vécues

Aujourd’hui, 3 août 1944, nous sommes allées à Belley, où j’ai anxieusement cherché à voir un « maquis ». Nous avons encore des Allemands ici, et pas de maquis jusqu’à présent. Mais Belley, quartier général du maquis, était malheureusement vide, ils étaient tous en opérations. Je n’en ai vu qu’un, de loin, dans un joli uniforme kaki, avec une patte rouge sur l’épaule. Nous sommes donc rentrées avec la satisfaction d’en avoir vu au moins un. À Belley, on nous a demandé avec surprise si nous avions encore des Allemands. Nous en avons une quarantaine, des cheminots qui gardent la voie, et nous en étions très humiliés. Nous sommes les seuls de la région, à Culoz, à avoir encore des Allemands. Nous sommes donc assez humiliés, et nous disons : « Ce sont des cheminots, qui n’ont plus rien à faire, et pas des soldats. » Les choses vont vite. Il y a trois mois, Belley était une garnison allemande, comptant des milliers de soldats, et, maintenant, il n’y a en plus un. Les gens de Belley ont l’impression qu’il n’y a jamais eu d’Allemands, mais seulement des « maquis ». À Culoz, nous en avons encore, ce qui est un vrai déshonneur.
Gertrude Stein, Les guerres que j’ai vues, traduit de l’américain par R. W. Seillière, Christian Bourgois, 1980, p. 270-271.
Publié dans Akhmatova Anna, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, guerre, maquis allemands, cheminot | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2014
Georg Trakl, Grodek : deux traductions

On peut lire dans le numéro de printemps de la revue de belles-lettres treize traductions d'un poème de Georg Trakl (dont une en tchèque, une en slovène et une en grec). En voici deux :
Grodek
Vers le soir les forêts de l'automne retentissent
D'armes tueuses, les plaines d'or
Et les lacs bleus où s'abîme un soleil
Plus lugubre ; la nuit cerne
Des guerriers mourants, la farouche plainte
De leurs bouches brisées.
Mais sans bruit, dans le creux des pâturages,
Rouge nue où trône un dieu courroucé,
S'amasse le sang répandu, fraîcheur de lune ;
Tous les chemins débouchent dans une noire pourriture.
Sous les ramures d'or de la nuit et des étoiles
L'ombre de la sœur s'en vient par le bois muet, chancelante,
Saluer les âmes des héros,
les têtes ensanglantées,
Et doucement sonnent aux roseaux les sombres flûtes de l'automne.
O deuil où la fierté s'exalte ! O vous autels d'airain !
Une vaste douleur nourrit en ce jour la flamme ardente de l'esprit,
Les descendants non nés encore.
Georg Trakl, Vingt-quatre poèmes, préface et traduction de
Gustave Roud, La Délirante, 1978, dans la revue de belles-lettres, p. 179.
Grodek
Le soir résonnent les fêtes automnales
D'armes et de mort, les plaines dorées,
Les lacs bleus, plus sinistre le soleil
Roule au-dessus d'eaux ; la nuit entoure
Des guerriers mourants, la plainte sauvage
De leurs bouches cassées.
Cependant se rassemble sans bruit dans les pâtures du vallon
De la nuée rouge où habite un Dieu furieux,
Le sang versé, du froid lunaire ;
Toutes les routes débouchent sur la pourriture noire.
Sous les ramures dorées de la nuit et des étoiles
L'ombre de la sœur chancelle à travers le bois silencieux,
Pour saluer les esprits des héros, les têtes ensanglantées ;
Et doucement résonnent dans les roseaux les sombres flûtes de
[l'automne.
O deuil plus fier, vous autels d'airain !
Une douleur puissante nourrit aujourd'hui la chaude flamme de
[l'esprit,
Les descendants qui ne sont pas nés.
Georg Trakl, Poèmes, traduits et présentés par Guillevic, Obsidiane, 1989, dans la revue de belles-lettres, p. 182..
Grodek
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
Und blauen Seen, darüber die Sonne
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht
Sterbende Krieger, die wilde Klage
Ihrer zerbrochenen Münder.
Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewolk; darin ein zürnender Gott wohnt
Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle,
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.
Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen
Es schwankt des Schwester Schatten durch den schweigenden Hain.
Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter;
Und leiser tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes.
O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre,
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,
Die ungebornen Enkel.
la revue de belles-lettres, 2014, I, Lausanne, p. 176.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, grodek : deux traductions, guerre, cadavre, douleur, automne, sœur | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2014
Étienne Faure, Vues prenables

Le temps travaille trop, on est déjà dimanche
ce matin en ouvrant la fenêtre,
il neige en silence, les rues sont d'antan ;
de la ville, la rumeur est absente,
c'est la neige ou la nuit en son cœur qui l'interrompt
— ou la mort, insistante à sonner l'heure,
qui ponctue plus sonore les rêves.
Tout remonte en mémoire, les petits vieux
revenus naguère estropiés, claudiquant,
plusieurs balles dans la peau, des idées
fixées désormais sur les hommes,
qui le dimanche à des poulbots sans église
tendaient des gâteaux, biscuits à la cuiller
trempés dans du vin, leur donnant
sans le savoir le goût du rouge.
Aidés d'un peu d'alcool ensuite ils mourraient
un après-midi dansant
entre les bras d'un fauteuil qui connut leurs étreintes
dimanche, entre deux guerres.
le goût du rouge
Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon, 2009, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, le goût du rouge, neige, ville, dimanche, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2013
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

19-20 mai 1942
Condamné à mort par les Allemands, je prends la chose courageusement jusqu'au moment où l'on me dit qu'on viendra me faire la barbe au début de l'après-midi, dernière toilette avant l'exécution. Cette dernière toilette, événement sur lequel toute mon attention était fixée, m'avait masqué l'événement ultime que serait l'exécution. Or, maintenant que j'en connais l'heure, ma pensée peut aller au-delà, de sorte que je vois disparaître le dernier écran placé entre la mort et moi par ce détail de protocole. Rien ne me séparant plus de l'exécution elle-même, mon courage fait place à une angoisse indescriptible. Je sens que je ne tiendrai pas le coup, que je pleurerai et hurlerai quand on me mènera au poteau.
Je rêve ensuite qu'on publie des souvenirs de mon collègue du Musée de l'Homme, Anatole Lewitzky (fusillé effectivement par les Allemands le 23 février de cette même année). Notant jusqu'à la dernière minute ses impressions de condamné, il raconte comment l'exécution a eu lieu dans une sorte de parc d'exposition désaffecté, aux abords du Mont Valérien. Ses compagnons et lui, on les a fait s'adosser chacun à une reconstitution de case ronde africaine, en pisé ou en argile séchée. Lewitzky raconte que, devant la porte de la case qui lui tiendrait lieu de poteau d'exécution, il y avait sur le sol un poulet ou un squelette de poulet (comme on peut voir en Afrique, sur des autels domestiques, des plumes provenant de volailles égorgées pour des sacrifices, ainsi que des crânes ou mâchoires d'autres animaux). Le texte se termine par une sorte de testament politique ou profession de foi : mots d'ordre, pronostics plein de confiance quant à l'issue de la guerre.
Michel Leiris, Nuis sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 143-144.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuirs sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, angoisse, mort, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |





