31/10/2022
Dominique Quélen, Une quantité discrète

On n’a rien ces mors seuls en français de langue arrivée là si c’est bien elle. Et se casser la gueule aussi sous la férule un plancher déformé qui traîne. Un étui qui se déverse et n’a pour être séparé de peau ni la surface ou prairie dans laquelle il a plu très violemment.. Pénétrant dans l’habitacle immergé les orties qu’on finit par entrer dans ce vase une cachette ou quoi d’autre laissé par inertie tremblant sous l’aspect de papiers minuscules un endroit jusqu’ici qu’un puisard une autre leçon garde un feu des allumettes.
Dominique Quélen, Une quantité discrète, Rehauts, 2022, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique quélen, une quantité discrète | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2022
Pascal Poyet, J’ai dormi dans votre réputation, Traduire mais les sonnets de Shakespeare : recension
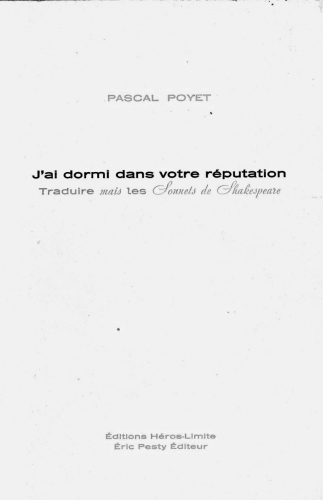
Les lecteurs de poètes contemporains de langue anglaise (David Antin, Rosmarie Waldrop, Lisa Robertson, etc.) connaissent les traductions de Pascal Poyet, mais son nouveau livre intrigue dès l’abord par son titre. Il reprend celui d’une des séquences (p. 93), traduction du cinquième vers du sonnet 83 des sonnets de Skakespeare (And therefore have I slept in your report) — on y reviendra. Quant au sous-titre il s’explique par l’énoncé du projet ; les séquences, deux fois cinq partagées par un interlude, transcrivent des prises de parole, en 2019, aux Laboratoires d’Aubervilliers pour parler de son travail de traduction de ces sonnets : « parler la traduction, plutôt que de parler de traduction », donc traduire, mais, c’est-à-dire considérer ce qui est rapporté comme le moment d’un chantier. La traduction est toujours à construire, avec des retours sur ce qui est d’abord proposé : c’est un « processus » dont le compte-rendu oral est désigné par Pascal Poyet par le mot d'« expositions », à comprendre dans ses différentes acceptions.
Le projet, précisé dans l’avant-propos, rompt avec bien des pratiques. Ce n’est pas la difficulté de traduction qui arrête dans le vers du sonnet 83, mais sa compréhension. Pascal Poyet examine la polysémie du mot « report », recherche ses emplois dans l’ensemble des sonnets de Shakespeare, en relève quatre, toujours à la rime, entreprend des relevés analogues pour le verbe slept (to sleep), puis commente la rime dumb / tomb des vers 10 et 12, examine l’usage du verbe être (being extant, being dumb, being mute (vers 6, 10 et 11), puis des pronoms, ce qui le conduit au sonnet 84 et à une hypothèse de lecture qui pourrait éclairer l’ensemble du recueil et, du même coup, faciliter la compréhension de nombreux sonnets. Ce qui retient à partir de ce très rapide parcours, c’est l’abandon dans un premier temps d’une lecture linéaire au profit d’une circulation dans le poème et dans le livre et le fait de ne retenir que quelques éléments.
On relèvera à plusieurs endroits une démarche analogue ; ici, c’est une répétition qui suscite un examen, « Quelque chose m’a frappé dans ce sonnet : le grand nombre d’occurrences du mot love » ; là, c’est un point d’interrogation au « milieu géographique des trois quatrains » du sonnet 152, en « leur centre ». Le regard, l’oreille peuvent être attirés par une rime (sonnet 105) que l’on n’entend plus aujourd’hui (alone/one) et, de là, il est intéressant de rechercher ce one dans le reste du sonnet : il y apparaît cinq fois et, de plus, on l’entend deux fois dans wondrous « (prononcé one-drous) ». Pascal Poyet relève encore, trois fois reprise, la suite de monosyllabes « Fair, kind and true » (vers 9, 10 et 13). Ces premiers repérages précèdent la lecture attentive et le traducteur conclut « Je ne sais rien d’autre du sonnet 105. Je vais maintenant le lire ».
Cette manière d’aborder un texte à traduire peut surprendre, elle est répétée sous différentes formes tout au long des expositions, « Je ne lis pas vraiment, je regarde », « je ne fais que regarder le sonnet », et parfois la formulation apparaît paradoxale, « On ne passe jamais suffisamment de temps à ne pas lire les textes ». C’est qu’il ne s’agit pas de « traduire » du vers 1 au vers 14, mais toujours d’entrer dans un sonnet à partir d’un « événement de langue » qui permet de tirer des fils pour comprendre ce qui est écrit : ce qui est découvert conduit à remarquer d’autres « événements » et, progressivement, à esquisser une lecture de l’ensemble. Étant entendu, comme l’écrivait Pierre Jean Jouve (traducteur de Shakespeare) cité ici, qu’il faut « prendre connaissance de chaque pièce en la reliant à toutes les autres ». Tenir compte de tous les sonnets conduit à relever tel mot et à comparer son usage dans l’ensemble ; s’il n’est présent qu’une fois (par exemple to misuse thee, « t’abuser »), ce qui ne permet pas de guider une traduction, il reste à consulter le dictionnaire d’Oxford et à choisir avec le contexte.
Être attentif à la totalité des sonnets, c’est considérer qu’ils forment un tout cohérent et non un groupement d’éléments plus ou moins isolés les uns des autres. C’est pourquoi le sonnet 77 mérite une lecture particulière : il est au milieu d’un livre de 154 sonnets, soit 11 fois 14 (= 7 + 7), nombre de vers d’un sonnet. C’est pourquoi Pascal Poyet s’intéresse à « l’instabilité » même du texte de Shakespeare, qui a été corrigé au fil des éditions (un signe diacritique, un mot). Dès que le lecteur cherche à traduire ce que l’auteur a "voulu dire", la tentation est forte de modifier le texte ; dans le sonnet 23, certains traducteurs ont corrigé « books » en « looks », ce qui leur semblait plus en accord à cet endroit avec le propos de Shakespeare, mais une analyse philologique écarte cette transformation. Ne traduire que ce qui est écrit « n’est pas aussi simple qu’on peut le penser. Cela relève parfois de l’enquête ».
L’enquête de Pascal Poyet, que le lecteur suit grâce au texte en annexe des sonnets étudiés, est passionnante par sa rigueur et, il faut le souligner, par le souci constant de partager une démarche qui peut sembler inhabituelle. Les lecteurs pourront comparer la traduction proposée de quelques fragments à celle d’une des nombreuses éditions disponibles : depuis la première traduction complète des Sonnets par François-Victor Hugo, en 1828, les traductions ont été très nombreuses, en prose et en vers (alexandrins, décasyllabes), en vers libres ou rimés, avec un vocabulaire moderne ou archaïsant ; de 2000 à aujourd’hui, on compte une douzaine d’éditions — et l’on attend celle de Pascal Poyet.
Pascal Poyet, J’ai dormi dans votre réputation, Traduire mais les sonnets de Shakespeare, éditions Héros-Limite et Éric Pesty éditeur, 2022, 192 p., 20 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 9 septembre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal poyet, j’ai dormi dans votre réputation, traduire mais les sonnets de shakespeare | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2022
Jacques Lèbre, À bientôt
Qui n’a jamais erré longtemps dans une ville inconnue à la recherhce d’un café à son goût dans lequel il puisse enfin entrer ne peut pas vraiment savoir ce qu’est l’exil.
Une enfance sera toujours vécue de plein fouet.
Bouffées de larmes, parfois proches des yeux ; parfois plus enfouies, dans l’âme.
Le soir, une fois couché, le réveil posé sur le parquet, l’aiguille des secondes cavalcade sans aucune possibilité de retour en arrière. Si l’on y pense, c’est à la fois la catastrophe la plus naturelle et la plus absolue.
Jacques Lèbre, À bientôt, Isolato, 2022, p. 50, 55, 56, 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, à bientôt, exil, larme, catastrophe, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2022
Jacques Lèbre, À bientôt

Un jour on ne sera plus là. Ce là fait pour me retenir à chaque instant et qui, le moment venu, n’en fera rien.
Oiseaux, plus visibles l’hiver. Eux aussi à découvert.
Quand on est dans son propre appartement comme dans la salle d’attente d’une gare.
J’aimerais mourir la fenêtre ouverte, au début d’un printemps doux et nuageux, après qu’il a plu un peu, juste pour sentir encore l’odeur de la terre avant de partir.
Jacques Lèbre, À bientôt, Isolato, 2022, p. 28, 33, 44, 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, oiseau, salle d'attente, terre | ![]() Facebook |
Facebook |
27/10/2022
Jacques Lèbre, À bientôt

À partir de l’écluse de Fleury, un jeune chat a participé un moment à la promenade sur le chemin de halage, tantôt nous suivant tantôt nous précédant. Nous ne nous étions nullement concertés, c’était visiblement un accord tacite.
Comme si vous mouriez toujours, au beau milieu d’un carrefour. Des vêtements sont peut-être restés en désordre sur une chaise, un bol sur une table.
Les rendez-vous notés dans les agendas d’une personne disparue ? Tels ces piquets qui indiquent le tracé d’un chemin pris sous une épaisse couche de neige.
Je peux sans doute lire deux recueils d’un même poète dans une journée, mais passser d’un poète à un autre, non, je ne peux pas. Il faut un certain laps de temps, comme de traverser un tunnel pour passer d’un paysage à un autre.
Jacques Lèbre, À bientôt, Isolato, 2022, p. 19, 20, 22, 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, à bientôt, chat, désordre, mort, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2022
Judith Chavanne, Peut-être des lis

Un long cheminement
Le livre, après un poème liminaire, est partagé en 4 parties équilibrées, "Une syllabe" (4 poèmes), "Stations" (16), "Legs" (4), "Feu les regards" (15), le tout suivi d’un "Envoi" (3). L’ensemble a pour motifs une mère disparue et, à partir de là, le temps passé, enfui et enfoui, la difficulté à vivre la disparition, l’invention d’une autre vie. Le premier poème propose un portrait singulier de la mère ; comparée à une mésange, elle montre deux traits, spirituel et physique, « farouche » et « frêle » — les deux mots sont mis en relief en fin de vers — qui lui donnent son équilibre, comme à l’oiseau sur la branche.
Les derniers jours de la mère et son enterrement ont lieu en décembre ; la neige effacera le nom sur la tombe, comme elle recouvre tout. La narratrice l’imagine « dans un tableau de Brueghel », dans un semblable hiver aux chemins blancs ; la vision s’accorde avec la chambre de l’hôpital où ce qui pourrait rappeler l’extérieur, est banni, « Tout est blanc autour [du lit] ». Blancheur de l’hygiène sans doute, mais aussi de l’absence de couleur et de toute vie. À ce blanc dominant s’opposent les fleurs apportées par la narratrice, jacinthes, mufliers roses et des lis (« je te portais des lis, tu les aimais »), qui ne sont pas toujours blancs. En outre, les trois sœurs sont allées au cimetière en voiture, à nouveau unies par la mère, et, précise la narratrice, c’est « entre nous encore [...] un bâton de rouge à lèvres qui passait », rouge de la vie. Enfin, la tombe est fleurie de violettes : fin de l’hiver, de la neige, renaissance de la nature comme de la narratrice.
La maladie dont on connaît le terme fatal est déjà une sortie de la vie. La mère, soustraite de son univers familier, ses habitudes perdues, fait désormais littéralement partie de son lit, qui n’est « d’aucun monde » : la narratrice le compare à une « barque », souvenir peut-être de la barque des morts de la mythologie, mais barque perçue « à la dérive » et non dans un mouvement tranquille. Trois ans plus tard, le même mois, avec un même « paysage tout hébété de blanc », le deuil est achevé ; les oiseaux reviendront dans le bleu du ciel et ce ne seront pas des « oiseaux effarés », ceux que l’on voyait dans les yeux de la mère malade. Il faut que la disparition ait lieu, qu’elle soit pleinement acceptée pour que toutes les choses du monde retrouvent leur place, ce qu’explicite le dernier vers du livre, « il faut [...] // [...] laisser sur le fleuve les péniches aller ».
La narratrice a progressivement vu dans le lit une autre personne que sa mère ; elle a suivi sa transformation avec la perte de ce qui caractérise une femme (la chevelure, les seins), avec l’amaigrissement, les changements qui annoncent l’extrême vieillesse (« j’ai froid »). Selon les jours, elle était devant un « vieillard », « un petit vieux » ou « une enfant toute petite, « si petite, si frêle ». En même temps, elle savait que cette métamorphose signifiait que sa mère sortait de la vie. Les derniers moments, quand la douleur ne peut être maîtrisée, sont vus comme des « stations » sur le « dernier chemin » — comparaison christique qui souligne ce qu’est la souffrance avant la disparition.
Comment faire pour conserver un lien avec la mère, lien nécessaire pour que sa mort soit pleinement acceptée ? En maintenant une présence par le langage. Ce qui peut faire réapparaître la mère, la réinventer, c’est le pronom "tu" qui devient symbole de vie, comme l’eau « dans les paumes » ou « une écuelle ». Le pronom est alors une "empreinte", un "appel" : « je dis "tu", tu es là ». C’est bien la fonction fondamentale de la langue que d’être dialogale, ce qu’a analysé dans le détail le linguiste Émile Benveniste, « Immédiatement, dès qu’il se déclare locuteur et assume la langue, [le sujet] implante l’autre en face de lui »*. Le mot "tu" abolit provisoirement le temps — la mort — et introduit un mouvement vers l’Autre disparue jusqu’à revenir à un temps que la narratrice ne peut connaître, celui où sa mère la portait, puis la berçait, moments de fusion dont elle n’a pas eu conscience, mais qu’elle recrée, « Nous voilà à nouveau fondues ; / j’étais ta parole de chair ».
L’adresse à la mère, sans réponse, peut se poursuivre longtemps ; la narratrice croit même parfois, quelques instants, reconnaître sa mère dans une femme qui passe, ressemblance mal définie, à partir d’un manteau, d’une coiffure, « Tu surgis au point où tu t’effaces / dans la ressemblance — la différence ». Cependant, les souvenirs s’estompent et le "je" renonce au "tu" qui, alors, ne se maintient que « dans un murmure au creuset de moi ». Judith Chavanne exprime le deuil accompli avec un oxymore, « Tu es devenue une grande éclosion de silence » ; alors les inflexions de la voix de la mère s’oublient, "tu" ne restitue pas la présence, « rien que le langage puisse provoquer ».
Poèmes de la séparation pour continuer à vivre dans lesquels la mère est désormais « insituable, indéterminée », dans une condition qu’elle aurait elle-même pu définir pour les trois sœurs, « il n’y a plus de mère entre vous et vous ». Fin d’une histoire, recréation d’une autre : la narratrice est maintenant comme l’oiseau qui, un jour de neige, trouve la branche qui le protège.
* Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1974, II, p. 82.
Judith Chavanne, Peut-être des lis, Le bois d’Orion, 2022, 70 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 septembre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : judith chavanne, peut-être des lis, deuil | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2022
Gustave Roud, Journal 1916-1976
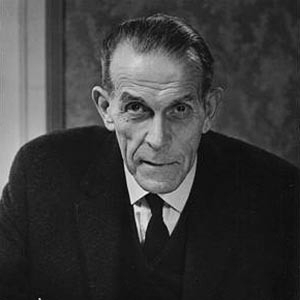
C’est vers la fin de juillet, le temps où les moissons finissent de mûrir, les champs d’avoine ont la couleur bleuâtre d’une eau épaisse et trouble, ceux de froment et de seigle sont encore verts ou déjà devenus jaunes — mais que veulent dire ces phrases ? Ce n’est pas une fin de mois que je veux peindre, ni une journée, mais un seul instant où (tous ces champs, éparpillez-les maladroitement parmi les arbres, les haies ourlées de lumière, qu’ils montent aux collines, se recourbent et plongent aux ruisseaux, déjà purs de toute brume sous la haute lumière) debout dans l’odeur étrange des pavots en fleurs je considère comme on écoute un chant, la double couleur de cet espace de corolles presque transparentes dans le soleil, d’un bleu délicat dans l’ombre qui choit d’un chêne solitaire.
Gustave Roud, Journal, 1916-1976, Zoé, 2022, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2022
Gustave Roud, Journal 1916-1976
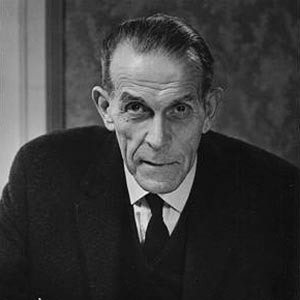
Je pense parfois : c’est ma solitude qui a altéré si profondément ma joie au spectacle du monde. Si jadis (sans que je voulusse l’analyser) elle naissait d’une correspondance que j’établissais entre une passion dominante, un sentiment que l’heure exaltait et tout ce qui entourait ma présence centrale, de plus en plus maintenant elle nécessite pour s’épanouir un calme désespéré, une tristesse sans sursauts où je me sens peu à peu descendre. C’est alors que naît pour ainsi parler mon regard véritable. Posé sur chaque chose, il l’épuise lentement, et je savoure tout objet pour lui-même et pour l’accord qu’il forme avec d’autres sans rien sentir d’autre en moi lui répondre et lui donner un sens ; c’est dire que je ne peux plus traduire, et moins encore interpréter le monde visible, mais seulement transcrire ce qui transparaît sous l’incessante variation de l’heure, de ses éléments éternels, par le sens des mots, leur musique, et le rythme de la phrase, l’âme aussi dépouillée qu’un peintre.
Gustave Roud, Journal, 1916-1976, Zoé, 2022, p. 91-92.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roue, journal, solitude, tristesse, interprétation | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2022
Esther Tellermann, Poèmes inédits, dans L'étrangère, 2022

Vous disiez
qu’un corps
s’interpose entre
le silence
que demeure
l’écho
quand la brume
estompe
les matins. Vous
vouliez les
fables
et les paroles
poudreuses
des mers qui se
rompent
sur le bleu
Esther Tellermann, Poèmes inédits,
dans L’étrangère, n° 56, 2022, p. 175.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2022
Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre : recension
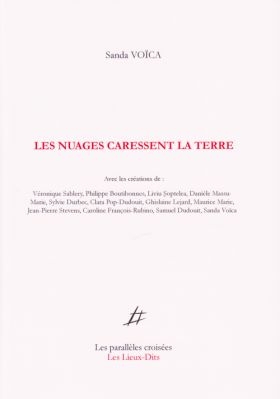
Sauf un, daté de 2018, les poèmes en vers libres du recueil ont été écrits en 2015, l’année de la disparition à vingt et un ans de Clara, la fille de Sanda Voïca, et l’année suivante. Il ne s’agit pas de poèmes pour "sortir" de la douleur, bien plutôt d’une tentative d’écrire un vide impossible à combler. On ne peut pas ne pas penser au vers, certes ressassé, de Lamartine, dans "L’isolement", à propos alors de la femme aimée décédée « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Écrire, sans aucun doute, n’écarte pas la douleur — aucun poème ne peut l’annihiler —, mais constitue un lieu de mémoire indépendant de la tombe où Sanda Voïca a planté un hibiscus rouge qui, notamment, symbolise l’amour et la féminité.
Clara avait offert à sa mère une rose blanche pour son anniversaire, rose qui, contrairement à la rose rouge de son père adoptif, est restée longtemps fraîche dans le vase, comme si la jeune femme avait eu le don de la maintenir dans son premier état ; à partir de ce fait, l’auteure fait comme si sa fille avait les caractéristiques d’une sainte et, de cette manière, lui donne une possible éternité. Ailleurs, elle se réjouit que Clara soit devenue « étrangère » à tous en disparaissant ; devenue autre, elle se serait ainsi « rapprochée (...) de son essence ». Ce sont là des essais, le temps d’un poème, de penser autrement la mort de celle dont elle écrit maintenant : « la moitié de mon corps s’est perdue ». Clara avait-elle des dispositions au-delà de la nature humaine ? non, elle est « Partie, tout simplement », et désormais sans lieu, elle est « aux cieux / ou ailleurs — nulle part ? / ou (...) n’es[t] plus du tout ».
Il y eut d’abord pour l’auteure, au moment de la disparition, l’impossibilité de toute parole organisée ; toute expression ne pouvait être que rejet du réel pour le moins mis à distance puisque toute stabilité était évanouie, « J’ai parlé, parlé, crié, / Dit, redit, maudit, médit ». Entre l’hier et l’aujourd’hui quelque chose s’était rompu qui empêchait de vivre une continuité ; Sanda Voïca évoque « Une fêlure / Une fissure » dans le monde, proche ou non, au point que les jours lui semblaient alors tous « Rebuts et remâchage », que le temps « pass[ait] sans passer », qu’être encore là était seulement preuve de son « inexistence ». Cependant, écrire « ce qui gémit sans cesse / sans qu’on l’entende » éloigne progressivement la violence sans nom qui lui avait été faite ; on peut aussi évoquer avec la même fonction le collage de Sanda Voïca qui ferme le livre, où deux figures féminines se font face, collage titre « Avec Clara (Dialogue) ».
On suit ces lents mouvements de refus de la résignation, de retour avec les autres, sans que l’inacceptable soit accepté. Ce qui ravive la douleur de la perte, c’est de penser à tout ce que Clara ne connaîtra pas, aussi bien « l’extase sous les tilleuls en fleur » que la poésie de Mihai Eminescu, le grand poète romantique roumain. L’absente redevient d’ailleurs fortement présente quand sa tête, dans une vision difficile à supporter, semble flotter dans l’air, elle l’est encore bien plus sur les photos où rien ne peut effacer son sourire qui, chaque fois, fait l’effet de « coups de lance » tant il renvoie à ce qui jamais ne sera plus. Ce qui est très peu supportable dans la vie quotidienne qui continue et contre quoi on ne peut pas toujours réagir, c’est la sottise ou l’indifférence devant une douleur qui ne peut s’estomper ; une tante en guise de consolation assure que Clara est au paradis, celui-ci ne sait parler que de lui et prétend qu’il ne faut vivre, comme lui, que les « bons moments ».
Comment retrouver ne serait-ce qu’un semblant d’équilibre ? En se réhabituant à vivre ce qui fait la vie de tous, la pluie, le jour et la nuit, en relisant Apollinaire, en rêvant de devenir arbre, en pensant aussi que l’écriture contribue à maintenir le souvenir de Clara, « Mon récit, ici — voudrait rendre sa substance, sa chair, ses yeux, ses cheveux » — garder donc plus qu’une trace pour pouvoir, à nouveau « Respirer et regarder : / Le monde est dans l’œil qui vit ». On n’oubliera pas les nombreuses œuvres aux techniques et aux supports variés (dessins, encres, collages, aquarelle, acrylique, etc.) qui accompagnent les textes, elles font de l’ensemble un tombeau poétique, elles ont sans aucun doute aidé l’auteure à ne plus considérer que la vie était « Sueur et larmes ». C’est pourquoi on lit parmi les derniers vers une annonce d’autres livres, « Le ciel, mon miroir, / Les mots, mon ciel. / L’écritoire — ma terre. »
Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre, Les Lieux-Dits, 2022, 90 p., 18 €, Avec des œuvres de P. Boutibonnes, S. Dudouit, S. Durbec, C. François-Rubino, G. Lejard, M. Marie, D. Massu-Marie, C. Pop-Dudouit, V. Sablery, L. Soptelea, J-P. Stevens, Sanda Voïca. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 septembre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, les nuages caressent la terre | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2022
George Trakl, Les étapes de la démence...

Les étapes de la démence aux chambres noires,
Les ombres des vieillards sur le seuil de la porte ouverte,
Quand l’âme d’Hélian se mire au miroir rose
Et que choient la lèpre et la neige de son front...
Les étoiles au mur se sont éteintes
Et les blanches figures de la lumière.
Voici que montent du tapis les ossements des sépulcres,
Le silence des croix écroulées sur la colline,
La douceur de l’encens dans le vent pourpre de la nuit.
Ô prunelles broyées aux bouches noires !
Quand solitaire et doucement vaincu par les ténèbres
Le petit-fils rêve à sa fin obscure,
Le Dieu de paix sur lui penche l’azur de ses paupières.
Georg Trakl, traduction dans Gustave Roud Œuvres complètes, 2,
éditions Zoé, 2022, p. 851
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Trakl, Georg | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george trakl, démence, vieillard | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2022
Ambrose Bierce, Épigrammes

Un auteur populaire est quelqu’un qui écrit ce que pense le peuple. Le génie les invite à penser autre chose.
Chrétiens et chameaux accueillent leurs fardeaux à genoux.
La seule distinction que récompense la démocratie est un haut degré de conformité.
L’amour est une attention détournée : de la contemplation d’un pêtre on en vient à considérer son rêve.
La Jeunesse regarde en avant, car il n’y a rien derrière ; la Vieillesse regarde en arrière, car il n’y a rien devant.
On peut se savoir laid, mais il n’existe pas de miroir pour le comprendre.
Ambrose Bierce, Épigrammes, traduction Thierry Gillybœuf, éditions Allia, 2014, p. 26, 27, 29, 31, 43, 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ambrose bierce, épigrammes, auteur, démocratie, laideur | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2022
Ambrose Bierce, Épigrammes

Le premier homme que vous croiserez est un imbécile. Si vous pensez le contraire, interrogez-le et il vous le prouvera.
Des deux types de folie passagère, l’une s’achève dans le suicide, l’autre dans le mariage.
Faute d’yeux derrière la tête, nous nous voyons au seuil de l’horizon. Seul celui qui accomplit cet acte remarquable consistant à se retourner sait qu’il est le personnage central de l’univers.
L’amour est une charmante balade d’un jour. À la toute fin, embrassez votre compagnon et prenez congé de lui.
Si vous voulez lire un livre parfait, écrivez-le.
Ambrose Bierce, Épigrammes, traduction Thierry Gillybœuf, éditions Allia, 2014, p. 13, 15, 19, 20, 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ambrose bierce, épigrammes, folie, imbécile, amour, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2022
Feuilles tombées
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : feuilles tombées | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2022
Julia Lepère, Par elle se blesse

Elle dit
J’ai connu des hommes pour diviser les heures
J’ai connu des hommes jouissant sans demander en laissant le soleil m’aveugler j’ai connu des hommes qui s’étranglaient pour jouer qui me giflaient pour jouer j’ai connu des hommes qui n’aimaient pas me faire l’amour des hommes ensommeillés avec l’ambition des choses à faire et des pulsions de mort dans leurs masques de perles les défauts de leurs veines les faisaient se gonfler qui chantaient fort leur crime et appelaient leur mère des hommes emprisonnés et ils traçaient chaque jour de leur bâton un trait après la femme tuée j’ai connu des hommes alcooliques et drogués des hommes partant dans le désert d’Espagne pour y halluciner pour composer des vers des symphonies cherchant tous les dérèglements [...]
Julia Lepère, Par elle se blesse, Poésie/Flammarion, 2022, p. 107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia repère, part elle se blesse, homme | ![]() Facebook |
Facebook |










