16/01/2021
Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein

[...] Moi non plus je n’aime pas les promenades, mais avec des amis, je fais des promenades, et de telle manière que ces amis s’imaginent que je suis un promeneur passionné, car je me promène toujours de manière si théâtrale qu’ils n’en reviennent pas. Je n’ai absolument rien d’un promeneur, et je ne suis pas davantage un ami de la nature, ni quelqu’un qui connaît la nature. Mais quand des amis sont à, je marche de telle manière qu’ils s’imaginent que j’aime me promener, que j’aime la nature et que je connais la nature. Je ne connais absolument pas la nature et je la déteste parce qu’elle me tue. Je ne vis dans la nature que parce que les médecins m’ont dit que si je voulais survivre, il fallait que je vive en pleine nature, c’est la seule raison. En réalité, j’aime tout, sauf la nature, car la nature me met mal à l’aise, et j’ai appris à connaître dans ma chair et dans mon âme ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, et comme je ne peux contempler ses beautés qu’en songeant en même temps à ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, elle me fait peur et je l’évite tant que je peux.
Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein, traduction Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1985, p. 74-75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, le neveu de wittgenstein, promenade, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2021
Elias Canetti, Histoire d'une jeunesse, La langue sauvée

Lectures de jour et lectures de nuit
[Ma mère] vivait dans l’attente du soir, plus précisément d el’heure où nous serions au lit et où elle pourrait retourner à sa lecture. C’était l’époque où elle lisait Strindberg. Je restais éveillé dans mon lit et je voyais, par-dessous la porte, le reflet de la lumière en provenance du salon. Elle était là, agenouillée sur sa chaise, les coudes plantés sur la table, la tête reposant sur le poing droit, devant elle, une haute pile de volumes jaunes, les œuvres de Strindberg. À chaque anniversaire et à Noël, la pile s’augmentait d’un volume, c’était l’unique chose qu’elle souhaitait recevoir de nous. Je n’avais pas le droit de lire ces livres et
cela me mettait dans tous mes états. Cependant je n’en ouvris jamais aucun à son insu. J’aimais cette interdiction et il me semble d’ailleurs que j’étais d’autant plus fasciné par les livres jaunes qu’il m’était défendu de les lire. Rien ne me rendait plus heureux que de lui faire présent d’un nouveau volume dont je ne connaissais que le titre.
Elias Canetti, Histoire d’une jeunesse, La langue sauvée, traduction Bernard Kreiss, La Livre de Poche, 1984, p. 230-231.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elias canetti, histoire d’une jeunesse, la langue sauvée, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2021
Christian Enzensberger, Essai de quelque envergure sur la crasse

Quand je déclare que je suis juif, il se produit ceci : à ces trois mots monosyllabiques apparaît dans l’air une minuscule boule blanche élastique, à peu près de la grosseur d’un pois, entre mon visage et celui de mon interlocuteur, et lui bondit dans la bouche. Là-dessus, cette bouche se ferme, une espèce de jalousie descend de la naissance des cheveux sur le visage, ce qui fait que la petite boule emprisonnée sautille à présent à l’intérieur entre jalousie et occiput en toupillant dans un va-et-vient continuel. Par l’effet de la gravitation, chaque ricochet s’y situe un soupçon plus bas que le précédent, la menue boule perd graduellement d’altitude et de latitude, par conséquent, elle baisse tout en toupillant toujours plus vite jusqu’à s’engager finalement dans le gosier où elle est alors avalée sans préjudice de son toupillement. À présent la jalousie se relève, se retire à sa place habituelle sous la boîte crânienne, la bouche s’ouvre et commence à parler, mais à aucun prix, sous aucun prétexte du phénomène qui vient de se dérouler.
Christian Enzensberger, Essai de quelque envergure sur la crasse, traduction Raymond Barthes, Gallimard, 1971, p. 105-106.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian enzensberger, essai de quelque envergure sur la crasse, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
13/01/2021
Peter Altenberg, Esquisses viennoises

[...] La plupart du temps cela donne : « Savez-vous ce que dit le célèbre - - - ? » ». Mais personne au monde ne connaît ce nom-là. Et d’ailleurs personne n’est curieux de savoir ce qu’a dit le célèbre - - - , de toute façon ce serait quelque chose d’irritant, dicté par d’autres points de vue.
La mère considérait ces citations, que le père prenait dans la Revue, comme une mauvaise habitude, comme renifler ou pire encore - - - ». Le fils, lui, pensait : « Derniers mouvements d’ailes d’un vieil oiseau fatigué, laisse donc faire - - - . Serais-tu le comte Mirabeau ?! »
« La soupe est comme elle est - - - » pensait la mère. Elle coûte assez cher et la génération précédente se portait bien. Je ne vois pas le résultat de toutes vos histoires. Maintenant vous êtes obligés d’aller tous les ans chez le dentiste - - - . Une soupe doit être chaude - - - » .
Il y eut ensuite le filet avec différents légumes, masse blanche peu appétissante, du chou-fleur, une sorte de purée glauque, de petites carottes tendres, pointues et rougeâtres, et des pommes de terre râpées à la machine et bien dorées. Le tout ressemblait à un parterre de fleurs.
Peter Altenberg, Esquisses viennoises, traduction Miguel Couffon, Pandora / Textes, 1982, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter altenberg, esquisses viennoises, scène de famille, repas | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2021
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

Reflet 1
Lèvres dévastées, le rouge vif déborde, les yeux sans fin au contour aguicheur, elle s’accroupit (pagne mauve lèvres offertes tee-shirt près du corps), regarde au loin, les traces noires autour des yeux, sourcils maladroitement repeints de la main d’une enfant, la lumière opaque, moue d’une fillette, rayons roses sur le corps, secret de la paille autour de ses cuisses refermées, elle s’imagine de l’autre côté du miroir.
Reflet 2
Les draps noirs sur les seins, dessein caché de l’autre monde. La dentelle d’une bretelle soutient la gorge dorée, dorure éternelle, les cheveux blonds, délavés par temps orageux, embroussaillés, sa bouche enflammée, le rouge dévie, regard docile presque doux (les pleurs ou le discours indicible d’une nuit blanche) elle tient au cœur du corps le drap froissé, elle, blonde à gémir, l’œil glauque et langoureux, désir tiède de l’autre corps, luxure des lumières, l’éclat de sa peau, en plein jour, émaillée.
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion, 1997, p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, reflet | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2021
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Tu m’aimas dans la fausseté
Du vrai — dans le droit au mensonge,
Tu m’aimas — plus loin : c’eût été
Nulle part ! Au-delà ! Hors songe !
Tu m’aimas longtemps et bien plus
Que le temps. — La main haut jetée ! —
Désormais :
-
-
-
-
-
-
- Tu ne m’aimes plus ! —
-
-
-
-
-
C’est en cinq mots la vérité.
12 décembre 1923
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de Tentative
de jalousie, traduction Pierre Léon et Ève Malleret,
Poésie / Gallimard,1999, p.119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, suivi de tentative de jalousie | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2021
Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre : recension

Le lecteur dispose aujourd’hui d’une édition complète des poésies de Jehan Rictus, de son autobiographie et même de son journal pour 1898 et 1899*, mais le 555ème volume de la collection Poésie de Gallimard est bienvenu, il rassemble ses deux principaux livres. Leur contenu donne une idée précise de ce qu’était une partie des textes lus dans les cabarets à la fin du XIXème siècle ; en outre, le rejet total du capitalisme par l’auteur peut rencontrer aujourd’hui bien des échos.
Avant d’entrer dans Les Soliloques du pauvre, il est bon de lire la préface et la notice biographique de l’éditrice du volume pour situer Jehan Rictus dans son temps. Jehan Rictus (1867-1933), né Gabriel Randon, choisit tardivement son pseudonyme, sans doute lié à un vers de Villon (« Je ris en pleurs ») mais peut-être, selon Patrice Delbourg, anagramme approximative de "Jésus Christ". Élevé par sa mère, battu et humilié, il file à Paris à dix-huit ans, écrit des poèmes, fréquente la bohème et connaît la misère, celle qui sera plus tard au centre de ses écrits ; il est remarqué et encouragé par José de Hérédia, Albert Samain et protégé par Leconte de Lisle. Il fréquente les anarchistes, abandonne le vers parnassien pour une forme bien présente dans les années 1880, celle du monologue en vers à dire dans les cabarets. Les poèmes sont alors en vers (l’octosyllabe domine) comptés et rimés ; ils tentent de restituer un parler paysan, avec des mots en patois, comme chez Gaston Couté (« Bon Guieu ! la sal’ commune ! À c’souère, / Persounne a voulu m’ar’cevouèr / Pou’ que j’me gîte et que j’me cache / Dans la paille, à couté d’ses vaches »). Plus souvent, c’est le parler parisien qui est le modèle à imiter, comme par exemple dans les poèmes d’Aristide Bruant, « Moi, je n’sais pas si j’suis d’Grenelle / De Montmartre ou de la Chapelle, / D’ici, d’ailleurs ou de là-bas / Mais j’sais ben qu’la foule accourue, / Un matin m’a trouvé su’ l’tas / Dans la rue » ("Dans la rue").
Jehan Rictus pratique de façon beaucoup plus systématique l’élision pour mieux traduire une manière de s’exprimer qu’il a bien connue. Le début du Soliloque du pauvre réunit à peu de choses près les transformations opérées. Le e disparaît souvent, y compris à l’intérieur d’un mot (« lanc’ments ») et entraîne aussi celle du r, du l en finale (« mett’, peint’s, muff’ »). Sans entrer dans le détail linguistique des modifications, on peut en énumérer quelques-unes qui indiquent que Jehan Rictus a transcrit fidèlement le parler du milieu ouvrier parisien tel que les études de la dernière partie du XIXème siècle en donnent l’image : ceux devient « ceuss », ou = « ousque », métier = « méquier », tiens = « quien », le monde = « eul monde », manière = « magnièr’ », une = « eune », plus = « pus », les employés = « les empoyés », millions = « meillons », il y a un = gna z’un », je vais = « j’vas » , etc. Le vocabulaire emprunte à ce que l’on désigne toujours par "français populaire", une partie des mots relevés est sortie de l’usage (« purotain » = miséreux, « se faire balader les rognons »), contrairement à la plupart d’entre eux, comme « carapater, gambiller, bath, mendigot, vieux birbe, bouffer, dèche, briffer, plaquer, claquer, foutre », etc. Pour Jehan Rictus, cette restitution d’une langue parlée est en accord avec les contenus quand on se veut, comme l’écrit Patrice Delbourg, « le chantre des vaincus, des trahis, des réprouvés, des sans-espoir » — cela ne l’empêchait pas d’employer des mots étrangers au vocabulaire commun ou d’introduire des allusions à la bible hébraïque.
Jehan Rictus est résolument du côté des miséreux, des sans-dents (comme disait l’autre énarque), non pour gagner de l’argent comme, par exemple, Victor Hugo (« Nous avons not’ Victor Hugo / Qui a tiré des mendigots / D’quoi caser sa progéniture »), ni pour se faire élire puisque, pour être populaire, « l’moyen l’pus pratique / C’est d’chialer su’la Pauvreté ». Défendre les pauvres, c’était la mission qu’avait, selon Jehan Rictus, le Christ auquel il consacre un long monologue ("Le Revenant"), dit au cabaret du Chat noir et qui le fit sortir de la misère. Le Christ, donc, revient, accomplissant le vœu du narrateur qui le rencontre un soir dans la rue ; image traditionnelle, il est pâle et triste : « T’as tout à fait l’air d’un artiste ! / D’un d’ces poireaux qui font des vers » ; après avoir constaté avec lui qu’il n’intéressait plus personne, le narrateur lui propose un travail, aux Halles, et Jehan Rictus aborde l’une des questions politiques des années 1890, l’antisémitisme : où le Christ peut-il aller ? « N’va pas chez Drumond on t’bouffrait / Après tout tu n’étais qu’un youtre ! » Il rappelle que le Christ promettait le « Royaume des cieux » aux pauvres, mais : « C’est avec ça qu’on nous empaume », et il conclut « L’Homme doit êt’ son Maître et son Dieu ».
Il y a un radicalisme chez Jehan Rictus qui s’exprime notamment dans une lettre à Léon Bloy dans laquelle il dénonce le sort des ouvriers avec le capitalisme : « Tout vaut mieux, même le retour à la barbarie, à la caverne primitive, qu’une pareille organisation sociale ». Il rêve sans illusion d'ouvrir un lieu, une « Maison des Pauvres », « pour les vaincus... les écrasés, / Les sans espoir... les sans baisers ». Le Cœur populaire, écrit « en langue populaire », rassemble les poèmes écrits entre 1900 et 1913 et s’ouvre, significativement, par une "Idylle" : la déclaration d’amour (« Mom’, c’que t’es chouatt’ ! Mom’, c’que t’es belle ! ») est suivie d’un tableau de la vie possible du couple qui exclut que la femme soit poussée à se prostituer, « Jamais je n’te mettrai su’ l’tas ». Ce n’est pas le seul poème qui défend la dignité de la femme pauvre ; "La grande Irma", un des poèmes écrit sans élision, est une adresse d’un homme à sa mère qui s’est prostituée pour qu’il puisse faire ses études et il promet un engagement, « Désormais j’aurai ma chimère / et rêverai d’une Patrie /où la Femme ne sera plus / traquée, vendue, forcée, flétrie, / à l’abri de nos trois couleurs ». Parmi d’autres poèmes, "Conseils" a une valeur particulière puisqu’il s’agit d’inciter les ouvriers à gagner eux aussi leur dignité, d’abord par la propreté, l’hygiène, pour refuser une image répandue, y compris en effet dans les romans de Zola.
La veine de Jehan Rictus s’est tarie après la première Guerre mondiale, cependant ses poèmes rageurs, à l’écart de tout engagement politique — le"ni dieu ni maître" de l’anarchisme — , témoignent d’une époque, les années 1880-1890, où la violence de l’État s’exerçait contre le monde ouvrier bien plus qu’aujourd’hui — faut-il rappeler la fusillade de Fourmies (dix morts) contre ceux qui réclamaient pacifiquement la journée de huit heures ?
La lecture de Jehan Rictus est ici facilitée par un glossaire qui ne laisse rien passer. L’éditrice a ajouté une bibliographie et des poèmes absents de l’édition qu’elle a retenue : un travail rigoureux, complété par la préface toute de sympathie de Patrice Delbourg.
Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre, suivi de Le Cœur populaire, édition Nathalie Vincent-Munnia, préface Patrice Delbourg, Poésie/Gallimard, 2020, 402p., 9, 50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 décembre 2020.
* Poésies complètes, La Part commune, 2012 ; Fil de fer [autobiographie], La Part commune, 2011 ; Journal quotidien 1898-1899, Claire Paulhan, 2015.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jehan rictus, les soliloques du pauvre, suivi de le cœur populaire | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2021
Raymond Queneau, Fendre les flots

La moule de l’estuaire
Collée au pilotis sapeur sachant saper
se balançant aux sons de l’orchestre tzigane
la bestiole paisible aime la société
les remous de la mer et le contact des algues
et la caresse des vagues inextinguibles
elle dort bien tranquille étant incomestible
longtemps longtemps longtemps elle pourra bercer
sa placide nature au flonflons des violons
Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,
1969, p. 116.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, la moule de l'estuaire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2021
Raymond Queneau, Battre la campagne

Le citadin aux champs
Abuser du temps qui passe
soustraire l’air d’une souris
piocher dans le beurre en motte
atteindre l’eau d’un coup de scie
piétiner l’or de la crotte
étreindre le blé sans épis
insulter mouche qui trotte
sermonner les poux des brebis
abuser du temps qui passe
voilà tout ce qu’à la campagne
fait le monsieur de Paris
Raymond Queneau, Battre la campagne,
Gallimard, 1968, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2021
Raymond Queneau, Courir les rues

Tous les parfums de l’Arabie
Il y avait un passage Waterloo
on l’a démoli
c’est qu’on est patriote à Paris
alors pourquoi une rue Jules César
l‘ennemi juré des Gaulois
ces ancêtres
elle se musse non loin de la gare de Lyon
et quel air banal
soudain cette odeur
plantes aromates épices tropiques
effluves fragrances botaniques
garrigues de Provence jardins d’Ispahan
je fonce et flaire
le CPM fondé en 1901 m’attire
le CPM c’est-à-dire
l’omptoir harmaceutique oderne
mais non ce n’est pas là
je fonce et flaire et découvre
Les Bons Producteurs
vente en gros
herboristeries de toute provenance
Les Bons Producteurs
ont la bonne odeur
mais elle ne va pas plus loin que le boulevard de la Bastille
en face de l’autre côté du canal
s’assirent sur un banc Bouvard et Pécuchet
comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés
Raymond Queneau, Courir les rues, Gallimard, 1967, p. 155-156.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, courir les rues, tous les parfums de el'arabie | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2021
Bernard Noël, L'été langue morte
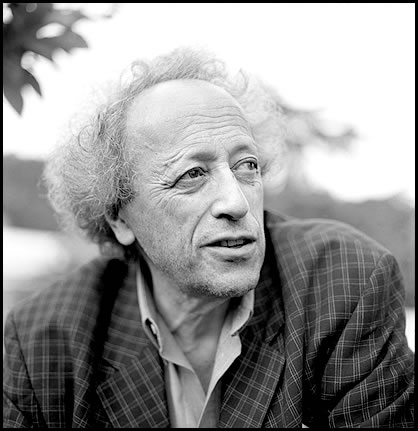
L’été langue morte
Chant I
le monde n’est pas fini
et quand le vent se ève
notre visage est différent
l’amour défait l’amour
pour devenir plus que lui-même
qui va mourir
sait que la beauté est inexorable
je regarde ton souffle
tu t’évapores
l’obscur du temps est un ongle
derrière l’œil
il faudrait tenir sa langue
jusqu’au commencement du monde
la lumière est terrible
la mer ressasse
tu cherches un point parmi le jour
le présent est sans but
sans contour
et le sommet des pierres
ne connaît pas leur ombre
(...)
Bernard Noël, L’été langue morte, dans
Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P.O.L, 2010, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, l’été langue morte, les plumes d’Éros | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2021
Pierre Reverdy, Sable mouvant

Clair mystère
Par-dessus le portique où s’enroule la treille et ou chante l’oiseau — À la fenêtre où se dressent une tête et un buste immobile. Derrière le mur qui penche et l’air qui s’éblouit, un œil à demi clos qui attend le signal.
Pierre Reverdy, Sable mouvant, Poésie / Gallimard, 2003, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, sable mouvant, clair mystère | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2021
Jules Renard, Journal, 1887-1910

Prononcer vingt-cinq aphorismes par jour et ajouter à chacun d’eux : « Tout est là ! »
La mélancolie soudaine de celui à qui l’on dit : « Vous savez que je pars en voyage ? »
Les enfants devraient être des apparitions facultatives.
J’aime lire comme une poule boit, en relevant fréquemment la tête pour faire couler.
Si vous pensez du bien de moi il faut le dire le plus vite possible, parce que, vous savez, ça se passera.
Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 202, 203, 203, 205, 206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, aphorisme, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2021
Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il a chassé le naturel : le naturel n’est pas revenu.
Soyez tranquilles ! nous qui avons peur de la mort, nus mettrons toute notre coquetterie à bien mourir.
Vivre et juger sa vie : quel est l’homme capable des deux ?
Il n’y a pas d’amis : il y a des moments d’amitié.
À sa pièce, on lui serra la main comme pour l’enterrement d’un être cher.
Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 195, 196, 196, 197,198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, naturel, amitié | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2021
Georges Lambrichs (1917-1992), Les Rapports absolus

C’est le geste qui coûte
Une grande froideur fait le jeu de l’histoire, notre destin s’y trouve mêlé et, hâtivement, nous adoptons par mimétisme, un souci logique, vulgaire, bien étranger à notre être qui est composé de fluides et d’humeurs. Je n’en veux, ici, ni à la morale, ni à l’immoralisme tapageur (dont on a pu voir les éclats déjà anciens, divulgués, les réussites esthétiques). Je dis seulement que l’être, notre nature, ne répondent pas à la parole, aux commandements graves, et que l’usage de la parole qui est essentiellement calculateur et médiateur ne véhicule pas la passion, mais qu’il la cogne. Si la vérité est un sens, la passion doit être mise en théorie, et le malheur est donné par surcroît.
(...)
Georges Lambrichs, Les Rapports absolus, collection Métamorphoses, Gallimard, 1949, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, les rapports absolus, geste, maheur, réussite | ![]() Facebook |
Facebook |





