16/08/2011
Jude Stéfan, Grains & issues
Littré, cher à Stéfan comme il le fut à Ponge, définit les issues comme « ce qui reste des moutures après la farine, comme le gros et le petit son ». Le titre, Grains & issues, déjà utilisé par Tzara en 1935 (avec et), évoque donc des éléments de nature diverse,
issues comme « ce qui reste des moutures après la farine, comme le gros et le petit son ». Le titre, Grains & issues, déjà utilisé par Tzara en 1935 (avec et), évoque donc des éléments de nature diverse,
ce que confirme le sous-titre, Variété ; ici VIII : dès 1995 Stéfan faisait paraître un livre titré Variété VI, dans la lignée de Variété V de Valéry (paru en 1944) et réunissant entretiens, notes, traductions, lettres, dialogues. C’est à ce Valéry, « l’esprit supérieur, le sceptique, le moraliste » que se réfère Stéfan. Le volume réunit trois types d’écrits dont on connaît par ailleurs des publications séparées, un Anti-journal, des Scholies & apostilles et un ensemble titré Varia.
Pour commencer, un anti-journal — anti- parce que ne s’épanchant jamais sur le quotidien, mais réunissant, pas toujours sous une date, des anecdotes, des propos entendus au café (« Vieux, on ne dort plus. On rêve… à la mort ! »), des remarques qui donnent parfois de Stéfan l’image d’un misanthrope (qu’il n’est pas vraiment) et d’un misogyne (qu’il paraît être dans ses textes — goût affirmé de la provocation). Citons-en quelques-unes : « Nécessité. Une femme, sans autres défauts, aura néanmoins ceux de son sexe — comme l’ânesse de Stevenson », « À Térence. Rien de ce qui est humain ne m’est proche ». Dans ces quinze brèves pages de journal pour deux années, on lit aussi des réflexions qu’aurait pu écrire Joseph Joubert, comme : « Étymologie. Enseigner, c’est signaler — ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut examiner ». On retrouve aussi, toujours intacte, la passion de la littérature, fondement de la vie de Stéfan : « Littératurite. La seule question qui pouvait l’intéresser : que lisez-vous actuellement (quelle est votre autre vie) — le reste allant de soi ? Nés pour mourir entre les deux la vaine métaphysique ».
Les Scolies & Apostilles réunissent des préfaces et 4ème de couverture écrites pour des poètes qu’il défend (Jeanpyer Poëls, Nicolas Styczynski, par exemple), ou reprennent des notes de lecture, publiées ou non. Elles sont des hommages (un portrait de Perros) ou constituent les éléments dispersés d’un "art poétique", analysant cursivement le travail de Zanzotto sur la langue ou l’importance de Ponge et de ses proêmes, dégageant avec acuité ce qui importe dans les vers de Beckett (si peu lus !) : « l’aveu que versifier, c’est rimer, faire jouer les vocables en écho, s’amuser du sérieux métrique (…), qu’écrire est la seule possibilité pour un mort en sursis d’évoquer un mort accompli, lui donner une pensée ». Cette analyse, à très peu près, peut s’appliquer à la poésie de Stéfan. Relecture aussi de 93 de Hugo, où Stéfan repère « un passage incessant à la ligne inaugurant un usage "poétique" de la phrase » :
Posée par qui ?
Par les événements.
Et pas seulement par les événements…
Il comparaissait devant quelqu’un
Devant quelqu’un de redoutable.
Sa conscience.
Varia, enfin, rassemble en partie des textes publiés dans des revues ou des livres collectifs, notamment la réponse à la question Écrire, pourquoi ? reprise d’un livre publié sous ce titre en 20051. On lira également 80 ajouts aux Litanies du scribe, commencées en 1988 et constamment augmentées : un nom d’écrivain est suivi d’un trait, anecdotique ou non, qui pourrait le caractériser. Par exemple, ici :
(...) E. Morante et ses chats
Verga en visite à Médan chez Zola
Saroyan en road-movie 1963
Walpole atteint de la goutte
Vallejo périssant du hoquet
Blecher immobilisé dans sa gouttière
Bocage livré à l’inquisition
Brioussov et son poème d’un seul vers (...)
Ces litanies sont immédiatement suivies de l’esquisse d’une autre "litanie", un poème (« À nos héroïnes-Héroïdes ») constitué d’une liste subtilement ordonnée de noms de femmes — le Dictionnaire des femmes célèbres publié dans la collection Bouquins est toujours sur le bureau de Stéfan, qui le complète régulièrement. Sont assemblés ici des noms de la mythologie, des noms ou prénoms de cantatrices, écrivaines, poétesses, actrices, peintresses, révolutionnaires, des femmes aimées aussi, tous noms qui peuplent la poésie de Stéfan. Le traducteur des poètes de l’Antiquité donne quelques fragments d’Archiloque, recréation ; ainsi "L’Aimée" : « Elle aimait la branche de myrte / et la belle fleur de rose, ses cheveux / ombrageaient ses épaules et ses reins ». Ce Grec est très clairement proche de Stéfan qui le caractérise ainsi : « Le hérisson qui pique, le renard qui raille sont ses totems ».
Les Varia contiennent des pages sur la poésie, dont j’isole ce qui définit l’activité de Stéfan, « on écrit pour être autre que soi-même » : point de départ sans doute pour réfléchir à ce qu’est l’usage du pseudonyme. L’idée est reprise dans un texte sur l’ennui, dans sa conclusion qui part d’un élément biographique :
« Va jouer », disait-on à [cet] enfant saisi par l’ennui et qui un jour eut la curiosité d’apprendre ce qu’était ce malaise dans son dictionnaire familial : « tourment de l’âme », c’était juste, « dégoût de tout », également — il retint donc la sagesse topique d’É. Littré, qui l’aiderait à « écrire » (sortir de soi).
L’ennui et Littré n’ont pas quitté Stéfan – ni l’écriture.
Jude Stéfan, Grains & issues, essais ou Variété VIII, éditions la ligne d’ombre, 2008, 11 €.© Photo Chantal Tanet, août 2011.
Une autre version de la recension a paru en 2008 dans Poezibao.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan grains & issues, anti-journal, scholies, varia | ![]() Facebook |
Facebook |
15/08/2011
Pierre Bergounioux, Le miroir brisé

À compter de la fin du deuxième tiers du XIXe siècle, le genre romanesque est périmé comme le furent, avant lui, la tragédie, la poésie didactique, l’oraison funèbre. À cela, il y a deux raisons, l’une substantielle, l’autre formelle.
Lorsque les Trois Glorieuses abrègent le blême intermède de la Restauration et que la bourgeoisie d’affaires prend directement en mains l’initiative politique, il n’existe pas de langage spécialisé qui ferait écho à ce qui se passe alors, développement de l’industrie au détriment de la terre, domination d’une nouvelle classe, urbaine, après l’éviction de la vieille noblesse rurale. Un genre mineur, sans règles, rédigé en langue vulgaire et non pas en latin, est disponible, dans un coin. C’est une forme à peine élaborée, allongée, du récit, cette aptitude anthropologique qui n’est que la récurrence indéfinie de la structure de base du langage, la phrase. Celle-ci se ramène à un même binôme, à l’association d’un signe d’espace et d’un autre de temps, d’un nom et d’un verbe, selon la grammaire. Quelqu’un fait quelque chose.
C’est au moyen de cet instrument rudimentaire que des hommes incertains mais corpulents, énergiques, vont rendre compte, avec une pénétration admirable, une ironie mordante et, pour finir, mortelle, de la reconfiguration de la société révolutionnée. En à peine plus de trois décennies, ils ont pesé, jugé, condamné. Rien ne vaut la peine, que la littérature en tant qu’elle établit que rien ne vaut la peine, et d’abord l’axiome fondateur du vouloir pratique, qui est « la maximisation des chances pacifiques de gain pécuniaire ». Tout est dit. Et les ingénus, les tièdes qui n’auraient pas compris qu’une nouvelle injustice a supplanté la vieille injustice, qu’au coupleimmémorial, ennemi, que composaient le propriétaire foncier et l’esclave puis le manant, s’est substitué celui du capitaliste et du prolétaire, ces ingénus, ces attardés seraient bien incapables d’avancer quoi que ce soit qui vaille après que Flaubert s’est assis sur le « banc d’infamie ».
Il ne se passe rien d’autre, dorénavant, que la répétition sans attrait ni équité ni surprise (en principe) du cycle argent-marchandise-argent. Ça, c’est pour le fond. Mais, du côté de la forme, les choses ont singulièrement changé. L’Allemagne, qui peine à sortir de son morcellement féodal, à rejoindre, sur la scène du monde, les deux États-nations qui se disputent depuis trois siècles le premier rôle, l’Allemagne, on l’a dit, pense à proportion de l’impuissance physique à laquelle elle se trouve réduite. Dès 1848, un philosophe rhénan de trente ans, d’origine juive, formé à l’école hégélienne, rédige d’une main décidée, un Manifeste dont l’écho de tonnerre remplira le siècle et demi qui suit. La destruction violente de la société dont les grands romanciers français ont livré la description vivante est à l’ordre du jour, ses fossoyeurs nommément convoqués — « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Pareilles déclarations ne sauraient être prises à la légère par l’adversaire. Il lui faut répondre, justifier la domination bureaucratique-légale qui garantit ses intérêts, opposer des raisons au projet révolutionnaire hautement rationnel sorti du cerveau du jeune Marx. Et c’est le deuxième discours qui vient flanquer, sur sa droite, après la théorie matérialiste de l’histoire, sur sa gauche, le langage romanesque. Auguste Comte, déjà, mais Spencer et surtout Durkheim, Max Weber jettent les fondements de la science sociale. Ils appliquent aux choses humaines les rigoureux principes auxquels les savants ont soumis, depuis la Renaissance, les trois règnes et les quatre éléments. Ils adoptent l’attitude de neutralité axiologique qui conditionne l’accès à la réalité objective, enquêtent, mobilisent les ressources de l’analyse statistique, accèdent à des vérités qui disqualifient la sociologie spontanée, sauvage que possède, implicitement, tout agent social et qu’explicitent, sans y voir malice, les romanciers. L’éclat d’un contre-projet politique sérieux, d’un côté, la genèse d’une interprétation rigoureuse des faits sociaux, de l’autre, privent le roman, dès le milieu du XIXesiècle, de la vertu révélatrice que lui avaient conférée les romanciers français. Zola, venu trop tard, procède mécaniquement à un inventaire qui n’établit plus rien quon ne sache déjà.
[…]
Pierre Bergounioux, Un Miroir brisé, dans La Nouvelle Revue Française, "Le roman du XXe siècle", sous la direction de Jean Rouaud, n° 596, février 2011, p. 31-33.
© Photo Chantal Tanet, 2006.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, le miroir brisé, le roman, matérialisme | ![]() Facebook |
Facebook |
14/08/2011
Jean Genet, Le condamné à mort
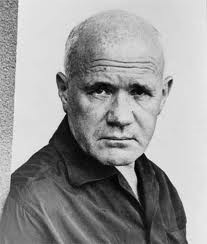
Le condamné à mort
[…]
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou
Que ma main plus légère et grave qu’une veuve
Effleure sous mon col, sans que ton cœur s’émeuve,
Laisse tes dents poser ton sourire de loup.
O viens mon beau soleil, ô viens ma nuit d’Espagne,
Arrive dans mes yeux qui seront morts demain.
Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.
Mène-moi loin d’ici battre notre campagne.
Le ciel peut s’éveiller, les étoiles fleurir,
Ni des fleurs soupirer, et des prés l’herbe noire
Accueillir la rosée où le matin va boire,
Le clocher peut sonner : moi seul je vais mourir.
O viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde !
Visite dans sa nuit ton condamné à mort.
Arrache-toi la chair, tue, escalade, mords,
Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde.
Nous n’avions pas fini de nous parler d’amour.
Nous n’avions pas fini de fumer nos gitanes.
On peut se demander pourquoi les Cours condamnent
Un assassin si beau qu’il fait pâlir le jour.
Amour viens sur ma bouche ! Amour ouvre tes portes !
Traverse les couloirs, descends, marche léger,
Vole dans l’escalier plus souple qu’un berger,
Plus soutenu par l’air qu’un vol de feuilles mortes.
O traverse les murs , s’il le faut marche au bord
Des toits, des océans ; couvre-toi de lumière,
Use de la menace, use de la prière,
Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
[…]
Jean Genet, Le condamné à mort [1945]suivi de poèmes, L’enfant criminel [1948], Le funambule [1955], Marc Barbezat – L’Arbalète, 1966, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le condamné à mort, l'arbalète | ![]() Facebook |
Facebook |
13/08/2011
Cesare Pavese, Le Métier de vivre
18 octobre [1938]
Décrire la nature en poésie, c’est comme ceux qui décrivent une belle héroïne ou un puissant héros.
10 novembre [1938]
La littérature est une défense contre les offenses de la vie. Elle lui dit : « Tu ne me couillonnes pas ; je sais comment tu te comportes, je te suis et je te prévois, je m’amuse même à te voir faire, et je te vole ton secret en te composant en d’adroites constructions qui arrêtent ton flux. »

16 avril 1940
Il doit être important qu’un jeune homme toujours occupé à étudier, à tourner des pages, à se tirer les yeux, ait fait sa grande poésie sur les moments où il allait sue le balcon, sous le bosquet, sur la colline ou dans un champ tout vert. (Silvia latini, Vie solitaire, Souvenirs) La poésie naît non de l’our life’s work, de la normalité de nos occupations mais des instants où nous levons la tête et où nous découvrons avec stupeur la vie. (La normalité, elle aussi, devient poésie quand elle se fait contemplation, c’est-à-dire quand elle cesse d’être normalité et devient prodige.)
On comprend par là pourquoi l’adolescence est grande matière à poésie. Elle nous apparaît à nous — hommes — comme un instant où nous n’avions pas encore baissé la tête sur nos occupations.
20 février
La poésie est non un sens mais un état, non une compréhension mais un être.
Cesare Pavese, Le Métier de vivre, traduit de l’italien par Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 103, 113, 153, 255.
Publié dans MARGINALIA, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/08/2011
Aragon, Le paradis terrestre

Le paradis terrestre
Le collectionneur de bouteilles à lait
Descend chaque jour à la cave
Il halète à la
Onzième marche de l’escalier
Et tandis qu’il disparaît dans l’entonnoir noir
Son imagination se monte se monte
Kirikiki ah la voilà
La folie avec ses tempêtes
Tonneaux tonneaux les belles bouteilles
Elles sont blanches comme les seins vous savez
Vers la gorge
Où le couteau aime les très jeunes filles
Il y a des hommes dans les restaurants
Et dans les pâtisseries
Ils regardent les consommatrices et leurs repas
Froidit Leur chocolat
Ils aiment les voir prendre un sorbet
Ça c’est pour eux comme pour d’autres
La forêt féérique où les apparitions du soir
Se jouent et chantent
Mais quand par surcroît de délices une voilette
Sur la crème ou la glace met son château de transparence
On peut voir soudainement pâlir et rougir
Le spectateur aux dents serrées
Des exemples comme ceux-là la rue en
Est pleine
Les cafés les autobus
Le monde est heureux voyez-vous
Louis Aragon, La Grande Gaîté [1929], dans Œuvres poétiques complètes, tome I, préface de Jean Ristat, édition publiée sous la direction d’Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 435.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paradis terrestre, la grande gaîté | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2011
Gertrude Stein, Picasso
 Cézanne dans ses aquarelles avait une tendance à découper le ciel non en cubes, mais en divisions arbitraires ; il y avait aussi déjà le pointillisme de Seurat et de ses successeurs. Mais tout de même cela n’avait rien à voir avec le cubisme parce que tous ces autres peintres, pris par la réduction des choses vues, étaient préoccupés par leur technique qui devait exprimer de plus en plus ce qu’ils voyaient. Enfin de Courbet à Seurat, on peut même dire de Courbet à Van Gogh et à Matisse la plupart des artistes ont vu la nature comme elle est, c’est-à-dire, si vous le voulez, comme tout le monde la voit.
Cézanne dans ses aquarelles avait une tendance à découper le ciel non en cubes, mais en divisions arbitraires ; il y avait aussi déjà le pointillisme de Seurat et de ses successeurs. Mais tout de même cela n’avait rien à voir avec le cubisme parce que tous ces autres peintres, pris par la réduction des choses vues, étaient préoccupés par leur technique qui devait exprimer de plus en plus ce qu’ils voyaient. Enfin de Courbet à Seurat, on peut même dire de Courbet à Van Gogh et à Matisse la plupart des artistes ont vu la nature comme elle est, c’est-à-dire, si vous le voulez, comme tout le monde la voit.
Un jour on demandait à Matisse si, quand il mangeait une tomate, il la voyait comme il la peignait. « Non, dit Matisse, quand je la mange, je la vois comme tout le monde. » Et à vrai dire, de Courbet à Matisse, les peintres ont vu la nature comme tout le monde la voit et leur tourment c’était d’exprimer cela, de le faire avec plus ou moins de tendresse, de sentiment, de sérénité et de profondeur.
Je suis toujours frappée par les paysages de Courbet parce qu’il n’a pas été forcé de changer la couleur pour arriver à donner la vision ordinaire de la nature. Mais Picasso était totalement différent. Quand il mangeait une tomate, la tomate n’était pas celle de tout le monde, pas du tout, et son effort n’était pas d’exprimer à sa manière des choses vues par tout le monde, mais comme lui seul les voyait.
Gertrude Stein, Picasso, Christian Bourgois, 1978 [1938], p. 36-37.
Gertrude Stein par Picasso, 1905-1906.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, picasso, voir la nature | ![]() Facebook |
Facebook |
10/08/2011
Christiane Veschambre, Fente de l'amour

au chemin creux
glaise et pierres
demeure
ma demeurée
m’attend
— pas moi
mais celle que la mort lavera
l’amour cherche
une chambre en nous
déambule dans nos appartements meublés
parfois
se fait notre hôte
dans la pièce insoupçonnée mise à jour par le rêve
creuse
entre glaise et pierres
un espace pour mon amour
n’ai que lui
pour osciller
comme la tige à l’avant de l’aube
au respir de l’amour
— la vaste bête
qui tient contre elle
embrassée
la demeurée du chemin creux
Christiane Veschambre, Fente de l’amour, illustrations de Madlen Herrström ; Odile Fix (Bélinay, 15430 Paulhac), 2011, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, fente de l'amour, au chemin creux | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2011
Jacques Borel, Journal de la mémoire
 La phrase longue, oui, et le recul, sans cesse, de l’apparition de tel événement ou de tel personnage qui ont pourtant, dès le début, été annoncés. Je sais que c’est pour eux que j’ai pris le départ, à eux que je finirai par en venir, mais leur introduction se trouve infiniment retardée par l’intrusion, à mesure que l’écriture avance de son pas propre et de plus en plus indépendant, de mille thèmes, de mille sensations, de mille associations, de nouveaux jalons spontanément jaillis, dont à la fois elle se nourrit et se compose, et qui l’entraînent. C’est aussi qu’un monde se déroule en nous à chacune des moindres secondes que nous vivons, que tout, pensées, sensations, soudains affleurements de la mémoire, provoqué par le langage et à son tour le provoquant, accourt ensemble, et que, si l’on veut tout capter de cette profusion instantanée, si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, comme j’espère pouvoir le faire un jour, de chacun de ces mouvements, de cet indivisible flux à chaque seconde tout entier présent et à chaque seconde aussi éveillant de nouvelles harmoniques, l’on ne peut, sous peine d’appauvrissement, éviter cette profusion, cette ramification ou cette prolifération de l’écriture, cette multiplication des incidentes, qui sont à l’image même de la vie de la conscience et de ses franges plus obscures.
La phrase longue, oui, et le recul, sans cesse, de l’apparition de tel événement ou de tel personnage qui ont pourtant, dès le début, été annoncés. Je sais que c’est pour eux que j’ai pris le départ, à eux que je finirai par en venir, mais leur introduction se trouve infiniment retardée par l’intrusion, à mesure que l’écriture avance de son pas propre et de plus en plus indépendant, de mille thèmes, de mille sensations, de mille associations, de nouveaux jalons spontanément jaillis, dont à la fois elle se nourrit et se compose, et qui l’entraînent. C’est aussi qu’un monde se déroule en nous à chacune des moindres secondes que nous vivons, que tout, pensées, sensations, soudains affleurements de la mémoire, provoqué par le langage et à son tour le provoquant, accourt ensemble, et que, si l’on veut tout capter de cette profusion instantanée, si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, comme j’espère pouvoir le faire un jour, de chacun de ces mouvements, de cet indivisible flux à chaque seconde tout entier présent et à chaque seconde aussi éveillant de nouvelles harmoniques, l’on ne peut, sous peine d’appauvrissement, éviter cette profusion, cette ramification ou cette prolifération de l’écriture, cette multiplication des incidentes, qui sont à l’image même de la vie de la conscience et de ses franges plus obscures.
Jacques Borel, Journal de la mémoire, éditons Champ Vallon, 1994, p. 54.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
08/08/2011
Cédric Demangeot, Éléplégie

Un raté dans l’étang
I
Aujourd’hui j’ai
vu le grand arbre sur la place
amputé de moitié.
Pas un passant
n’avoue qu’il sait.
Donc je suis
l’idiot du village.
Et la face que j’ai
dans le lac vertical
ne me connaît pas :
nul ne m’a
appris la soif (si dangereuse
aux bêtes la nuit) ni à me
connaître au fond de mon
verre bouché d’eau noire.
II
Elle est loin
la maison
de l’idiot
— loin dans l’impasse. On
s’y rend rarement. L’idiot, lui,
sort tous les jours
de sa maison — va
au village voir. La fragilité
des fenêtres au moindre souffle (entre
autres formes brisées) : voir
les gens propriétaires de leurs jambes
— leur vitesse et comme ils font
mal le droit — mal l’amour — comme
ils font. Puis l’idiot s’en
retourne à la nuit : le voici qui vient.
[...]
Cédric Demangeot, Éléplégie, Atelier La Feugraie, 2007, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, Éléplégie, l'idiot | ![]() Facebook |
Facebook |
07/08/2011
James Sacré, Portrait du père en travers du temps

Me promenant dans Pertuis
Je pense à mon père sans trop imaginer
Aucun de ses gestes ni même son visage
Les rues de la vieille ville s’en vont
Sans qu’on sache trop où,
Mais ça n’est jamais si loin, jusqu’à
Par exemple un lavoir ou telle petite place de l’Ange
Avec une belle fontaine vivante et d’anciennes façades
Maisons du seizième siècle, naguère (on le voit sur une photo)
Un grand orme poussait là, tout frôlant sans doute
Les murs proches des maisons…
On s’en revient toujours à une place un peu centrale
Et qui semble tenir dans sa main toutes ces rues lâchées, mais
pas trop, autour d'elle
y voit beaucoup de vieux Maghrébins
Qui prennent le premier soleil du matin
Et c’est peut-être pour cela que j’ai pensé à mon père
À cause de leurs visages qui ont été mélangés à du temps, à du
travail longtemps
Et qui sont là maintenant quasiment sans bouger
Entre de la campagne en allée
Et quelque chose aussi de parti
Dans cette vieille ville de Pertuis.
(9 mars 2004)
Ton visage si fortement
Entre le faux et le vrai, des colères,
La solitude et ce mélange
De plaisir et de distance gênée
Avec les autres, et les choses du monde.
Le visage vivant de mon père.
À quoi penser maintenant qu’il est
Des matières pourries qui ont séché ?
Il me reste de son corps
La couperose des joues, l’œil
Comme une question dure,
Son allure à la fin mal balancée.
Ça me reste où ça ? Et quelle importance ?
(21 juin 2005)
James Sacré, Portrait du père en travers du temps, Lithographies de Djamel Meskache, La Dragonne, 2009, p. 33 et 43.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, portrait du père, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
06/08/2011
Apollinaire, Les fenêtres (Calligrammes)

Marie Laurencin (Apollinaire au centre, Picasso à gauche)
Les fenêtres
Du rouge au vert tout le jaune se meurt
Quand chantent les arts dans les forêts natales
Abatis de pihis
Il y a un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile
Nous l’enverrons en message téléphonique
Traumatisme géant
Il fait couler les yeux
Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises
Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche
Tu soulèveras le rideau
Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre
Araignées quand les mains tissaient la lumière
Beauté pâleur insondables violets
Nous tenterons en vain de prendre du repos
On commence à minuit
Quand on a le temps on a la liberté
Bigorneaux Lotte multiples Soleils et l’Oursin du couchant
Une vieille paire de chaussures jaunes devant la fenêtre
Tours
Les Tours ce sont les rues
Puits
Arbres creux qui abritent les Câpresses vagabondes
Les Chabins chantent des airs à mourir
Aux Chabines marronnes
Et l’oie oua-oua trompette au nord
Où les chasseurs de ratons
Raclent les pelleteries
Étincelant diamant
Vancouver
Où le train blanc de neige et de feux nocturnes fuit l’hiver
O Paris
Du rouge au vert tout le jaune se meurt
Paris Vancouver Hyères Maintenon New York et les Antilles
La fenêtre s’ouvre comme une orange
Le beau fruit de la lumière
Apollinaire, Ondes, dans Calligrammes [1918], dans Œuvres poétiques, édition de Marcel Adéma et Michel Décaudin, avant-propos d’André Billy, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 168-169.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire, calligrammes, marie laurencin | ![]() Facebook |
Facebook |
05/08/2011
Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers
 Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.
Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.
Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers, Fata Morgana, 1985, p. 9-10.
Publié dans MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, celle qui vien tà pas légers, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/08/2011
Peter Huchel, Jours comptés (traduction M. Jacob & A. Villani)

Macbeth
Avec les sorcières j’ai parlé,
en quelle langue,
je ne sais plus.
Arrachées,
les portes du ciel,
laissé libre, l’esprit,
l’engeance de la lande
dans le tourbillon du vent.
En bord de mer
les orteils sales de la neige,
quelqu’un attend là,
les mains à vif.
J’aurais préféré que ma mère
m’eût étouffé.
Des écuries du vent
il surgira,
là où les vieilles femmes
hachent le foin.
Méfiance ! Mon heaume,
je le suspends
à la charpente de la nuit.
Macbeth
Mit Hexen redete ich,
in welcher Sprache,
ich weiß es nicht mehr.
Aufgesprengt
die Tore des Himmels,
freigelassen der Geist,
in Windwirbeln
das Gelichter der Heide.
Am Meer
die schmutzigen Zehen des Schnees,
hier wartet einer
mit Händen ohne Haut.
Ich wollt, meine Mutter
hätt mich erstickt.
Aus den Ställen des Winds
wird er kommen,
wo die alten Frauen
das Futter häckseln.
Argwohn mein Helm,
ich häng ihn
ins Gebälk der Nacht.
Pas de réponse
Sur la cime noyée de brouillard,
sur le chêne
la corneille se pose.
La poutre aux chats est déserte.
Ombres
de sarments secs
au plafond de la chambre.
Signes
qu’un mandarin
a tracés de sa main.
L’alphabet
que tu possèdes
ne suffit pas
pour souffler réponse
à l’écriture sans défense.
Keine Antwort
Aufs schwimmende Nebelhaupt
der Eiche
setzt sich die Krähe.
Der Katzenbalken ist leer.
Schatten von dürrem
Weingerank
an der Zimmerdecke.
Zeichen,
von eines Mandarinen Hand
geschrieben.
Das Alphabet,
das du besitzt,
reicht nicht aus,
Antwort zu geben
der wehrlosen Schrift.
Peter Huchel, Jours comptés, [Gezählte Tage, 1972], traduit de l’allemand par Maryse Jacob et Arnaud Villani, Atelier La Feugraie, 2011, p. 76-77 et 96-97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter huchel, jours comptés, gesählte tag, maryse jacob, arnaud villani, macbeth | ![]() Facebook |
Facebook |
03/08/2011
Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais
 On ne peut écrire qu'en perdant
On ne peut écrire qu'en perdant
le corps de ce que l'on nomme.
Tu parles, tu écris pour que les choses
ne coïncident plus avec elles-mêmes.
On n'écrit pas pour donner aux choses une
place, on écrit pour faire de la place ;
pour que l'arbre ne vienne jamais dans son
nom et que la pierre se taise dans ce qui la
désigne.
Écrire, c'est apporter de l'eau à une source
pour qu'elle découvre sa soif.
Écrire, c'est appeler, appeler surtout pour
que rien ne vienne.
Tu parles, tu écris pour ne pas perdre pied,
pour te tenir dans la distance de
toute chose.
Comment continuer à écrire en sachant
qu'aucun mot ne peut contenir le corps
de ce qu'il nomme.
Écrire, c'est chercher sans cesse un point d'appui.
Écrire, pour lire sa voix dans la voix
des autres.
Peut-être que nos mots sont la seule
terre où l'on peut s'établir ?
Écrire, c'est se tenir à côté de ce qui
se tait.
Écrire, c'est maintenir l'appel,
n'être que le lieu de cet appel.
Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais, dans Ce lieu que les pierres regardent, suivi de Variations, Pas japonais, L'Invention de l'espace, préface de Gisèle Berkman, éditions Lettres vives, 2009 (Pas japonais avait été publié en 1992, éditions Unes), p. 93, 95, 95, 96, 96, 98, 100, 100, 101, 103, 104, 106.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, pas japonais, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2011
Charles Cros, Banalité

Banalité
L’océan d’argent couvre tout
Avec sa marée incrustante.
Nous avons rêvé jusqu’au bout
Le legs d’un oncle ou d’une tante.
Rien ne vient. Notre cerveau bout
Dans l’idéal, feu qui nous tente,
Et nous mourons. Restent debout
Ceux qui font le cours de la rente.
Étouffé sous les lourds métaux
Qui brûlèrent toute espérance,
Mon cœur fait un bruit de marteaux.
L’or, l’argent, rois d’indifférence
Fondus, puis froids, ont recouvert
Les muguets et le gazon vert.
Charles Cros, Douleurs et colères, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes, édition établie par Louis Forestier et Pierre-Olivier Walzer, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1970, p. 198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles cros, banalité, argent | ![]() Facebook |
Facebook |





