01/11/2024
La revue de belles-lettres, 2024-I : recension
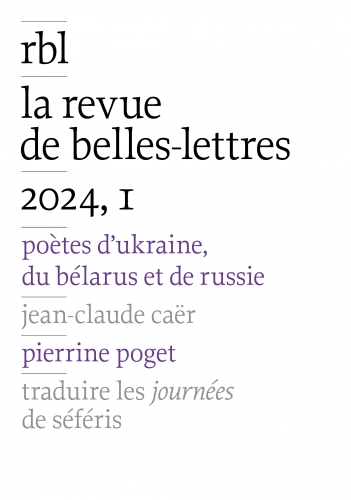
Sauf à consacrer une livraison à un thème — pour la revue de belles-lettres, "Enfantines", 2021, 2 par exemple —, une revue propose le plus souvent des textes variés, même si l’accent est mis sur un ensemble. Dans ce premier numéro de l’année, une centaine de pages sont réservées à des poètes d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie, sous le titre La trace du souffle. Le choix de Marion Graf et Alexey Voïnov est sans ambiguïté : « Aux confins de l’Europe, hier et aujourd’hui à nouveau, des poètes ont élevé et élèvent leur voix face à la répression et à la violence (…) à la dictature et à la guerre. » On lit, d’abord avec Vasyl Stus, « voix fondatrice de la poésie résistante ukrainienne », quatre poétesses.
Vasyl Stus (1938-1985) a connu le régime soviétique en Ukraine et, pour l’avoir combattu, les prisons et les camps de "travail" — le Goulag — où il est mort au cours d’une grève de la faim. Ses poèmes, parfois tournés vers le religieux, évitent les images et, dans leur dépouillement, portent la rage et la difficulté de vivre, aussi le désespoir :
La vie passe sans même avoir été
et combien vaines toutes les plaintes.
C’est à peine vu, c’est à peine entendu,
et ça finit, comme un mauvais présage.
C’est ce sentiment d’être devant un mur infranchissable qui domine dans un poème de Julia Cimafiejeva (1982), Biélorussienne en exil. Deux narrations qui semblent parallèles mettent en évidence la violence de la dictature ; elles opposent le plaisir sensuel d’une assiettée de fraises au lait à l’exécution de plusieurs « groupes de 15 personnes » devant une fossé où les corps tomberont : les deux récits se rejoignent, les fraises constituent le dîner des fusilleurs.
Une autre exilée, Russe, Polina Barskova (1976), évoque dans une prose Joseph Brodsky, lui aussi exilé, et ce qu’est pour elle la poésie et le terrible présent « sous les bombes, depuis la prison, depuis les camps ». Comment reconstruire ses repères dans un autre lieu, une autre langue — c’est devenir un « char/don roulant » et vivre une perte qui aboutit au constat « Je ne suis plus à personne ». Saint-Pétersbourg, la ville aimée, n’est plus et une visite à la maison d’Emily Dickinson fait prendre conscience de l’impossibilité de tout retour. Comment vivre aujourd’hui la guerre quand on comprend que « le pays se perd » ?
La guerre, destructrice de l’individu, est aussi le motif de Marianna Kiyanovska (1973), Ukrainienne ; la guerre conduit à la perte de soi parce que, écrit-elle, « chaque balle qui n’est pas pour moi / est mienne ». Peut-on rêver d’une autre vie ? Il y a, malgré la violence installée, la pensée qu’autre chose est possible comme le dit explicitement le titre « Partager la lumière ».
Mais ce qui est à partager est refusé quand c’est la violence qui est mise en cause. Deux metteuses en scène russe, Génia Berkovitch (1985) et Svetlana Petriichuk (1980), arrêtées en mai 2023 pour « justification du terrorisme » — qu’elles combattaient dans une pièce saluée par la critique en 2020 — ont été condamnées à 6 ans de prison en septembre 2024. « Il n’y a plus rien à espérer », écrit la première qui, dès le début de l’invasion russe en Ukraine, s’opposait à la guerre.
Tous ces poèmes rappellent, si l’on était tenté de l’oublier, que les dictatures existent toujours et qu’elles se maintiennent par la violence pour obtenir la soumission de leur population. Le refus de céder entraîne la répression, la prison, reste à vivre en silence ou à partir : c’est ce que rapporte le russe Alexey Voinov dès le 22 février 2022, début de l’« opération militaire spéciale », « expression qui noyait tout dans le brouillard ». Il raconte ses hésitations et comment il se résigne à l’exil pour fuir un régime où les soldats violent et tuent. Loin des vies défaites, Pierrine Poget commente ce que furent au début des années 1950 les tâches quotidiennes de la Sœur principale d’un hôpital de Genève, qui consigna tout ce qui l’occupait, aussi bien l’état des malades que des anecdotes propres à la vie collective. Il ne s’agit pas seulement d’un document à vocation administrative, il y a là « une femme qui écrit, c’est-à-dire qui pense et qui ressent, qui met en ordre quelque chose d’elle-même pour le tendre à l’Autre ». On suivra l’auteure dans ses réflexions sur un mot qui l’a intriguée dans ce "livre de raison", « lavures », dont elle apprend après quelques détours qu’il s’agit d’eau de vaisselle…
Le lecteur suit Jean-Claude Caër dans un tout autre lieu, la Bretagne, décor principal d’un ensemble de poèmes. Il y rapproche son présent à la campagne, l’été, des jours de l’enfance et, aussi, de ce temps où il « ramasse les couleurs de l’automne ». Un autre moment, il est à Ostende, pense au poète Franck Venaille, médite sur la maladie, sachant que « Seul compte le vrai, l’intensité, le désir pour affronter le néant. » Ce vrai, ce sont les petites scènes de l’été, les oiseaux observés, les enfants dans le jeu, les marches dans le vent, « la joie d’être là, pas ailleurs, juste à cet instant. »
Le lecteur rejoint ensuite Amaury Nauroy qui propose un "portrait" très personnel de son « ami de Fribourg », Frédéric Wandelère dont les poèmes sont encore peu connus en France. On suit également les réflexions de Gilles Ortlieb à propos de la traduction du Journal de Georges Séféris dont des passages sont retenus, comme celui d’une rencontre avec Henri Michaux dans les années 1930. On n’oublie pas les poèmes de l’écrivain syrien Saleh Diab, installé en France, ni les photographies de Julia Cimafieva qui accompagnent La trace du souffle. Il faut enfin rappeler le parti-pris exemplaire de La revue de belles-lettres : tout poème traduit est accompagné du texte original.
La Revue de belles-lettres, 2024-1, 206 p. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 octobre 2024.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.