30/11/2020
Robert Desnos,

Le sursaut
Sur la route en revenant des sommets rencontré par les
corbeaux et les châtaignes
Salué la jalousie et la pâle flatteuse
Le désastre enfin le désastre annoncé
Pourquoi pâlir pourquoi frémir ?
Salué la jalousie et le règne animal avec la fatigue avec le
désordre avec la jalousie
Un voile qui se déploie au-dessus des têtes nues
Je n’ai jamais parlé de mon rêve de paille
Mais où sont partis les arbres solitaires du théâtre
Je ne sais où je vais j’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles
dans la bouche
Je ne sais si mes yeux se sont clos cette nuit sur les ténèbres
précieuses ou sur un fleuve d’or et de flamme
Est-il le jour des rencontres et des poursuites
J’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles dans la bouche
Robert Desnos, Les ténèbres, dans Domaine public, "Le Point du jour", Gallimard, 1953, p. 150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, les ténèbres, dans domaine public, sursaut | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2020
Muriel Pic, Affranchissements : recension
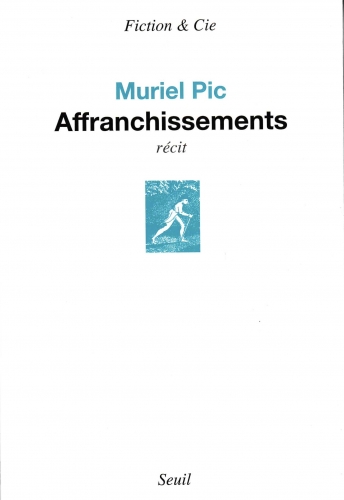
Affranchissements est sous-titré "récit", récit de la vie d’un oncle bossu, James/Jim, disparu au mois de mai 2001 ; cependant, les rares rencontres n’auraient pas permis de rapporter ce qu’avait été cette vie, ce que la narratrice concède, « Je suis bien obligée de reconnaître que je ne sais pas grand-chose de la vie de Jim. » La reconstruction s’opère à partir de documents divers, rassemblés ici et là, « photographies, timbres, cartes postales, dessins, cartes à jouer et bouts de textes ». À partir de cette moisson hétéroclite se dessine une figure qui ne peut être que floue, partiellement inventée, mise en relation avec la réalité chaotique de son temps et avec des lectures. L’enchevêtrement d’éléments hétéroclites restitue l’impossibilité de faire « revivre ce que l’on n’a pas vécu », sans pourtant que le "récit de vie" soit confus, incohérent : plusieurs fils l’organisent et ne demeurent d’obscurités que celles propres à toute vie.
Le livre contient 60 illustrations liées plus ou moins à l’oncle— plan d’un jardin ou d’un hôtel, dessin d’une fleur, carte postale, photographies, etc. —, mais tous ces documents visent à renforcer l’effet de réel du texte. Le mot "affranchissement" revient, à différents moments, avec ses diverses acceptions ; l’oncle, philatéliste, a la passion de « tout ce qui se rapporte à l’affranchissement » et, jardinier à l’Université de Londres, lecteur d’ouvrages d’horticulture il plante des arbres fruitiers en suivant la méthode de l’affranchissement. Le mot est aussi employé avec sa valeur de "libération", en particulier à propos du style dans la mode souvent « asservi à une forme qui satisfait les lois du marché en limitant l’imagination et l’intelligence pour ne pas s’exposer au péril de l’affranchissement ». Il est également choisi pour préciser le passage du réel à la poésie, « L’imagination affranchit les mots d’un rapport conventionnel avec le réel. Comprendre cet affranchissement est comprendre la poésie ». La double valeur du mot est d’ailleurs glosée, avec l’origine commune de free (= libre) et de to frank, « affranchir postalement », d’où l’« affinité entre le geste postal et le geste de libérer, qui fonde le double sens du mot français affranchissement ». En même temps que ce fil, la relation éclatée des moments de la vie de l’oncle forme la trame du récit.
Le portrait physique est limité à l’aspect général, déformé par la tuberculose osseuse : une « allure de vieillard et d’enfant » ; la narratrice explique beaucoup plus avant dans le texte l’origine de la maladie et les soins reçus quand elle relate ce que furent les parents — leur mauvaise gestion de leur hôtel à Menton, leur ruine, l’installation à Londres et leur mort de la grippe espagnole. Par les clients de l’hôtel, l’enfant a découvert très tôt la discrimination provoquée par la couleur de la peau et, plongé par le hasard de sa naissance dans un bain linguistique, il a appris l’anglais, le français, l’allemand et l’italien. Il a tenté de transmettre sa passion à sa nièce en lui envoyant des timbres chaque mois, mais la collection retrouvée dans le grenier en 2017 ne représente plus que « les restes d’un monde en train de partir ». Pour rejoindre son travail, il a inventé des chemins détournés, comme s’il passait « de l’autre côté du miroir, guidé par un être surnaturel ». Si la figure de l’oncle est relativement peu présente en tant que telle, son nom (James / Jim) et son infirmité structurent le récit.
Ainsi, le lecteur rencontre deux hommes qui portent le même prénom, le frère de Frances Yates, historienne de la magie1, et un riche Américain qui sillonnait la Méditerranée et que la rumeur prétendait être l’amant de la mère de l’oncle. Et il est question de bossus tout au long du récit : dans l’histoire économique (une superstition veut que "toucher la bosse d’un bossu" porterait chance pour s’enrichir), dans une fiction de l’Antiquité (l’esclave bossu acheté en même temps qu’un candélabre en or), dans le jeu du tarot (l’Hermite remplacé par le Bossu), dans les lectures (Leopardi, Gramsci), dans un dessin de Frances Yates (une figure féminine au « dos légèrement tordu ») et avec la présence continue de l’écrivain médecin William Carlos Williams : il est supposé rencontrer dans un parc un petit bossu qui, à la fin du récit, est dans sa salle d’attente.
La narratrice a acheté un livre de Williams (Spring and all) la dernière fois qu’elle a rencontré Jim et ses poèmes sont cités au début de cinq chapitres sur six. Le poète américain apparaît comme une référence majeure et un extrait d’un de ses poèmes est même attribué à Jim. Le récit débute d’ailleurs par la présentation de son livre dans des termes qui peuvent s’appliquer à Affranchissements : « il est tout : un essai, un récit avec des chapitres dont la numération est incohérente et des poèmes qui pensent à voix haute et l’œil grand ouvert, les logiques absurdes et jumelles des guerres et de l’économie marchande. » Le titre de chaque séquence des six parties est une date et les dates se suivent sans ordre apparent (1840, 1719, 1927, -225, 1965, etc.), des poèmes2 ferment quelques séquences, d’une écriture dans la lignée de Williams. Pour le dernier point, les essais, le renvoi au poète est explicite ; la narratrice relève que Williams « serre avec son imagination le détail du réel dans ses vers » et, plus loin, qu’elle écrit avec Spring and all ouvert.
Les essais en prose introduits portent aussi bien sur l’introduction de l’héliothérapie contre la tuberculose que sur Mallarmé et, surtout, sur la place de l’argent dans la société — à partir, notamment, d’un poème de Williams et de sa traduction en allemand par Enzensberger — et les méfaits du capitalisme. Si certaines pages sont bien intégrées dans le récit, bien des développements ressemblent à des articles d’une petite encyclopédie ; d’autres, par exemple à propos du capitalisme, manquent leur cible tant ils apparaissent sommaires. Le lecteur comprend bien qu’il s’agit de restituer quelque chose du chaos du monde, de sa complexité et, certes, la narratrice y insiste, le lecteur « ne doit pas chercher les grandes révélations » ; certes, elle renvoie à la fin du livre, à une longue liste « des noms de tous les auteurs d’après lesquels l’ouvrage a été écrit, personne n’écrivant seul ». Il n’empêche qu’un décalage existe entre le récit proprement dit, au tissage subtil et efficace, et ce qui apparaît souvent comme fragments étrangers — mais la narratrice insiste sur le fait qu’elle veut « une poésie documentaire, philologique, engagée objectivement dans le monde », et l’histoire de l’oncle est à lire comme élément parmi d’autres de l’histoire d’une époque.
On préfère retenir ce que l’oncle bossu a appris à la narratrice, « le poème non scriptum de nos échanges (...) juste le don de l’instant » — elle l’imagine d’ailleurs juste avant sa mort avec dans ses bras « le cadavre de l’instant » et, lisant son journal, elle retient sa description d’une prairie sèche : « une prolifération de hasards, un milieu anarchique (...). C’est un libre désordre », description qui pourrait être celle de la société, mais aussi celle d’Affranchissements.
Muriel Pic, Affranchissements, Seuil, 2020, 288p., 19 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 4 novembre 2020.
1 Frances Yates est surtout connue en France pour son livre L’Art de la mémoire (1966, traduit en 1987).
2 17 poèmes, d’abord écrits en anglais et présentés avec leur traduction.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : muriel pic, affranchissements : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2020
Jacques Réda, Le fond de l'air, Chroniques de La NRF, 1988-1995

Le pompon [1991]
À l’occasion d’une Fête de la poésie intitulée Pour la poésie [...] événement national créé à (sic) l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, se sont tenus les 12, 13 et 14 juin derniers, à Marseille, des États généraux de la Poésie. On ne sait trop de quels mandants les délégués avaient reçu leur charge, mais on identifiait aisément deux ou trois représentants de la noblesse, des observateurs délégués par le clergé, quelques figures typiques du tiers état. Cette assemblée se proposait de dresser un état des lieux de la poésie d’aujourd’hui [...] pour aboutir à toute une série de propositions concrètes dans différents domaines en faveur de la poésie. On peut donc espérer que ces États généraux ne tarderont pas à engendrer une Constituante, puis une Législative accouchant à son tour d’une Convention et, peut-être, d’une petite Terreur. Car à quoi des propositions concrètes serviraient-elles si elles ne devaient pas déboucher sur des mesures de salut public ? Les États généraux n’ayant pas hésité à aborder la question de la création poétique elle-même, on est en droit d’attendre une définition enfin officielle, administrative, voire obligatoire, d’une poésie garantie par le gouvernement. Avouons que ce sera bien commode.
Jacques Réda, Le fond de l’air, Chroniques de La NRF, 1988-1995, Gallimard, 2020, p. 90-91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l’air, chroniques de la nrf, 1988-1995, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2020
Fernando Pessoa, Bureau de tabac

Bureau de tabac
Je ne suis rien.
Je ne serai jamais rien.
Je ne peux vouloir être rien.
À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde.
Fenêtres de ma chambre,
Ma chambre où vit l’un des millions d’êtres au monde, dont personne ne sait
qui il est
(Et si on le savait, que saurait-on ?),
Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,
Une rue inaccessible à toutes pensées,
Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret,
Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres,
Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,
Avec le destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.
Aujourd’hui je suis vaincu comme si je savais la vérité.
Aujourd’hui je suis lucide comme si j’allais mourir
Et n’avais d’autre intimité avec les choses
Que celle d’un adieu, cette maison et ce côté de la rue devenant
Un convoi de chemin de fer, un coup de sifflet
À l’intérieur de ma tête,
Une secousse de mes nerfs, un grincement de mes os à l’instant du départ.
[…]
Tabacaria
Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Janelas do meu quarto,
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é
(E se soubessem quem é, o que saberiam ?)
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente,
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,
Real, impossívelmente real, certa, deconhecidamente certa,
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres,
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens,
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, come se estívesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
[…]
Fernando Pessoa, Bureau de tabac, traduit par Rémy Hourcade, éditions Unes, 1993, p. 37-38 et 15-16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pessoa Fernando | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, bureau de tabac | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2020
Jean Paulhan, Braque le patron

Plus ressemblant que nature
Je ne crois guère aux fantômes, ni aux spectres. Mais je vois bien que j’ai tort. Parce qu’au fond nous y croyons tous, et qu’il serait plus loyal de l’avouer. Jamais un homme normal ne s’est tout à fait reconnu dans ses portraits. Le jour où l’on nous fait voir notre profil dans un jeu de miroirs, entendre notre voix dans un disque, lire nos vieilles lettres d’amour, est un mauvais jour pour nous : et sur le moment nous avons plutôt envie de hurler. Tant il est évident que nous sommes n’importe quoi, mais pas ça. Les photos exactes, les portraits fidèles, peuvent être puissants subtils, beaux ou laids. Ils ont un trait qui passe de loin ceux-là : c’est qu’ils ne sont pas ressemblants. Montaigne était à peu près le contraire du rat sadique que nous montrent les images. Léonard de Vinci n’avait pas vraiment l’air d’un chrysanthème, ni Gœthe d’un melon. Il faut avertir dès maintenant nos petits-fils que nous n’avons rien de commun avec les tristes images qu’ils garderont de nous.
Mais il est plus difficile de savoir ce que nous sommes, et l’idée physique que nous en formons. Peut-être nous voyons nous secrètement en écorchés ? Non, c’est moins sanglant. En squelettes ? Non, c’est moins décisif. C’est à la fois insaisissable et diablement net. C’est assez précisément ce qu’on appelle un spectre, et somme toute cela nous est familier, puisque nous l’avons en tête à tout moment. C’est d’ordre aussi pratique qu’un escargot ou un citron.
Un citron. Voilà où je voulais en venir. Car il nous semble, bien entendu, que l’escargot ou le citron doit être content de son apparence, si l’homme ne l’est pas ; que c’est tout ce qu’il mérite, qu’il n’avait qu’à ne pas être escargot. Mais il se peut qu’il n’en soit rien. Il est même vraisemblable (sitôt que l’on y songe) que l’escargot, lui aussi, ne cesse de protester (silencieusement) contre la coquille, les yeux à échasses et même la peau nacrée que nous lui voyons. Et peut-être se trouvera-t-il un jour des peintres assez subtils — ou, qui sait, suffisamment avertis — pour prendre le parti de cet escargot intérieur ; pour traiter les cornes et la coquille comme elles souhaitent d’être traitées.
Je ne cherche qu’à être fidèle, tant pis si j’ai l’air sot. Qu’il y ait un secret chez Braque comme il y en a un chez Van Gogh ou Vermeer — c’est ce dont ne laisse pas douter une œuvre à tout instant pleine et suffisante : fluide (sans qu’il soit besoin d’air) ; rayonnante (sans la moindre source de lumière) ; à la fois attentive et quiète : réfléchie jusqu’à donner le sentiment d’un mirage posé sur sa réalité. Pourtant, sitôt que je veux nommer ce secret ou le sentiment du moins qu’il me laisse, voici tout ce que je trouve : c’est que Braque propose aux citrons, aux poissons grillés et aux nappes, inlassablement, ce qu’ils attendaient d’être. Ce après quoi ils soupiraient : leur spectre familier. Il y a je ne sais quoi de triste dans un devoir ; d’amer dans une attente : c’est que l’on craint d’être déçu. Mais chaque tableau de Braque donne le sentiment d’une attente joyeuse, et d’un devoir comblé.
Bien entendu, il faudrait là-dessus des preuves. — Et je les donnerai. Au demeurant, je ne dis rien que de banal. (Il suffirait bien d’user d’un autre mot — de parler d’idéal, par exemple.) Tant mieux. Ce que je voulais dire aussi, c’est que la peinture de Braque est banale. Fantastique sans doute, mais commune. Fantastique, comme il est fantastique, si l’on y réfléchit, d’avoir un nez et deux yeux, et le nez précisément entre les deux yeux.
Jean Paulhan, Braque le patron, Gallimard, 1952, p. 17-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, braque le patron, spectre, ressemblance | ![]() Facebook |
Facebook |
Vladimir Pozner, Un camp de barbelés, dans les camps de réfugiés espagnols en France, 1939
[les réfugiés espagnols] portaient des uniformes crasseux, des couvertures trouées, des vestes sans boutons, des pantalons effilochés, des peaux de bique, des redingotes 1900, des bonnets de police, des casquettes d’aviateurs, des serviettes de toilettes roulées en turban, des godasses de soldats, des espadrilles, des semelles découpées dans des pneus et attachées aux chevilles avec du fil de fer. Ils sommeillaient, bavardaient, construisaient des feux, s’épouillaient, flânaient et attendaient, pauvres Robinsons espagnols, le bateau qui n’arrivait jamais. Ils n’avaient rien à envier à Crusoé, sauf la liberté. Leur île déserte était entourée de barbelés et gardée par des sentinelles, baïonnette au canon. Aucun Espagnol ne pouvait sortir du camp, personne ne pouvait y pénétrer.
Vladimir Pozner, Un camp de barbelés, dans les camps de réfugiés espagnols en France, 1939, Claire Paulhan, 2020, p. 190-191.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir pozner, un camp de barbelés, dans les camps de réfugiés espagnols en france, 1939 | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2020
Cesare Pavese, Travailler fatigue

La putain paysanne
Le grand mur qui est en face et clôture la cour
a souvent des reflets d’un soleil enfantin
qui rappellent l’étable. Et la chambre en fouillis
et déserte au matin, quand le corps se réveille,
sait l’odeur du premier parfum gauche.
Même le corps enroulé dans le drap est pareil à celui
des premières années, que le cœur bondissant découvrait
On s’éveille déserte à l’appel prolongé
du matin et dans la lourde pénombre resurgit
la langueur d’un autre réveil : l’étable
de l’enfance et le soleil ardent pesant las
sur les seuils indolents. Léger,
un parfum imprégnait la sueur coutumière
des cheveux, et les bêtes flairaient. Le corps
jouissait furtivement de la caresse du soleil
insinuante et paisible comme un attouchement.
La langueur du lit engourdit les membres étendus,
jeunes et trapus, presqu’encore enfantins.
L’enfant gauche flairait les senteurs
du tabac et du foin et tremblait au contact
fugitif de l’homme : elle aimait bien jouer.
Quelquefois elle jouait étendue dans le foin
avec un homme, mais il ne humait pas ses cheveux :
il cherchait dans le foin ses membres contractés,
puis il les éreintait, les brisant comme l’eût fait son père.
Comme parfum, des fleurs écrasées sur les pierres.
Bien souvent, pendant le long réveil
revient cette saveur sure des fleurs lointaines,
d’étable et de soleil. Aucun homme ne sait
la subtile caresse de cet âcre souvenir.
Aucun homme ne voit par-delà le corps étendu
cette enfance passée dans une attente gauche.
La putana contadina
La muraglia di fronte che accieca il cortile
ha sovente un riflesso di sole bambino
che ricorda la stalla. E la camera sfatta
e deserta al mattino quando il corpo si sveglia,
sa l’odore del primo profumo inesperto.
Fino il corpo, intrecciato al lenzuolo, è lo stresso
dei primi anni, che il cuore balzava scoprendo.
Ci si sveglia deserte al richiamo inoltrato
del mattino e riemerge nella greve penombra
l’abbandono di un altro risveglio : la stalla
dell’infanzia e la greve stanchezza del sole
coloroso sugli usci indolenti. Un profumo
impregnava leggero il sudore consueto
dei capelli, e le bestie annusavano. Il corpo
si godeva furtivo la carezza del sole
insinuante e pacata come fosse un contatto.
L’abbandono del letto attutisce le membra
stese giovani e tozze, come ancora bambine.
la bambina inesperta annusava il sentore
del tabacco e del fieno e tremava al conttato
fuggitivo dell’uomo : le piaceva giocare.
Qualche volta giocava distesa con l’uomo
dentro il fieno, ma l’uomo non fiutava i capelli :
le cercava nel fieno le membra contratte,
le fiaccava, schiacciandole come fosse suo padre.
Il profumo eran fiori pestati sui sassi.
Molte volte ritorna nel lento risveglio
quel disfatto sapore di fiori lontani
e di stalla e di sole. Non c’è uomo che sappia
la sottile carezza di quelle’acre ricordo.
Non c’è uomo che veda oltre il corpo disteso
quell’infanzia trascorsa nell’ ansia inesperta.
Cesare Pavese, Travailler fatigue [Lavorare stanca], édition bilingue, traduit de l’italien par Gilles de Van, Gallimard, 1962, p.107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, travailler fatigue [lavorare stanca], la putain paysanne | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2020
Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre
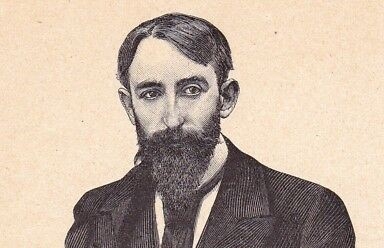
L’hiver
Merd’ ! V’là l’hiver et ses dur’tés,
V’là l’moment de n’pus s’mett » à poils ;
V’là que’ ceuss’ qui tienn’nt la queu’ d’la poêle
Dans l’Midi vont s’carapater !
V’là l’temps ousque jusqu’en Hanovre
Et d’Gibraltar au cap Gris Nez,
Les Borgeois, l’soir, vont plaind’ les Pauvres
Au coin du feu... après dîner !
Et v’là le temps ousque dans la Presse,
Entre un ou deux lanc’ments d’putains,
On va r’découvrir la Détresse,
La Purée et les Purotains !
Les jornaux, mêm’ ceuss’ qu’a d’la guigne,
À côté d’artiqu’s festoyants
Vont êt’ pleins d’appels larmoyants,
Pleins d’sanglots... à trois sous la ligne !
(...)
Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre,
Poésie/Gallimard, 2020, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jehan rictus, les soliloques du pauvre, hiver, oral | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2020
Natacha Michel, Catherine Varlin

Catherine Varlin était belle. C’était une femme que sa petite taille cajolait d’une énigmatique prestance. Sans doute parce qu’elle avait dans mon souvenir de larges épaules, qui donnait quelque chose de costaud à sa sveltesse. Un visage de lionne aux yeux bleus (je me les rappelle bleus) l’apparentait aux sculptures précieuses qui surprennent en changeant de matière par les quartz brillants plantés dans l’orbite. Le tracé sans hésitation de ses hautes pommettes cintrait ses traites en porte romane. Elle avait de splendides cheveux anciens torsadés en chignon qui faisaient penser à leur déroulement. Je ne me souviens pas de l’avoir entendu rire, mais elle souriait sans cesse. Plus exactement je me rappelle un sourire dans le sourire, guetteur masqué, qui parcourait ses lèvres mieux que du rouge, qu’elle fût en train de parler ou baillât, pli sceptique, patient, craintif, savant, ligne tourmenté comme la bouche des vieux juifs sur le point de raconter une histoire, petite flamme chantournée et horizontale assez semblable à un huit couché où l’épaisseur des lèvre emplit les deux ballons du signe, tandis que la torsade jointive du chiffre s’amincit jusqu’à la colère, la crainte, ou la prisse. Je n’oublie pas les commissures soupe au lait qui bouillaient parfois de quelques bulles.
Natacha Michel, Catherine Varlin, dans 591, n° 8, 2020, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natacha michel, catherine varlin, portrait | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2020
Fabrice Caravaca, lalali : recension

Les ouragans se multiplient tout comme les raz-de-marée dévastateurs, les inondations détruisent récoltes et villes, le réchauffement climatique s’accroît et la banquise, le pergélisol fondent, les glaciers se réduisent..., en même temps les conflits armés se développent, les antagonismes entre les "grandes" puissances ne s’apaisent pas. De là à envisager la possibilité d’une apocalypse, une destruction de l’humanité, le pas est franchi par les survivalistes et autres effondristes. Ce scénario a été très souvent utilisé depuis, par exemple, La peste écarlate (1912) de Jack London ; Fabrice Caravaca part de cette perspective d’une quasi disparition de la vie terrestre pour, en de courtes séquences, imaginer des humains qui n’auraient plus aucune notion de la civilisation dont ils sont pourtant issus, comme si une catastrophe avait entraîné son oubli.
Certains ont emporté (mais d’où venaient-ils ?) des outils du "monde d’avant" sans plus en connaître l’usage. Des hommes attendent dans le silence et des femmes nues, ensemble, s’habillent ; les premiers semblent avoir perdu tout souvenir d’un passé devenu trop lointain, le visage des secondes ne manifeste rien de ce qu’elles ressentent. Hommes et femmes « forment une tribu » qui survit grâce à des « lois précises », mais ils vivent séparés les uns des autres. Ces humains d’un autre temps, comme beaucoup d’animaux, dorment peu ; ils ont oublié ce qu’est « la parole partagée », vivent « sans passion » dans un nulle part partagé en deux saisons — humide et chaude, humide et froide —, sans rien attendre, et pour eux le temps se réduit à l’instant.
Ils occupent des villages partiellement détruits et ils attendent la nuit pour se retrouver, « Ce sera le début de la chasse » — on reconnaît dans le titre hallali ; à l’origine le mot, dans le vocabulaire de la chasse, est apparu sous la forme ha la ly. Les petits animaux ne suffisent pas pour nourrir le groupe mais les grands, dangereux, prennent les humains pour proie et s’approchent parfois de leurs habitations. Cependant, il arrive que de gros oiseaux de la plage s’égarent, plus faciles à tuer.
Ces humains enterrent leurs morts et, les nuits de pleine lune, s’enduisent le corps de graisse pour danser nus ; pendant la saison chaude, ils s’exposent au soleil quand la pluie cesse un peu. Quand ils quittent leurs abris, ils ne peuvent se déplacer que vers la forêt ou la plaine, l’une et l’autre sans fin, ignorant si d’autres groupes sont installés ailleurs et ne s’en préoccupant guère. L’activité est réduite pour l’essentiel à la recherche de nourriture et, contre le froid et l’humidité, à la confection de vêtements de peau et à l’entretien du feu.
Le récit ne s’appuie pas sur des descriptions de la vie des préhistoriques, beaucoup plus complexes dans leurs activités, mais vise plutôt à suggérer ce que pourraient être les jours des humains privés d’échanges verbaux et donc de toute vie spirituelle. Dans cette fiction, il n’y a pas de parole — le récit s’achève avec l’image dans la forêt d’un homme qui « crie » — et « Hommes et femmes ignorent l’existence des rêves ». Il ne s’agissait pas pour Fabrice Caravaca de renouveler le genre de la science-fiction, simplement de rappeler que l’humanité ne vit pas sans i Les ouragans se multiplient tout comme les raz-de-marée dévastateurs, les inondations détruisent récoltes et villes, le réchauffement climatique s’accroît et la banquise, le pergélisol fondent, les glaciers se réduisent..., en même temps les conflits armés se développent, les antagonismes entre les "grandes" puissances ne s’apaisent pas. De là à envisager la possibilité d’une apocalypse, une destruction de l’humanité, le pas est franchi par les survivalistes et autres effondristes. Ce scénario a été très souvent utilisé depuis, par exemple, La peste écarlate (1912) de Jack London ; Fabrice Caravaca part de cette perspective d’une quasi disparition de la vie terrestre pour, en de courtes séquences, imaginer des humains qui n’auraient plus aucune notion de la civilisation dont ils sont pourtant issus, comme si une catastrophe avait entraîné son oubli.
Certains ont emporté (mais d’où venaient-ils ?) des outils du "monde d’avant" sans plus en connaître l’usage. Des hommes attendent dans le silence et des femmes nues, ensemble, s’habillent ; les premiers semblent avoir perdu tout souvenir d’un passé devenu trop lointain, le visage des secondes ne manifeste rien de ce qu’elles ressentent. Hommes et femmes « forment une tribu » qui survit grâce à des « lois précises », mais ils vivent séparés les uns des autres. Ces humains d’un autre temps, comme beaucoup d’animaux, dorment peu ; ils ont oublié ce qu’est « la parole partagée », vivent « sans passion » dans un nulle part partagé en deux saisons — humide et chaude, humide et froide —, sans rien attendre, et pour eux le temps se réduit à l’instant.
Ils occupent des villages partiellement détruits et ils attendent la nuit pour se retrouver, « Ce sera le début de la chasse » — on reconnaît dans le titre hallali ; à l’origine le mot, dans le vocabulaire de la chasse, est apparu sous la forme ha la ly. Les petits animaux ne suffisent pas pour nourrir le groupe mais les grands, dangereux, prennent les humains pour proie et s’approchent parfois de leurs habitations. Cependant, il arrive que de gros oiseaux de la plage s’égarent, plus faciles à tuer.
Ces humains enterrent leurs morts et, les nuits de pleine lune, s’enduisent le corps de graisse pour danser nus ; pendant la saison chaude, ils s’exposent au soleil quand la pluie cesse un peu. Quand ils quittent leurs abris, ils ne peuvent se déplacer que vers la forêt ou la plaine, l’une et l’autre sans fin, ignorant si d’autres groupes sont installés ailleurs et ne s’en préoccupant guère. L’activité est réduite pour l’essentiel à la recherche de nourriture et, contre le froid et l’humidité, à la confection de vêtements de peau et à l’entretien du feu.
Le récit ne s’appuie pas sur des descriptions de la vie des préhistoriques, beaucoup plus complexes dans leurs activités, mais vise plutôt à suggérer ce que pourraient être les jours des humains privés d’échanges verbaux et donc de toute vie spirituelle. Dans cette fiction, il n’y a pas de parole — le récit s’achève avec l’image dans la forêt d’un homme qui « crie » — et « Hommes et femmes ignorent l’existence des rêves ». Il ne s’agissait pas pour Fabrice Caravaca de renouveler le genre de la science-fiction, simplement de rappeler que l’humanité ne vit pas sans imaginaire.
Fabrice Caravaca, lalali, éditions marguerite waaknine, 2020, 44 p., 7 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 octobre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice caravaca, lalali, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2020
Jude Stéfan, Aux Chiens du soir
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

les yeux d’Emma
ocre fougère bistre clairière
amande noisette et verdissants
au soir ou tristes éblouis de
liesse absents vacants il y
a tout dans les yeux de ton nom
dans le nom de tes yeux le non
de ta promesse aime et âme et elle
aima souverains offensés bruns
et lus par cœur où sont-ils en-
volés où s’égrène ton rire avec ?
trois fois je suis passé devant
ta maison vide sans leur flamme
Jude Stéfan, Aux Chiens du soir,
‘’Le Chemin’’/Gallimard, 1979, p. 79.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, aux chiens du soir | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2020
Jude Stéfan, Que ne suis-je Catulle
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

thérèse I
premier baiser sous la lune
dans la ruelle au ruisseau
avec perle qui éclaire le
sourire à l’iris brun sou-
dain un rat qui lape l’eau
mollesse des seins
puis flâner, le piano, les pluies,
ta blouse les plantes et le lit
le nu, les bois, les soirs, l’adieu
énorme regret
par ineptie perdue la vie
wie ist es mir geschehn ? comme
à Arnim : que m’est-il arrivé ?
Jude Stéfan, Que ne suis-je Catulle ?
Gallimard, 2010, p. 33.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, que ne suis-je catulle ? | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2020
Jude Stéfan, Suites slaves
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

Suite n°17 : Vers tombeaux.
(...)
il s’écrie / il s’écrit /
la sous la couronne /
St (e) e (nue) fans
qui parle avec énergie
ou
st (r) e (nue) f (ans) anus
qui parle avec énergie aux vieilles /
leur disant leur enjoignant d’encore jouir / fût-ce
de la bouche / c’est pourquoi il fut dit du démon
possédé / dont le nom en hébreu signifie règle aussi
bien / d’encore se défendre contre la mort plus vieille
qu’elles / enjoignant à sa mère à sa sœur aimée aî-
née à sa voisine / avec énergie vaillance guerrière /
strénument / comme mourut son aïeul ivrogne / d’un
net coup de sabot / et lui d’un net coup de pistolet
ou de rasoir (c’était au siècle dernier avant l’expi-
ration de la concession à fausse perpétuité) / avant
l’oubli des herbes et des tombes / un exemple aux autres
de souffrir / régulièrement avec droiture / constamment
agir dans la sincérité de ses faiblesses / la dignité
de son membre et déchets quotidiens / longtemps après
les martyrs / et en bas il lut l’enfant — le nouveau
mourant /
A RAISON L’HERBE
Jude Stéfan Suites slaves, Ryôan-ji, 1983, p. 81.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan suites slaves | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2020
Jude Stéfan, À la Vieille Parque
Jude Stéfan, 01/07/1920-11/11/2020

à tous morts en 1984
aux chiens du soir répondent les étrons matinaux
quand l’haleine se dit des vents
la bête est sur ses fins
immobile aux coups
un débris des halles
apaisé comme un qui urine entre cerise et rose
sous l’horreur nue de la troisième heure
enlisé George dans tes idylles bergères
les moutons n’ont pas froid à brouter blanc
et chaque année donne leur mort aux noms
Foucault Michaux Cortazar ou Magne
le lexovien
ordure du cœur ordure de l’être
mes doigts crispés aux robes-cuisses mères
Jude Stéfan, À la Vieille Parque, ‘’Le Chemin’’/ Gallimard,
1989, p. 32.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, À la vieille parque | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2020
Jude Stéfan, Aux Chiens du soir
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

sur la grève
a fui l’hiver avec
ses enfants dans les jardins de neige
ici temps et marée n’attendent personne
« en vieil anglais steorfan veut dire
mourir » et si j’en retranche l’or reste
ma vie terne
or voici la sterne la visiteuse d’été
haute là-bas sur la mer
où le cerveau n’est que nuée
à ton interrogation la fleur répond :
efface-toi tout vivant du monde avant
la Mort qui glousse au loin près des épaves
Jude Stéfan, Aux chiens du soir, ‘’Le Chemin’’/
Gallimard, 1979, p. 51.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, aux chiens du soir | ![]() Facebook |
Facebook |





