29/01/2012
Guillevic, Art poétique
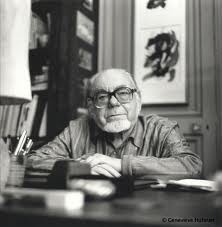
Écrire le poème
C'est d'ici se donner un ailleurs
Plus qu'ici auparavant.
Un travail : créer
De la tension
Entre les mots.
Faire que chacun
En appelle un
Ou plusieurs autres.
Ils ne tiennent
Pas tellement à venir
De leur plein gré.
Quand ils arrivent
Ils sont arrimés
Irrévocablement
Par un silence
Qui ne sera
Jamais rompu.
Le poème
Nous met au monde.
Forcé d'écrire ?
Je n'en ai pas envie.
J'aimerais
Rester là, immobile.
À regarder le ciel,
Il n'y a pas plus bleu.
Et de temps en temps
L'horizon et ses approches.
Je voudrais
Me passer des mots.
Guillevic, Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant, Préface de Serge Gaubert, Poésie / Gallimard, 2001, p. 260, 280, 291, 294.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, art poétique, écrire, les mots | ![]() Facebook |
Facebook |
25/12/2011
Pascal Quignard, La nuit sexuelle

Golgotha
Le Golgotha est encore un orage. C'est encore une colline enveloppée d'un orage qui vient créer la nuit noire en plein jour. La mère regarde son enfant mort. Au puits de la grotte s'est substituée la nef d'une église. À la torche s'est substitué le cierge. Mais les corps humains tombés dans la mort présentent la même opisthotonie déroutante. De Lascaux au-dessus de Montignac à Colmar sur la Lauch en Alsace, c'est toujours le corps incurvé de la transe. Opisthotonie, possession, transe, cauchemar — tous jettent soudain les bras en arrière, disloquent la tête, arquent le corps, font tomber sur le sol derrière eux. Sous les yeux de la jument nocturne (mare), l'elfe pesant sur son ventre, la Morgane de Füssli est arquée comme le chasseur paléolithique du Puits.
Le passage du charognage à l'attaque imitée des mœurs des grands animaux a demandé des centaines de millénaires à notre espèce. La représentation de la scène de charognerie doit être distinguée de celle de la curée. Les pièges, qui sont animaux, sont plus anciens que la chasse (la prédation imitée), qui est humaine. Il faut disjoindre ces deux fonctions. D'un côté le charognage, ses pièges, ses battues, ses fosses, ses grottes. De l'autre la vision immobile, le guet-appensé, l'attaque, la mise à mort, le partage sanglant de la viande fondant le sacrifice. Des millénaires pour chaque stade, encore que ces deux stades soient des lectures de signes, des « visions ». Ce sont des millénaires de visions réelles mais aussi de hantises diurnes, d'hallucinations affamées, de rêves nocturnes involontaires. La scène primitive qi s'élève involontairement dans les songes fit appel à ces deux lots d'images fondamentales, d'abord antéhumaines, puis préhistoriques.
D'une part charognage. De l'autre curée.
La chasse inventée à partir de la carnivorie imitée, la sacrifice sanglant de victimes humaines, l'initiation sanglante des pubères, les guerres historiques sont autant de rituels reproduisant la métamorphose princeps de proie en prédateur.
Durant des millénaires les hommes exterminent les fauves.
Les surmassacres furent d'abord des démonstrations spectaculaires des prouesses prédatrices des hommes.
C'est l'arène romaine. Ce sont les pyramides méso-américaines. Toute vie se paie d'une autre vie.
In suo peccato morietur. Chaque humain mourra dans son péché. Nous amassons des trésors pour le jour de colère. Nudus exii de utero matris. Nu je suis sorti de l'utérus de ma mère. Nu je retournerai dans la terre. Car nous n'avons rien apporté à ce monde.
Le mal, dit Augustin, convocat spectatores.
La souffrance illimitée attire irrésistiblement (éternellement) les regards.
La suite des séquences de la passio et Mors Jesu est traditionnelle dès la fin du monde antique : l'arrestation nocturne dans le jardin de Gethsémani, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de Croix, la montée au mont des Oliviers, la crucifixion des pieds et des mains, le percement du flanc par le fer de la lance, la mort dans l'orage sur le calvaire, la descente de Croix, la mise au tombeau. Comme le fond de la nuit est bleu Dürer dessina Die Grüne Passion, en 1503 et en 1504, au crayon blanc, sur un papier dont la teinte bleue vire lentement au vert.
Pascal Quignard, La nuit sexuelle, chapitre X, Flammarion, 2007, J'ai lu en images, 2009, p. 77-81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2011
Jacques Dupin, L'espace autrement dit
 Voir la réalité, pour Giacometti, c’est ouvrir les yeux sur le monde comme s’il venait de surgir pour la première fois. C’est inventer un regard neuf, un regard débarrassé et nettoyé des conventions qui substituent le concept à la sensation et le savoir au voir. Cette purification du regard et la fraîcheur du monde qui lui répond, ne s’obtiennent qu’au prix d’un affrontement répété et violent avec la réalité, une lutte passionnelle et incessante qui tisse entre les protagonistes un lien privilégié, seul capable de mesurer leur éloignement et de signifier leur altérité essentielle.
Voir la réalité, pour Giacometti, c’est ouvrir les yeux sur le monde comme s’il venait de surgir pour la première fois. C’est inventer un regard neuf, un regard débarrassé et nettoyé des conventions qui substituent le concept à la sensation et le savoir au voir. Cette purification du regard et la fraîcheur du monde qui lui répond, ne s’obtiennent qu’au prix d’un affrontement répété et violent avec la réalité, une lutte passionnelle et incessante qui tisse entre les protagonistes un lien privilégié, seul capable de mesurer leur éloignement et de signifier leur altérité essentielle.
Car la réalité que l’œil perçoit ne se découvre qu’à distance, immergée dans son espace et cernée par le vide qui la retranche. L’œil devra dicter à la main qui dessine — ou peint, ou modèle —, les moyens de traduire en même temps que les signes plastiques de l’objet, tout ce qui l’isole, l’enferme dans son espace, le rive à la profondeur et ne laisse surgir que sa vérité distante et séparée. Autant que ses traits distincts, l’œil devra donc saisir et restituer son éloignement, son appel, et toute la complexité du rapport qui le lie à lui en le laissant inaccessible. L’image recrée devra unir les signes d’une présence et les traces d’un retrait.
Jacques Dupin, L’espace autrement dit, éditions Galilée, 1982, p. 55-56.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2011
Jean Frémon, Antoni Tàpies, La substance et les accidents

Asocial, le graffiti ? Seulement en apparence, quand la société diverge par trop de l’espèce ; c’est alors que des individus, croyant ne se réclamer que d’eux-mêmes, manifestent au nom de l’espèce. Le mur, la table qui ont vécu, vieilli, appellent le grafiti. Le poseur de graffiti est rarement le premier, il suit, il imite, il répond, il répète, il décale, il ironise. À son insu, il entre par quelques signes dans un mode particulier de rapport entre l’espèce et le monde ; se croyant incompris, le poseur de graffiti signe son appartenance à l’espèce et à sa culture. Comme l’artiste, il s’écarte et révèle ce qu’on ne veut pas mais qui cependant est. Il catalyse.

C’est cette écriture du désir, pur supplément de corps, qu’on trouve dans la peinture de Tàpies. Et toute une théorie de signes élémentaires, lettres, chiffres, accolades, parenthèses, guillemets, tirets, plus, moins, infini, égal, qui ne dénotent qu’eux-mêmes ; nul sous-entendu en aparté, nul dialogue, nulle démonstration, ils sont là comme les signes illisibles d’une activité intellectuelle insaisissable et sont séparés des mouvements profonds du corps lui-même.
Jean Frémon, Antoni Tàpies, La substance et les accidents, éditions Unes, 1991, p. 39-40.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean frémon, antoni tàpies, graffiti | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2011
Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation

Peinture et sensation
Il y a deux manières de dépasser la figuration (c’est-à-dire à la fois l’illustratif et le narratif) : ou bien vers la forme abstraite, ou bien vers la Figure. Cette voie de la Figure, Cézanne lui donne un nom simple : la sensation. La Figure, c’est la forme sensible rapportée à la sensation ; elle agit immédiatement sur le système nerveux, qui est de la chair. Tandis que la forme abstraite s’adresse au cerveau, agir par l’intermédiaire du cerveau, plus proche de l’os. Certes Cézanne n’a pas inventé cette voie de la sensation dans la peinture. Mais il lui a donné un statut sans précédent. La sensation, c’est le contraire du facile et du tout fait, du cliché, mais aussi du « sensationnel », du spontané, etc. La sensation a une face tournée vers le sujet (le système nerveux, le mouvement vital, « l’instinct », le « tempérament », tout un vocabulaire commun au Naturalisme et à Cézanne), et une face tournée vers l’objet (« le fait », le lieu, l’événement) Ou plutôt elle n’a pas de face du tout, elle est les deux choses indissolublement, elle est être-au-monde, comme disent les phénoménologues : à le fois je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation, l’un par l’autre, l’un dans l’autre. Et à la limite, c’est le même corps qui la donne et qui la reçoit, qui est à la fis objet et sujet. Moi spectateur, je n’éprouve la sensation qu’en entrant dans le tableau, en accédant à l’unité du sentant et du senti. La leçon de Cézanne au-delà des impressionnistes : ce n’est pas le jeu « libre » ou désincarné de la lumière et de la couleur (impressions) que la Sensation est, au contraire c’est dans le corps, fut-ce dans le corps d’une pomme. La couleur est dans le corps, la sensation est dans le corps, et non dans les airs. La sensation, c’est ce qui est peint. Ce qui est peint dans le tableau, c’est le corps, non pas en tant qu’il est représenté comme objet, mais en tant qu’il est vécu comme éprouvant telle sensation (ce que Lawrence, parlant de Cézanne, appelait l’ « être pommesque de la pomme »).
Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, I, éditions de la différence, 1981, p. 27.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilles deleuze, francis bacon, la sensation, cézanne | ![]() Facebook |
Facebook |
01/09/2011
Jacques Serena, Fleurs cueillies pour rien

Klimt, Le Baiser
Ça recommence, on dirait, d’autres respirations, lentes. Et, comment dire. Oscillantes. Pour commencer, recommencer. Ou pour, qui sait, cette fois, peut-être, finir. Non. Pas encore. D’accord, pas encore. On a le temps. Et microclimats, donc, et teintes sourdes. Semblant à peu près se figer. Bouts de corps se frôlant, entraperçus. Sans bruit, et peut-être une espèce de musique, ou putôt de sons diffus, c’est peu dire que dire aux confins de l’audible. À en douter. En prendre son parti. Au point où j’en suis. Voyons voir, si moyen que, oui. Ça se précise. De la joie, cette fois, dans l’air. De l’air, donc. Avec, dedans, des tourbillons de. Disons de silence, de ces infimes sons qui, interférant, font le silence. C’est moi, encore, au centre, à ce qu’il semblerait, mais elles. Parce que ces corps, oui, c’est encore elles, souvent. Ce qui frappe, là, c’est l’or, la sensation d’ineffable que ça donne, pour ne as dire de céleste à cause de. Elles passent à portée. J’en frôle, j’en touche, au passage. Je n’en touche plus. N’en toucherai plus. Si, encore. Il faudrait qu’elles sachent que jamais je n’ai touché de corps plus voluptueux. De plus réel, jamais.

En bas, un bois, troncs de bouleaux luisants faiblement, troupes de vieille cavalerie s’entrechoquant, antiques revenants encombrés d’armes rouillées, entrant en collision maladroite les uns contre les autres, silhouettes de fosse commune tondues, projetées déguisées à travers la nuit, au bas des pentes au fond invisible, entre le noir et la noirceur pire pressentie. Et rires, clameurs de carnaval. Je sens avec la lucidité du fou la nature périssable de ma chair. Des prostituées laides appellent dans la nuit, mal drapées dans des hardes voyantes. Vieilles poupées sorties d’un rêve scabreux.
La dernière bougie flanche, la mèche penche, s’affaisse dans un mince sifflement. J’en perds mes propres limites. Ne sais plus où je finis et où commence le monde. Devenu grand comme l’atelier. Ou aussi bien petit, infiniment. Sentant le sol. Mon poids sur le sol. Sentant sous moi la terre aspirer mes os.
Jacques Serena, Fleurs cueillies pour rien, Gustav Klimt, éditions Flohic, 1999, p. 43-44 et 77-78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques sarena, fleurs cueillies pour rien, klimt | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2011
Gertrude Stein, Picasso
 Cézanne dans ses aquarelles avait une tendance à découper le ciel non en cubes, mais en divisions arbitraires ; il y avait aussi déjà le pointillisme de Seurat et de ses successeurs. Mais tout de même cela n’avait rien à voir avec le cubisme parce que tous ces autres peintres, pris par la réduction des choses vues, étaient préoccupés par leur technique qui devait exprimer de plus en plus ce qu’ils voyaient. Enfin de Courbet à Seurat, on peut même dire de Courbet à Van Gogh et à Matisse la plupart des artistes ont vu la nature comme elle est, c’est-à-dire, si vous le voulez, comme tout le monde la voit.
Cézanne dans ses aquarelles avait une tendance à découper le ciel non en cubes, mais en divisions arbitraires ; il y avait aussi déjà le pointillisme de Seurat et de ses successeurs. Mais tout de même cela n’avait rien à voir avec le cubisme parce que tous ces autres peintres, pris par la réduction des choses vues, étaient préoccupés par leur technique qui devait exprimer de plus en plus ce qu’ils voyaient. Enfin de Courbet à Seurat, on peut même dire de Courbet à Van Gogh et à Matisse la plupart des artistes ont vu la nature comme elle est, c’est-à-dire, si vous le voulez, comme tout le monde la voit.
Un jour on demandait à Matisse si, quand il mangeait une tomate, il la voyait comme il la peignait. « Non, dit Matisse, quand je la mange, je la vois comme tout le monde. » Et à vrai dire, de Courbet à Matisse, les peintres ont vu la nature comme tout le monde la voit et leur tourment c’était d’exprimer cela, de le faire avec plus ou moins de tendresse, de sentiment, de sérénité et de profondeur.
Je suis toujours frappée par les paysages de Courbet parce qu’il n’a pas été forcé de changer la couleur pour arriver à donner la vision ordinaire de la nature. Mais Picasso était totalement différent. Quand il mangeait une tomate, la tomate n’était pas celle de tout le monde, pas du tout, et son effort n’était pas d’exprimer à sa manière des choses vues par tout le monde, mais comme lui seul les voyait.
Gertrude Stein, Picasso, Christian Bourgois, 1978 [1938], p. 36-37.
Gertrude Stein par Picasso, 1905-1906.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, picasso, voir la nature | ![]() Facebook |
Facebook |
30/07/2011
Giacometti, dans Charbonnier, Le Monologue du peintre

Cézanne a fait sauter une espèce de bombe dans la représentation du monde extérieur. Jusque-là, régnait une conception, qui était valable, en tout cas depuis le début de la Renaissance, depuis Giotto, très exactement. Depuis cette époque, aucune modification profonde ne s’est produite dans la vision d’une tête, par exemple. Il y a une différence plus grande entre Giotto et les Byzantins, qu’entre Giotto et la Renaissance. La vision d’Ingres, après tout, c’est un peu la même vision qui continue.
Cézanne a fait sauter une bombe dans cette vision en peignant une tête comme un objet. Il le disait : « Je peins une tête comme une porte, comme n’importe quoi ». En peignant l’oreille gauche, en établissant plus de rapports entre l’oreille gauche et le fond qu’avec l’oreille droite, plus de rapports entre la couleur des cheveux et la couleur du chandail qu’avec la structure du crâne, il a fait sauter — et pourtant, ce qu’il voulait, lui, c’était arriver quand même à l’ensemble d’une tête — il a fait sauter totalement la conception qu’on avait avant lui de l’ensemble, de l’unité d’une tête. Il a fait sauter totalement un bloc, il a si bien fait sauter un bloc que, tout d’abord, on a prétendu que la tête devient simple prétexte et que, par conséquent, la peinture est devenue abstraite. Toute représentation qui voudrait revenir aujourd’hui à la vision précédente, c’est-à-dire à la vision de la Renaissance, serait telle que l’on n’y croirait plus. Une tête dont l’intégrité aurait été respectée ne serait plus une tête. Elle relèverait du musée. On n’y croirait plus. Parce qu’il y a eu Cézanne et parce que l’on a inventé la photo. Tout le monde, aujourd’hui, pense évidemment qu’une photo, en matière de ressemblance, est plus ressemblante qu’un tableau. Des peintres abstraits vous font voir… c’est toujours très touchant et ça m’a toujours étonné, et ça m’est arrivé assez souvent… des peintres abstraits sortent la photographie de leur femme et de leurs enfants pour la faire voir. Je me demande bien ce qu’ils veulent me faire voir. Moi, les photos, je ne les vois pas. C’est un signe. Quand je vois la photo d’un petit enfant, du petit-fils d’un peintre abstrait, je regarde et je n’y comprends rien du tout. Mais, pour celui qui me fait voir la photo, il y a là bel et bien, pour lui, une représentation valable de son enfant, de sa femme et du monde extérieur. Donc, trouvant la photo ressemblante, il ne peut plus penser à concourir avec la photo dans la représentation de la réalité. Cézanne est battu d’avance, forcément, hein ?
Alberto Giacometti, dans Georges Charbonnier, Le Monologue du peintre, entretiens avec Braque, Singier, (…) Giacometti, Masson, couverture originale de Giacometti, Julliard, 1959, p. 176-178.
Annette, par Giacometti
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giacometti, eorges charbonnier, le monologue du peintre, photographie, peinture abstraite, cézanne | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2011
Junichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre
 Tous les pays du monde ont certes dû rechercher des accords de couleurs entre les mets, la vaisselle et même les murs ; la cuisine japonaise en tout cas, si elle est servie dans un endroit trop bien éclairé, dans de la vaisselle à dominante blanche, en perd la moitié de son attrait. La soupe au miso rouge, par exemple, que nous consommons tous les matins, voyez un peu sa couleur et vous comprendrez aisément qu’on l’ait inventée dans les sombres maisons d’autrefois. Il m’est arrivé un jour, convié à une réunion de thé, de m’y voir présenter du miso, et cette soupe bourbeuse, couleur d’argile, que j’avais toujours consommée sans y prêter attention, je lui découvris soudain, en la voyant, à la diffuse lueur des chandelles, qui baignait au fond du bol de laque noire, une réelle profondeur et une teinte des plus appétissantes.
Tous les pays du monde ont certes dû rechercher des accords de couleurs entre les mets, la vaisselle et même les murs ; la cuisine japonaise en tout cas, si elle est servie dans un endroit trop bien éclairé, dans de la vaisselle à dominante blanche, en perd la moitié de son attrait. La soupe au miso rouge, par exemple, que nous consommons tous les matins, voyez un peu sa couleur et vous comprendrez aisément qu’on l’ait inventée dans les sombres maisons d’autrefois. Il m’est arrivé un jour, convié à une réunion de thé, de m’y voir présenter du miso, et cette soupe bourbeuse, couleur d’argile, que j’avais toujours consommée sans y prêter attention, je lui découvris soudain, en la voyant, à la diffuse lueur des chandelles, qui baignait au fond du bol de laque noire, une réelle profondeur et une teinte des plus appétissantes.
 […] le riz tout le premier, sa seule vue, lorsqu’il est présenté dans une boîte de laque noire et brillante déposée dans un coin obscur, satisfait notre sens esthétique et du même coup stimule notre appétit. Ce riz immaculé, cuit à point, amoncelé dans une boîte noire, qui dès l’instant que l’on soulève le couvercle, émet une chaude vapeur, et dont chaque grain brille comme une perle, il n’est pas un seul Japonais qui à sa vue n’en ressente l’irremplaçable générosité. Arrivé à ce point, on se rend compte de ce que notre cuisine s’accorde avec l’ombre, qu’entre elle et l’obscurité il existe des liens indestructibles.
[…] le riz tout le premier, sa seule vue, lorsqu’il est présenté dans une boîte de laque noire et brillante déposée dans un coin obscur, satisfait notre sens esthétique et du même coup stimule notre appétit. Ce riz immaculé, cuit à point, amoncelé dans une boîte noire, qui dès l’instant que l’on soulève le couvercle, émet une chaude vapeur, et dont chaque grain brille comme une perle, il n’est pas un seul Japonais qui à sa vue n’en ressente l’irremplaçable générosité. Arrivé à ce point, on se rend compte de ce que notre cuisine s’accorde avec l’ombre, qu’entre elle et l’obscurité il existe des liens indestructibles.
Tanizaki, Éloge de l’ombre, traduction de René Sieffert, dans Œuvres, I, Préface de Ninomiya Masayuki, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1997, p. 1485.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tanizaki, rené sieffert, éloge de l'ombre, laque, riz | ![]() Facebook |
Facebook |
15/07/2011
Roger Bissière, T'en fais pas la Marie
 J’ai horreur de tout ce qui est systématique.
J’ai horreur de tout ce qui est systématique.
De tout ce qui tend à m’enfermer dans des barrières.
Ma peinture est l’image de ma vie.
Le miroir de l’homme que je suis.
Tout entier avec ses faiblesses aussi.
Devant ma toile je ne pense pas au chef-d’œuvre.
Je ne pense même pas au résultat.
Je me berce d’histoires improbables et je mets des couleurs dessus.
Ces couleurs et ces formes n’ont d’autre désir que d’être celles de mes rêves.
De mes joies et de mes peines.
Je vous les livre telles que je les ai créées.
Je n’ai point honte de leurs faiblesses ni d’orgueil de leurs réussites.
Les unes me paraissent aussi émouvantes que les autres.
La perfection d’ailleurs serait inhumaine.
Un tableau sans défaut perdrait son rayonnement et sa chaleur.
Il cesserait d’être l’expression vivante et concrète d’un homme.
D’un homme qui ose se dresser devant vous tel qu’il est vraiment.
Et non pas tel qu’il voudrait être.
Mes tableaux ne veulent rien prouver ni affirmer.
Ils sont la seule façon en mon pouvoir
de restituer des émotions indicibles autrement.
Je peins pour être moins seul en ce monde misérable.
Je suis un être vivant qui s’adresse à d’autres êtres vivants.
Pour avoir moins froid.
Peu de choses au monde, voyez-vous, demandent autant de sincérité que la peinture.
Elle est un miroir fidèle, le peintre s’y reflète tout entier.
Tel qu’il est, sans masque.
Si d’aucuns veulent mentir, cacher leurs faiblesses, imiter des émotions qui ne sont pas les leurs, le tableau les trahit et les dévoile.
Les masques s’avèrent dérisoires.
 Il n’est pas de peintre valable sans acceptation du danger.
Il n’est pas de peintre valable sans acceptation du danger.
Le danger est la condition même de toute création plastique.
Un tableau n’est pas la somme de nos expériences.
Mais une aventure toujours renouvelée.
Une bataille dont l’issue est toujours imprévisible.
Où nous risquons de tout perdre.
Et pourtant celui qui peint ne saurait perdre ou gagner à moitié.
Il en est de la peinture, comme du tir à la cible.
Si on manque le centre, peu importe de quelle distance on l’a manqué.
Rater le train d’une seconde ou d’une heure c’est tout comme.
Aussi je redoute l’à-peu-près.
Je m’y refuse dans la mesure de mes moyens.
Je tâche de pousser mon tableau jusqu’à la limite de mes forces.
Les éléments qui composent toute création plastique sont indissolubles.
Si dans la texture du tableau il subsiste un seul trou, tout s’écroule.
Mais les batailles perdues sont souvent les plus glorieuses.
Elles ont la noblesse que le péril accepté confère à toute chose.
La grandeur du jeu de la vie et de la mort.
La plus beau tableau du monde est d’ailleurs une défaite.
Car la réalisation est toujours inférieure à la conception.
Bissière, texte écrit pour l’exposition Bissière d’Endhoven (Pays-Bas, décembre 1957-janvier 1958), dans T’en fais pas la Marie, écrits sur la peinture 1945-1964, Textes réunis et présentés par Baptiste-Marrey, Le Temps qu’il fait, 1994, p. 37-39.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger bissière, t'en fais pas la marie, écrit sur la peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
30/06/2011
André Malraux, Les Voix du silence
Le Musée imaginaire
I
Un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture, la Madone de Cimabue n’était pas d’abord un tableau, même la Pallas Athéné de Phidias n’était pas d’abord une statue.
Le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d’art est si grand, que nous avons peine à penser qu’il n’en existe pas, qu’il n’en exista jamais, là où la civilisation de l’Europe moderne est ou fut inconnue ; et qu’il en existe chez nous depuis moins de deux siècles. Le XIXe siècle a vécu d’eux ; nous vivons encore, et oublions qu’ils ont imposé au spectateur une relation toute nouvelle avec l’œuvre d’art. Il sont contribué à délivrer de leur fonction les œuvres d’art qu’ils réunissaient ; à métamorphoser en tableaux jusqu’aux portraits. Si le buste de César, le Charles Quint équestre, sont encore César et Charles
Quint, le duc d’Olivares n’est plus que Velasquez. Que nous importe l’identité de l’Homme au Casque, de l’Homme au Gant ? Ils s’appellent Rembrandt et Titien. Le portrait cesse d’être d’abord le portrait de quelqu’un.
Jusqu’au XIXe siècle, toutes les œuvres d’art ont été l’image de quelque chose qui existait ou qui n’existait pas, avant d’être des œuvres d’art, — et pour l’être. Aux yeux du peintre seul, la peinture était peinture ; encore était-elle souvent aussi poésie. Et le musée supprima de presque tous les portraits (le fussent-ils d’un rêve), presque tous leurs modèles, en même temps qu’il arrachait leur fonction aux œuvres d’art. Il ne connut plus ni palladium, ni saint, ni Christ, ni objet de vénération, de ressemblance, d’imagination, de décor, de possession : mais des images des choses, différentes des choses mêmes, et tirant de cette différence spécifique leur raison d’être.
L’œuvre d’art avait été liée, statue gothique à la cathédrale, tableau classique au décor de son époque ; mais non à d’autres œuvres d’esprit différent — isolée d’elles au contraire pour être goûtée davantage. Les cabinets d’antiques et les collections existaient au XVIIe siècle, mais ne modifiaient pas, à l’égard de l’œuvre d’art, une attitude dont celle de Versailles est le symbole. Le musée sépare l’œuvre du monde « profane » et la rapproche des œuvres opposées ou rivales. Il est une confrontation de métamorphoses.
Velasquez, Le duc d'Olivares.
André Malraux, Les Voix du silence, textes présentés et annotés par Christiane Moatti, dans Écrits sur l’art I (Œuvres complètes IV), volume publié sous la direction de Jean-Yves Tadié, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2011, p. 203-204.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré malraux, voix du silence, musée imaginaire | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2011
Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise bourgeois
Faire tapisserie
 Restaurer, reprendre, repriser, raccommoder, ravauder, rapetasser : l’activité, selon les mots qui la disent, peut être noble ou modeste. Louise Bourgeois raconte qu’on lui confiait la réfection des bordures, mais parfois aussi les feuilles de vigne destinées à dissimuler les sexes visibles des hommes nus. Celles-ci n’existaient pas sur le dessin ancien. Mais les acheteurs de son père, des collectionneurs américains pour la plupart, qu’on recevait dans la boutique du boulevard Saint-Germain, avaient de la réserve devant la nudité. Tendue sur un mur de la salle à manger, la tapisserie devait permettre qu’on perde son regard dedans sans être arrêté par aucune pensée lui appartenant. Il s’agissait donc de redonner de la pudeur et de l’éclat, de dissimuler quelques formes et d’en raviver d’autres sans laisser l’impression que plusieurs couches de temps dévaluaient la tenture.
Restaurer, reprendre, repriser, raccommoder, ravauder, rapetasser : l’activité, selon les mots qui la disent, peut être noble ou modeste. Louise Bourgeois raconte qu’on lui confiait la réfection des bordures, mais parfois aussi les feuilles de vigne destinées à dissimuler les sexes visibles des hommes nus. Celles-ci n’existaient pas sur le dessin ancien. Mais les acheteurs de son père, des collectionneurs américains pour la plupart, qu’on recevait dans la boutique du boulevard Saint-Germain, avaient de la réserve devant la nudité. Tendue sur un mur de la salle à manger, la tapisserie devait permettre qu’on perde son regard dedans sans être arrêté par aucune pensée lui appartenant. Il s’agissait donc de redonner de la pudeur et de l’éclat, de dissimuler quelques formes et d’en raviver d’autres sans laisser l’impression que plusieurs couches de temps dévaluaient la tenture.

tapisserie du XVème siècle
Une tapisserie ancienne est terne. Les couleurs se confondent les unes dans les autres, elles ont perdu toutes leurs nuances. Tout devient gris-vert comme un uniforme de soldat. L’ensemble envahi par une poussière de rats. Rien n’est mieux le signe d’un passé sans histoire qu’une tapisserie non restaurée accrochée avec les lustres sur les murs d’un château. Elle ne suggère rien, ne porte la trace d’aucune splendeur, que d’une usure bien plus sensible que celle de la pierre et moins évocatrice que les ruines. On y voit quelque chose du grignotement du temps, des mouvements d’insecte du temps qui font traîner la décomposition en longueur mais l’exhibent néanmoins. La ruine a ceci de satisfaisant pour l’esprit et pour l’œil qui l’ébranle qu’elle montre un passage du temps non marqué par la décomposition. L’analogie avec le corps qui regarde n’est pas immédiate ou n’est que partielle. L’effondrement, l’éboulement, l’effritement de la pierre n’ont ni l’odeur ni la couleur de la décomposition des corps. Une tapisserie qui s’use, si. Le problème posé au corps avec cette tapisserie, n’est pas celui de la représentation du sexe nu, mais cette visibilité qui est donnée de la disparition de toute couleur dans le verdâtre, la fusion du corps propre dans un grand corps terreux.
Tout le sens de la conservation, de la restauration, vient de priver certains objets et certains lieux de leur propension à la décomposition. Il faut dire aux choses : vous avez vécu et ce que vous avez vécu vivra encore. C’est une lutte pour contrecarrer les mouvements évidents du temps, ses signes apparents.
 En 2002, Louise Bourgeois a quatre-vingt-dix ans. Elle fait œuvre d’une première tête usée jusqu’à la corde, qui laisse voir les reprises successives, le ravaudage, les coutures des cicatrices, comme on fait aux ours en peluche. Le rose des lèvres est pâle, les yeux sont perdus dans le vague ou dans le blanc, l’un rentré à l’intérieur de la tête, le bleu qui reste étant le signe d’une réparation qui n’a pas résisté elle non plus. La tapisserie est devenue le visage, son usure exactement celle du corps, la vérité sortant de sa bouche entrouverte. De ces vérités que l’on cherche longtemps et qui viennent de ceux qui retournent des morts. Je la relie à deux choses : la fontaine qu’à Rome on appelle la Bocca della verità. Mettez une pièce dans sa bouche béante et elle sera l’oracle. Et puis ce témoignage d’un survivant des camps : « J’ai toujours pensé, même s’il y a un survivant, ce sera moi. C’est idiot ! Je n’ai jamais pensé que je pouvais mourir, jamais. J’imaginais pas, mourir j’imaginais pas. Moi, mourir ? Parce que j’étais heureux comme tout. Pas au camp, bien sûr, mais avant la guerre. J’étais tapissier, j’étais heureux. »
En 2002, Louise Bourgeois a quatre-vingt-dix ans. Elle fait œuvre d’une première tête usée jusqu’à la corde, qui laisse voir les reprises successives, le ravaudage, les coutures des cicatrices, comme on fait aux ours en peluche. Le rose des lèvres est pâle, les yeux sont perdus dans le vague ou dans le blanc, l’un rentré à l’intérieur de la tête, le bleu qui reste étant le signe d’une réparation qui n’a pas résisté elle non plus. La tapisserie est devenue le visage, son usure exactement celle du corps, la vérité sortant de sa bouche entrouverte. De ces vérités que l’on cherche longtemps et qui viennent de ceux qui retournent des morts. Je la relie à deux choses : la fontaine qu’à Rome on appelle la Bocca della verità. Mettez une pièce dans sa bouche béante et elle sera l’oracle. Et puis ce témoignage d’un survivant des camps : « J’ai toujours pensé, même s’il y a un survivant, ce sera moi. C’est idiot ! Je n’ai jamais pensé que je pouvais mourir, jamais. J’imaginais pas, mourir j’imaginais pas. Moi, mourir ? Parce que j’étais heureux comme tout. Pas au camp, bien sûr, mais avant la guerre. J’étais tapissier, j’étais heureux. »
Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois, Argol, 2008, p. 39-43.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tiphaine samoyault, la main négative, tapisserie, louise bourgeois | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2011
François Bon, Dehors est la ville [à propos de Edward Hopper]

La ville est une fiction.
Cette ville n’existe pas. Ce qui se peint c’est notre idée de la ville, ce que nous mettons en jeu entre nous et le dehors lorsque nous disons le mot ville.
Parce que c’est là qu’on marche, et qu’entre soi et les autres s’est déposé le ciment et hissée la géométrie, et ce qui rend les visages indistincts et pareilles les fenêtres. La ville est ce qui nous sépare des autres hommes, c’est pour cela qu’elle lève de l’eau, séparée de nous par l’eau puissante et trouble, métaphore de ce balancement jaune entre soi-même et les autres, par quoi on se regarde soi-même aussi, là où on est : on est dans cette ville, là-bas sous le ciel jaune, la ville trouée de grandes saignées faites droit entre les blocs pour que les hommes traversent et se montrent.
Et le ciel est une folie dressée, comme un cri dirait cette volonté d’arracher la peau du monde et de s’enfuir mais la ville vous colle à son sol, vous coince dans ses alvéoles.
L'usine tout devant, rien qu’un cube massif, avec des cheminées : la ville en imposant ses volumes reste opaque, et cela vaut pour tout le paysage humain derrière, là où tout, eau, ciel et ville sont étendus à l’horizontale sauf cette usine, sans lampe ni veilleur. L’usine et son mystère témoignant seuls de par quoi la ville commande à ceux qui la font.
Rien ici qui soit pour l’homme, astreint à ces brouillons de fenêtre entre l’eau jaune et le ciel fou.
François Bon, Dehors est la ville, Flohic éditions, 1998, p. 8-9.
Edward Hopper, Pont de Manhattan
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois bon, edward hopper, ville, usine | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2011
Paul Klee, Théorie de l'art moderne
 L’art n’est pas une science que fait avancer pas à pas l’effort impersonnel des chercheurs. Au contraire, l’art relève du monde impersonnel de la différence : chaque personnalité, une fois ses moyens d’expression en mains, a voix au chapitre, et seuls doivent s’effacer les faibles cherchant leur bien dans des accomplissements révolus au lieu de le tirer d’eux-mêmes.
L’art n’est pas une science que fait avancer pas à pas l’effort impersonnel des chercheurs. Au contraire, l’art relève du monde impersonnel de la différence : chaque personnalité, une fois ses moyens d’expression en mains, a voix au chapitre, et seuls doivent s’effacer les faibles cherchant leur bien dans des accomplissements révolus au lieu de le tirer d’eux-mêmes.
La modernité est un allègement de l’individualité. Sur ce terrain nouveau, même les répétitions peuvent exprimer une sorte nouvelle d’originalité, devenir des formes inédites du moi, et il n’y a pas lieu de parler de faiblesse lorsqu’un certain nombre d’individus se rassemblent en un même lieu : chacun attend l’épanouissement de son moi profond.
Paul Klee, Théorie de l’art moderne, édition et traduction de Paul-Henri Gonthier, Genève, éditions Gonthier, 1964, p. 14.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, art moderne, art et science, individualité | ![]() Facebook |
Facebook |
15/05/2011
Marcel Duchamp, dans Georges Charbonnier, Entretiens avec Marcel Duchamp
Marcel Duchamp, à tort ou à raison, lorsqu’on pense à vous, lorsqu’on parle de vous, on est amené à penser que le mot art a eu pour vous des significations différentes ou, tout au moins, que vous n’avez pas toujours attaché à ce mot et au concept qui vient avec lui, la même valeur, la même force. Est-ce exact ?
 Dans une grande mesure, c’est exact car j’ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art qui était surtout fait d’une tradition, d’un siècle à l’autre ou d’un demi-siècle à l’autre demi-siècle. C’est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l’art comme je le comprends, l’art comme une chose beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque.
Dans une grande mesure, c’est exact car j’ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art qui était surtout fait d’une tradition, d’un siècle à l’autre ou d’un demi-siècle à l’autre demi-siècle. C’est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l’art comme je le comprends, l’art comme une chose beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque.
Le mélange de goût, dans la définition du mot art, est pour moi une erreur : l’art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d’une époque, et l’art d’une époque n’est pas le gôut de cette époque. C’est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu’on puisse faire quelque chose autrement que par goût : on vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau.
Le mot art, d’ailleurs, étymologiquement, veut dire faire, tout simplement. "Faire avec", si vous voulez, et presque "faire avec les mains". Donc, l’art, c’est tout ce qui est fait avec la main, et généralement par un individu. Ce qui rend la chose bien différente de ce que l’on appelle le goût et l’acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n’est-ce pas… Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir, et l’art n’est pas une source de plaisir. C’est une source qui n’a pas de couleur, qui n’a pas de goût. C’est ce qui se passe de 1850 à 1900, sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque.
[…]
Marcel Duchamp, nous savons tous ou nous pensons tous savoir ce qu’est une œuvre d’art. À quel moment existe-t-elle et qui la fait ?
Exactement, je n’en sais rien moi-même. Mais je crois que l’artiste qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu’il fait. Je veux dire par là : il sait ce qu’il fait physiquement, et même sa matière grise pense normalement, mais il n’est pas capable d’estimer le résultat esthétique. Ce résultat esthétique est un phénomène à deux pôles : le premier c’est l’artiste qui produit, le second c’est le spectateur, et par spectateur, je n’entends pas seulement le contemporain, mais j’entends toute la postérité et tous les regardeurs d’œuvres d’art qui, par leur vote, décident qu’une chose doit rester ou survivre parce qu’elle a une profondeur que l’artiste à produite, sans le savoir. Et j’insiste là-dessus parce que les artistes n’aiment pas qu’on leur dise ça. L’artiste aime bien croire qu’il est complètement conscient de ce qu’il fait, de pourquoi il le fait, de comment il le fait, et de la valeur intrinsèque de son œuvre. À ça, je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l’artiste.
Mais on m’assure que l’art est un langage. Qui dit langage dit à la fois communication et volonté de communiquer. Je veux bien admettre que le peintre a quelque chose à dire, mais est-ce qu’il souhaite dire quelque chose à quelqu’un ? Est-ce que tous les éléments du dialogue sont réunis : deux interlocuteurs et la volonté d’échange ? Est-ce que ces éléments se trouvent réunis dans le phénomène "peinture" ou dans le phénomène "art" en général ?
 Justement. C’est ce que je veux dire. Supposez que le plus grand artiste du monde soit dans un désert ou sur une terre sans habitants : il n’y aurait pas d’art, parce qu’il n’y aurait personne pour le regarder. Une œuvre d’art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc, le regardeur, le spectateur est aussi important que l’artiste dans le phénomène art.
Justement. C’est ce que je veux dire. Supposez que le plus grand artiste du monde soit dans un désert ou sur une terre sans habitants : il n’y aurait pas d’art, parce qu’il n’y aurait personne pour le regarder. Une œuvre d’art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc, le regardeur, le spectateur est aussi important que l’artiste dans le phénomène art.
[…]
Comment peut-on comprendre que la notion de prix soit attachée à la notion d’œuvre d’art ?
Impossible à comprendre ! Et complètement ridicule, justement, d’attacher une étiquette. C’est antinomique en soi. L’œuvre d’art n’a pas de valeur numérique ou même d’ordre moral. Aucune. C’est une chose qui s’impose par sa présence, uniquement, et cette présence est telle qu’elle passe de siècle en siècle, est conservée comme une chose unique qui, donc, n’a pas de prix.
Le prix moral, le fait qu’une chose qui a été faite en 1530 soit encore visible aujourd’hui, est extrêmement curieux. Mais, enfin, il y aussi des circonstances qu’on pourrait presque analyser : la chance qu’une chose a de survivre. Ce que nous voyons, fait en 1530, n’est pas forcément ce qu’il y avait de mieux en 1530, mais cette chose a survécu. Comment a-t-elle survécu ? On pourrait l’analyser. Mais en 1530, il y avait probablement d’autres choses qui étaient faites, d’autres artistes qui n’ont pas survécu. Nous les avons perdus.
De là une conclusion un peu facile, mais très logique : c’est ce qu’on appelle le Louvre, le Prado, la National Gallery, ce sont des réceptacles de médiocrité.
Georges Charbonnier, Entretiens avec Marcel Duchamp [réalisés en 1960], Marseille, éditions André Dimanche, 1994, p. 11-12, 81-82, 88-89.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel duchamp, georges charbonnier, art, goût | ![]() Facebook |
Facebook |





