20/02/2021
Silvia Majerska, Matin sur le soleil
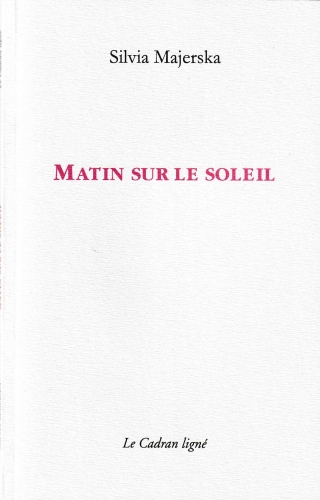
Les poèmes du livre, presque toujours en strophes brèves, se répartissent en trois parties, "Le cube de Pandore", "Matin sur le soleil" et "Portraits de l’eau". Le titre, repris pour le second ensemble, est une énigme jusqu’à la lecture, dans la seconde séquence, du dernier vers de "Yeux", « La valeur de certains désirs, c’est d’être aussi irréalisables que le matin sur le soleil ». On comprend immédiatement la force de cette « comparaison inattendue », qui pose la question de "l’impossible", le désir consistant peut-être d’abord à valoriser ce qui est désirable. Mais d’autres propositions dérangent aussi l’ordre, pas seulement celui de la langue.
Il faut d’abord revenir à la mythologie grecque : Pandore est créée par le dieu forgeron, Héphaïstos, d’un peu de terre et d’eau. Le poème d’ouverture, "Premier contact", esquisse justement un rapport amoureux avec la terre, « Au toucher de mes cuisses / et de la surface de la terre // la sueur coule lentement / vers le sol en fins ruisseaux » : le corps en eau épouse la terre et, plus avant, le ciel devient corps qui « s’allonge » sur ce corps. Cette étreinte fusionnelle de l’humain et de la nature est le motif dominant de cette partie ; ici la femme et la terre, deux principes de fécondité, sont en étroite liaison, ensuite se rencontrent les relations terre (= corps) / ciel et eau, montagne / humain (embrasser la montagne), vent / femme (sous la forme de « sous-vêtements féminins »).
Si le livre s’ouvre sur une relation intime à la terre et à l’eau, il se ferme avec quatre poèmes autour de l’eau vivante : il s’agit de « portraits ». D’emblée l’eau est bien rapportée au vivant et à la beauté — « sa chair » est dite « photogénique » —, et à la lumière, l’eau « jetant une lumière sèche ». Elle est reliée à la mythologie grecque puisque "eau" appelle l’Hydre (= eau) aux multiples têtes — on y voyait parfois un serpent d’eau ; énigme, l’eau se transforme sans que l’on puisse imaginer ses changements, tout comme la chrysalide ou comme « un visage humain recyclé depuis la nuit des temps ». C’est une des caractéristiques essentielles de l’eau, elle « chante le temps » et le lecteur revient à des origines mythologiques, à la création de Pandore. Dans la dernière séquence du livre, les éléments énumérés pourraient, eux aussi, paraître énigmatiques : ils rassemblent ce qu’est le corps vivant dans le temps, « L’eau — l’aïeule, l’emballage, le culte de la pureté, la loi, l’insoluble » ; dès le second poème, il était dit qu’elle était nourricière et « la langue maternelle », soit liquide amniotique.
Par le lien entre le vivant et la nature s’introduit la figure du double qui s’exprime de diverses manières. Ainsi le squelette est le « frère intérieur », l’ombre est un « rêve que fait le soleil » et la mémoire s’apparente à une ombre ; ainsi encore peut-on imaginer qu’avec deux bouches, comme on a deux yeux, on pourrait donner un corps (« trois dimensions ») à la langue. La langue, les mots constituent d’ailleurs une ligne de force du livre ; les mots sont inscrits dans le temps, « souvenir / des hommes oubliés / depuis longtemps » et impossibles à compter, proliférant depuis qu’ils sont écrits. Ils sont motifs à des propositions bâties sur l’absurde, par exemple dans le poème titré "Mors inexistants" dont le début évoque un raisonnement carrollien :
Parmi les mots inexistants
il a fallu distinguer ceux
qui n’existeront jamais
Bien d’autres énoncés ne présentent pas de relation à la réalité, sans pour autant ne pas être "lisibles" ; dans les deux dernières séquences d’un poème titré "Bleu", est nommé un personnage de la mythologie grecque, qui a donc sa place dans l’ensemble, mais si un lien avec le titre est immédiat, la relation avec les autres séquences du poème est difficile à établir : « Sous la pluie quelqu’un applique le bleu. Le blanc tète le pigment au goût de feuille, de pétale, de fruit ; les nuances peuplent l’espace de la tâche. // Pendant ce temps-là, vêtu d’un simple jean bleu, Orphée descend très haut, jusqu’au vouvoiement. » Faudrait-il tenter de « résoudre l’énigme » ? Il faut bien plutôt l’accepter comme telle, comme toutes les « étranges comparaisons », sauf à vouloir que la poésie soit seulement analogue à un document.
Matin sur le soleil, est le premier livre de Silvia Majerska (née en 1984). Traductrice du slovaque, elle a publié jusqu’à maintenant des poèmes dans des revues en France et en Slovaquie et elle a une activité critique. On souhaite que se poursuive son goût de l’insolite dans l’usage de la langue.
Silvia Majerska, Matin sur le soleil, Le Cadran ligné, 2020, 49 p., 12 €. Cette recension à été publiée par Sitaudis le 28 janvier 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : silvia majerska, matin sur le soleil, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2021
Ezra Pound, Cathay : recension
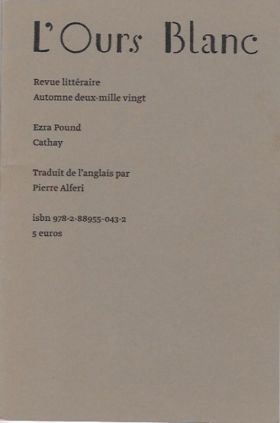
Il est bon de rappeler que "L’Ours Blanc", revue sans parution régulière (qui doit son nom à un vers de Valère Novarina), propose dans chaque livraison un seul texte, traduction (Charles Reznikoff, Jack Spicer, Russell Edson, etc.) ou non (Fabienne Raphoz, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes, etc.). Le numéro 27 a paru en même temps que la traduction de Pound, Ombres blanches sur fond presque blanc, de Baptiste Gaillard, écrivain de Suisse romande. Cathay rassemblait, en 1915, les traductions par Pound de poèmes du poète chinois Rihaku (transcription du nom en japonais) ou Li Bai (701-762), de l’époque Tang. Pound pensait qu’il fallait ne pas rester coincé dans sa langue et lire d’autres langues, traduire aussi, plaçant l’activité du traducteur au même niveau que l’écriture de poèmes — ce qui est aussi la position d’Alferi. Il reçut en 1913 de sa veuve les carnets d’Ernest Fenollosa qui avait transcrit et traduit littéralement des poètes de la poésie classique chinoise ; sans rien connaître de la langue, Pound travailla à partir de ces notes pour donner une version anglaise, faisant de Rihaku/Li Bai « un précurseur de Make it New, ce modernisme qui prend le contre-pied de l’avant-garde et parie sur le renouvellement de la tradition » (A. Lang). L’édition de L’Ours Blanc reproduit dans sa page titre la disposition de la première édition de Cathay que le lecteur retrouvera aisément par l’internet de Cathay, fort utile si l’on est angliciste pour apprécier les choix d’Alferi*.
Les poèmes de Rihaku sont ancrés dans son temps : on y lit des noms de lieux et de personnages (So-Kin), des allusions (« l’Empereur est à Ko »), des comportements (« À quatorze ans j’ai épousé mon Seigneur »...) ») qui reportent à une époque et à des faits bien étrangers au lecteur d’aujourd’hui. Ce n’est pas l’essentiel, toute poésie ou prose ancienne sur ces points reste peu lisible — sinon comment regarder une pièce d’Euripide ou de Shakespeare ? —, ce qui importe est que « cette distance nous donne avec une immédiateté d’autant plus fulgurante les sentiments les plus communs à l’humanité : la faim et le froid, l’espoir et le désespoir, le désir et l’attente » (A. Lang). Ce sont notamment les difficultés de la vie pendant les troubles et guerres de son époque que Rihaku restitue, « Un déferlement d’hommes de guerre sur tout le royaume du milieu, / ( ...) Et la peine, la peine comme la pluie, / La peine à partir, et la peine, la peine à revenir, / Les champs désolés, désolés / ». Et la restitution n’est jamais simple récit dans la traduction d’Alferi traduisant Pound.
La syntaxe du français oblige à plus de liens qu’en anglais, ce qui peut gêner la simplicité recherchée dans l’expression et surtout briser le rythme des vers ; Alferi, dans le premier poème traduit de Kutsugen (IVe s avant J._C.), choisissant une construction elliptique, supprime pronom et verbe présents dans le texte de Pound :
« Sorrowful minds, sorrow is strong, we are hungry and thirsty, /»
est traduit par
« Âmes attristées, la tristesse est âpre, et la faim, la soif, / »
Dans "Lettre d’un exilé" de Rihaku, la forme du récit fait par l’exilé à un ami est remarquable : dans la traduction de Pound comme dans celle d’Alferi, absence de tout apprêt, vocabulaire et syntaxe sans détours qui font penser aux choix des poèmes objectivistes des années 1930 aux États-Unis : « (...) Le plaisir continu, avec des courtisanes allant et venant sans obstacle. / Avec les flocons qui tombaient des saules comme de la neige, / Et les filles fardées soûles au crépuscule, / ». L’exilé n’obtenant pas de promotion à la cour, doit repartir dans la montagne, c’est-à-dire loin des chansons, loin des échanges, et le lecteur notera le vif de sa réponse à l’ami qui demande comment vivre l’exil : après l’image qui associe à la nature le sentiment de regret éprouvé (« Comme la chute des fleurs à la fin du Printemps / Confuse, tourbillonnante »), deux vers fortement coupés (6/6, 6/5) expriment dans la traduction d’Alferi l’inutilité de toute plainte :
À quoi sert de parler, parler n’a pas de fin,
Il n’y a pas de fin aux choses du cœur.
Ailleurs, dans une énumération, Pound coordonne dans chacun des cinq vers deux groupes, « To high halls and curious food, / To the perfume air and girls dancing [etc.] » ; Alferi construit un autre rythme en supprimant le lien, « Vers les salons vastes, les mets curieux, / vers l’air embaumé, les filles qui dansent » ; dans le vers conclusif de la séquence, c’est le verbe qui est abandonné : « Night and day are given to pleasure » est traduit par « Jour et nuit dédiés au plaisir ».
Alferi suit fidèlement la traduction de Pound, mais construit par de légers décalages un rythme propre au français. Il s’agit bien d’un travail de re-création, pour qui a déjà traduit John Donne à côté de contemporains comme Cole Swensen, J. H. Prynne ou Zukofsky.
Ezra Pound, Cathay, traduction Pierre Alferi, "L’Ours Blanc", n°28, Héros-Limite, automne 2020, 28 p., 5 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 12 janvier 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, cathay, traduction pierre alferi, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2021
Étienne Faure, Et puis prendre l'air : recension

"Prendre l’air", c’est sortir de chez soi, de ses habitudes, comme l’écrivait Flaubert dans sa correspondance, « Je comptais cet été sur un peu d'argent pour prendre l'air ». C’est ce que les dix ensembles du livre explorent, avec en ouverture le sous-titre Sortir et en clôture Prendre l’air ; entre ces deux bornes, l’idée de mouvement peut être explicite ("Changement de saison", "Dix postures pour cueillir les mûres", "Aux coins du globe") ou sembler être contredite dans l’énoncé ("Voyage à la cave") : dans ce cas, le texte de Khlebnikov cité en exergue, « O cave de la mémoire », oriente vers une autre forme de sortie ; plusieurs sous-titres valorisent plutôt l’immobilité, comme "Claustrales", mais le premier poème de cet ensemble s’achève par « Abstraites errances », noté en italique. Et puis prendre l’air, outre son unité thématique, s’inscrit dans une tradition, celle du poème en prose depuis Baudelaire, privilégiant surtout la description des choses de la vie et, souvent, la méditation à leur propos.
Le narrateur marche beaucoup, observe sans cesse les personnes autour de lui, les oiseaux dans les jardins parisiens et à la campagne, les changements du ciel. Il écoute des étrangers qui tentent de se comprendre, il songe à la campagne en voyant des jeunes femmes qui, assises en amazone sur un banc, évoquent des cavalières et, toujours dans un square, il prend le temps de regarder des acteurs improvisés. Ce qui est recueilli, ce sont tous ces gestes, ces bruits, ces mots qui forment l’essentiel des jours, c’est-à-dire tout ce qui s’oublie, comme a été oublié le trot des charrettes qui naguère livraient le lait dans les grandes villes. Il y a quelque chose proche du spleen baudelairien dans la tentative de rassembler ce qui s’échappera toujours, ce que figure ce qui est vu lors d’un voyage en train, « on aperçoit les arbres qui fuient, les buissons, les lapins, tout un monde qui détale ». On peut croire voler des moments en passant dans la rue et parfois penser faire sienne la ville, on comprend cependant « qu’on ne s’approprie rien, que tout n’est qu’emprunt, mimétisme, camouflage ». Peut-on commencer, parce qu’on se trouve à son aise dans une ville, à « s’en faire une patrie » ? Étienne Faure cite ici Mme de Staël et a sans doute en tête la suite du texte de Corinne ou de l’Italie : « voir des visages humains sans relation avec votre passé ni avec votre avenir, c’est de la solitude et de l’isolement sans repos et sans dignité ».
La marche reste indispensable pour « ne plus voir contraires réel et imaginaire, passé et futur, haut et bas », et sur ce point le lecteur est renvoyé à André Breton, mais il est nécessaire de s’arrêter pour (se) construire. Sur le banc naît le questionnement, « où suis-je, où en suis-je, qui suis-je, quel jour est-on ? », et le banc lui-même suscite le départ dans l’imaginaire : il se souvient qu’il a été arbre, il vit son usure, l’inscription des amours. Bien des éléments du quotidien renvoient à autre chose qu’eux-mêmes, notamment au passé ; ce journal qui emballait un objet engage un voyage dans le temps de sa publication, les vêtements d’automne ressortis on y découvre les traces de la saison passée (châtaigne, gland, faîne) et « Telle une lecture interrompue (...) on reprend la tournure d’esprit de la saison où on l’avait laissée : mélancolique ». Des photographies retrouvées de parents ramènent à l’entre-deux guerres ; l’Histoire, celle des conflits du XXe siècle, s’impose aalors comme dans les précédents livres, et les enfants passent du statut de « titis du peuple à enfants de la patrie, prêts à leur tour pour la prochaine guerre ». Analogues aux animaux faisandés accrochés autrefois aux crocs des boucheries, les souvenirs connaissent « un temps de faisandage » et, en même temps, ce qui a été vécu par les uns se reproduit autrement ; dans un hôtel en 1919, mort de Jacques Vaché, retrouvailles de Gide et Maria Van Rysselberghe, écriture d’un livre par Breton et Soupault, « cent ans après, 2019, les séjours à l’hôtel étaient toujours au rendez-vous : écrire, aimer, mourir ».
Les sentiments du narrateur ne sont donc pas absents du texte, cependant est marqué l’effort dans l’écriture pour éviter toute confidence, « on reprise dix fois le texte, le rature, laissant passer trop de clarté de soi ». C’est plutôt la pratique de l’écriture qui est décrite à différents moments du texte, comme l’usage d’un carnet employé tête-bêche où sont notés prose et vers ou le parallélisme entre l’ortie et l’écrit, entre l’écureuil et l’écrivain : l’animal « amasse des idées, les oublie, n’en finit pas d’aller de branche en branche ainsi qu’un écrivain — nouveaux chapitres, paragraphes, à la ligne ne sachant s’arrêter ». Chaque ensemble est précédé d’un exergue, et des écrivains du passé sont cités dans les poèmes (outre les noms relevés ci-dessus, La Fontaine, Desnos, Crevel, Conrad, Wilde, Jean-Jacques [Rousseau], Jules Renard, Laforgue), mais aussi leurs textes, notamment Baudelaire, Rimbaud, Aragon, textes rarement attribués mais aisément reconnaissables même quand ils sont intégrés dans celui d’Étienne Faure : mots repris à Apollinaire, à Baudelaire (« Ni luxe ni calme ni volupté ») ou fragment de Rimbaud augmenté d’une parenthèse (« Jeunesse (hardie aventure) à tout asservie »). Relevons encore une allusion transparente à la Commune de Paris avec l’idée d’un roman titré Le temps des merises, la mention du mur des Fédérés (où est la tombe de Jean-Baptiste Clément, auteur du "Temps des cerises") et de paroles de la chanson. Le titre du précédent livre d’Étienne Faure, Tête en bas, est aussi présent mais au pluriel, présence qui suggère de repérer d’éventuels liens formels entre poèmes en prose et poèmes en vers.
On retrouve en effet le plaisir des échos, avec par exemple « oiseaux oisifs », « champ de courses, chevauchées, courses aux Champs », « requin /requiem », jusqu’au jeu anagrammatique : « Offusqué » ouvre un poème que ferme « Suffoqué », figure de la construction du livre. On lira parfois à la fin d’une prose un ou deux mots séparés qui font une sorte de titre, « Perdre sa place », « Raccords », etc., pratique constante dans la poésie en vers, et l’on reconnaîtra aussi le goût pour un vocabulaire donné comme "familier" ou "populaire" (« ça caille », « à la revoyure », « piaule », « pas un carat », etc.). Mais la construction de chaque prose est bien différente de celle des poèmes en vers souvent construits en une seule longue phrase ; ici, la syntaxe est variée, de la phrase réduite à un mot jusqu’à la longue énumération : on pense à celle du mobilier d’un déménagement réuni sur le trottoir.
Prose ou vers, le même regard attentif vers le monde, des retours analogues vers le passé, le même amour de la littérature : pour qui ne connaîtrait pas encore la poésie d’Étienne Faure, Et puis prendre l’air est une belle entrée.
Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, 136 p., 14,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 décembre 2020
Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2020
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance 1920-1959 : recension
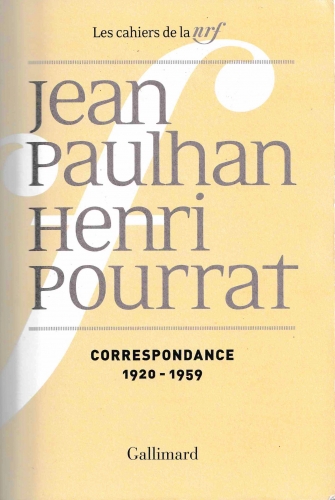
La correspondance commence avec une lettre de Paulhan du 19 avril 1920, demandant à Pourrat une note, pour La NRF, à propos d’un livre de Francis Jammes ; la note est écrite et les deux écrivains s’envoient leurs livres. Paulhan regrette l’éloignement de Pourrat, qui vit à Ambert, et sollicite rapidement une collaboration régulière. Après quelques échanges d’éléments plus personnels — mais les lettres de Pourrat sont absentes jusqu’au 26 septembre —, Paulhan termine sa longue lettre du 15 juin 1920 par « Je suis votre ami » et débute la suivante par « Mon ami », à quoi répond un « Cher ami » suivi, comme ce sera souvent le cas, de nouvelles développées.
Tout semblait séparer les deux hommes, outre l’éloignement géographique : Paulhan (1884-1968) avait un métier, en même temps qu’il assurait le secrétariat de La NRF avant d’en prendre la direction, en 1925, à la mort de Jacques Rivière ; cette fonction lui faisait rencontrer le milieu littéraire, de Gide et Valéry aux surréalistes : il écrivit dans Littérature, la revue d’André Breton. Henri Pourrat (1887-1959), souffrant de la tuberculose, avait dû abandonner sa formation d’agronome et vivre à Ambert ; il publia très tôt des poèmes, collaborait à des journaux régionaux en Auvergne et trouva sa voie avec la publication de Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes en 1921. Les différences ont été mises entre parenthèses et les deux hommes se sont vite découvert des motifs d’échanger.
Pourrat exprime souvent un lien très fort, vivant, à la nature qui l’environne, soucieux d’aménager un potager, de planter des arbres fruitiers, et il écrit à propos des changements dans la montagne au fil des saisons, de la dureté des hivers, des plaisirs simples de la campagne (« Je cueille des champignons rosés dans de jolis prés »). Toute son œuvre est écrite principalement « sur les gens d’Auvergne, leurs coutumes, leurs mœurs », c’est-à-dire à propos du monde paysan dont, en observateur avisé, il observe la mort possible et, écrit-il dès 1928, « Ce pourrait être intéressant (...) ces transformations qu’on a sous les yeux, et [de] se séparer de tout un régionalisme. » Ses descriptions du quotidien, comme ses livres, ont toujours été très favorablement accueillis par Paulhan qui était également un observateur de la nature. Il raconte qu’à Paris une marchande de journaux gardait dans son kiosque une salamandre qu’elle nourrissait de salade, ou que Paul Éluard lui « a apporté un caméléon de Tunisie » ; lui-même élevait des lézards verts, des poissons rouges. Il note qu’au moment de la migration des hirondelles, les plus anciennes s’occupent des plus jeunes et, qu’au mois de juin, son jardin est « pris d’une sorte de folie bien plus animale que végétale, et lance de tous côtés des fleurs et des tiges que l’on reconnaît à peine ». Il serait aisé de multiplier les traces du souci de la nature dans leur correspondance ; en octobre 1937 encore, Pourrat ajoute à la fin d’une lettre, « Hier nous avons vu une si belle monstrueuse salamandre. J’ai pensé à la capturer pour toi. »
Les échanges portent aussi régulièrement sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourrat et Paulhan se font part de leurs problèmes de santé, de ceux de leurs proches : pour le premier, il souffrira beaucoup de la mort de sa fille aînée, âgée de dix ans, en mai 1940, pour le second, il voit l’évolution de la maladie de Germaine, son épouse, qui perd toute sa mobilité. Les rationnements au cours de la guerre ont donné à Pourrat l’occasion d’apporter à Paulhan, alors installé à Paris, une aide efficace en lui expédiant des sacs de charbon de bois pour le chauffage et des vivres, pommes de terre, topinambours et miel. On lit des deux côtés une attention constante à l’autre et les témoignages réciproques d’amitié sont aussi nombreux en ce qui concerne leur travail, chacun tenant l’autre au fait de ce qu’il écrit.
Dès le début de leur relation, en 1920, Pourrat remercie Paulhan d’avoir publié dans La NRF quelques poèmes qui contribuent à le faire connaître ; il ne cessera les décennies suivantes de lui savoir gré de ses lectures attentives et critiques. On peut voir par les remarques de Paulhan ce que pouvait être alors un éditeur ; à propos d’un roman de Pourrat, Le Mauvais garçon, il détaille tout le bien qu’il en pense (délicatesse, justesse, poésie) et, ensuite, précise ce qui lui paraît à reprendre — « Il faut que je te tracasse sur deux ou trois points » —, à alléger ou supprimer dans la première partie, etc. Cet éditeur savait découvrir dans Pourrat autre chose qu’un écrivain "régional", lisant dans un récit un « sentiment d’horreur ou d’effroi (...) qui donne à ton œuvre une raison tragique ». Il ne se posait pas pour autant en supérieur, insistant sur le rôle positif de Pourrat pour lui, «Tu es mon homme libre ; il y a beaucoup de choses que je choisis ou que je juge à partir de toi, ou de ce que je serais si j’étais toi », projetant d’écrire deux romans ensemble lors d’une rencontre, lui demandant son avis quand il publiait un livre ou l’écrivait (« Ça ne t’ennuie pas que je te parle un peu des Fleurs de Tarbes ? »). Pourrat, de son côté, a toujours sollicité et apprécié les remarques et conseils de son ami : « Je pense à toi comme à celui qui m’a donné le sens de la qualité et comme au meilleur des témoins, des juges, des parrains », lui écrit-il, et il a régulièrement commenté les livres de Paulhan dans ses lettres et dans des articles*, très intéressé notamment par l’art du récit.
Pourrat publiait beaucoup (c’était son gagne-pain), en partie aux éditions Gallimard, et il a souvent sollicité l’aide de Paulhan pour régler des problèmes de tirage, de promotion de ses livres, et il était parfois furieux par la désinvolture — le mépris ? — manifesté par certains membres des éditions, comme Brice Parain ; ses lettres reviennent régulièrement sur ces difficultés, accrues par son éloignement de Paris. Paulhan intervient chaque fois qu’il le peut et, par ailleurs, lui donne des nouvelles de la vie de l’édition (en 1931, « Tout va vraiment très mal pour les livres »), des revues. Tous deux échangent à propos des écrivains qu’ils apprécient, Francis Jammes, Cingria, Bove, Ramuz, Joë Bousquet, etc., de Vialatte, que Pourrat a présenté à Paulhan.
Pendant la période de la guerre les confidences se font plus rares. Paulhan s’est engagé très vite dans la résistance, fondant notamment dès 1941 avec Jacques Decour Les Lettres françaises, alors que La NRF était passée sous la direction de Drieu La Rochelle en novembre 1940. Il batailla après la guerre contre les excès de l’épuration, sachant que sa revue, « souillée » sous l’occupation, ne pouvait reparaître — ce sera La Nouvelle Nouvelle Revue française en 1953. Pourrat, de son côté, a d’abord vu dans Pétain celui qui résistait au nazisme ; il recueillit des Juifs dans les années sombres et, plus tard, reconnut qu’il avait été en partie aveugle, « je pense à tout ce que j’aurais dû comprendre mieux auprès de toi ». La maladie gâcha ses dernières années et il voyait la disparition accélérée du monde qu’il avait décrit, « l’homme vient travailler à Ambert pour bénéficier des lois sociales », écrivait-il en 1957.
Ce fort volume est une traversée de quarante ans d’histoire littéraire ; on y découvre l’acharnement de Paulhan pour que sa revue se développe et devienne une référence dans le monde des lettres, l’énorme travail de Pourrat pour restituer la vie et les mœurs d’une région rurale. On y suit également les développements d’une belle amitié.
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance, 1920-1959, édition Claude Dalet et Michel Lioure, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2020, 816 p., 45 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 novembre 2020.
* On lira la liste de ses recensions en appendice et celle des Fleurs de Tarbes reprise intégralement.
Publié dans Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, henri pourrat, correspondance, 1920-1959, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2020
Fabrice Caravaca, lalali : recension

Les ouragans se multiplient tout comme les raz-de-marée dévastateurs, les inondations détruisent récoltes et villes, le réchauffement climatique s’accroît et la banquise, le pergélisol fondent, les glaciers se réduisent..., en même temps les conflits armés se développent, les antagonismes entre les "grandes" puissances ne s’apaisent pas. De là à envisager la possibilité d’une apocalypse, une destruction de l’humanité, le pas est franchi par les survivalistes et autres effondristes. Ce scénario a été très souvent utilisé depuis, par exemple, La peste écarlate (1912) de Jack London ; Fabrice Caravaca part de cette perspective d’une quasi disparition de la vie terrestre pour, en de courtes séquences, imaginer des humains qui n’auraient plus aucune notion de la civilisation dont ils sont pourtant issus, comme si une catastrophe avait entraîné son oubli.
Certains ont emporté (mais d’où venaient-ils ?) des outils du "monde d’avant" sans plus en connaître l’usage. Des hommes attendent dans le silence et des femmes nues, ensemble, s’habillent ; les premiers semblent avoir perdu tout souvenir d’un passé devenu trop lointain, le visage des secondes ne manifeste rien de ce qu’elles ressentent. Hommes et femmes « forment une tribu » qui survit grâce à des « lois précises », mais ils vivent séparés les uns des autres. Ces humains d’un autre temps, comme beaucoup d’animaux, dorment peu ; ils ont oublié ce qu’est « la parole partagée », vivent « sans passion » dans un nulle part partagé en deux saisons — humide et chaude, humide et froide —, sans rien attendre, et pour eux le temps se réduit à l’instant.
Ils occupent des villages partiellement détruits et ils attendent la nuit pour se retrouver, « Ce sera le début de la chasse » — on reconnaît dans le titre hallali ; à l’origine le mot, dans le vocabulaire de la chasse, est apparu sous la forme ha la ly. Les petits animaux ne suffisent pas pour nourrir le groupe mais les grands, dangereux, prennent les humains pour proie et s’approchent parfois de leurs habitations. Cependant, il arrive que de gros oiseaux de la plage s’égarent, plus faciles à tuer.
Ces humains enterrent leurs morts et, les nuits de pleine lune, s’enduisent le corps de graisse pour danser nus ; pendant la saison chaude, ils s’exposent au soleil quand la pluie cesse un peu. Quand ils quittent leurs abris, ils ne peuvent se déplacer que vers la forêt ou la plaine, l’une et l’autre sans fin, ignorant si d’autres groupes sont installés ailleurs et ne s’en préoccupant guère. L’activité est réduite pour l’essentiel à la recherche de nourriture et, contre le froid et l’humidité, à la confection de vêtements de peau et à l’entretien du feu.
Le récit ne s’appuie pas sur des descriptions de la vie des préhistoriques, beaucoup plus complexes dans leurs activités, mais vise plutôt à suggérer ce que pourraient être les jours des humains privés d’échanges verbaux et donc de toute vie spirituelle. Dans cette fiction, il n’y a pas de parole — le récit s’achève avec l’image dans la forêt d’un homme qui « crie » — et « Hommes et femmes ignorent l’existence des rêves ». Il ne s’agissait pas pour Fabrice Caravaca de renouveler le genre de la science-fiction, simplement de rappeler que l’humanité ne vit pas sans i Les ouragans se multiplient tout comme les raz-de-marée dévastateurs, les inondations détruisent récoltes et villes, le réchauffement climatique s’accroît et la banquise, le pergélisol fondent, les glaciers se réduisent..., en même temps les conflits armés se développent, les antagonismes entre les "grandes" puissances ne s’apaisent pas. De là à envisager la possibilité d’une apocalypse, une destruction de l’humanité, le pas est franchi par les survivalistes et autres effondristes. Ce scénario a été très souvent utilisé depuis, par exemple, La peste écarlate (1912) de Jack London ; Fabrice Caravaca part de cette perspective d’une quasi disparition de la vie terrestre pour, en de courtes séquences, imaginer des humains qui n’auraient plus aucune notion de la civilisation dont ils sont pourtant issus, comme si une catastrophe avait entraîné son oubli.
Certains ont emporté (mais d’où venaient-ils ?) des outils du "monde d’avant" sans plus en connaître l’usage. Des hommes attendent dans le silence et des femmes nues, ensemble, s’habillent ; les premiers semblent avoir perdu tout souvenir d’un passé devenu trop lointain, le visage des secondes ne manifeste rien de ce qu’elles ressentent. Hommes et femmes « forment une tribu » qui survit grâce à des « lois précises », mais ils vivent séparés les uns des autres. Ces humains d’un autre temps, comme beaucoup d’animaux, dorment peu ; ils ont oublié ce qu’est « la parole partagée », vivent « sans passion » dans un nulle part partagé en deux saisons — humide et chaude, humide et froide —, sans rien attendre, et pour eux le temps se réduit à l’instant.
Ils occupent des villages partiellement détruits et ils attendent la nuit pour se retrouver, « Ce sera le début de la chasse » — on reconnaît dans le titre hallali ; à l’origine le mot, dans le vocabulaire de la chasse, est apparu sous la forme ha la ly. Les petits animaux ne suffisent pas pour nourrir le groupe mais les grands, dangereux, prennent les humains pour proie et s’approchent parfois de leurs habitations. Cependant, il arrive que de gros oiseaux de la plage s’égarent, plus faciles à tuer.
Ces humains enterrent leurs morts et, les nuits de pleine lune, s’enduisent le corps de graisse pour danser nus ; pendant la saison chaude, ils s’exposent au soleil quand la pluie cesse un peu. Quand ils quittent leurs abris, ils ne peuvent se déplacer que vers la forêt ou la plaine, l’une et l’autre sans fin, ignorant si d’autres groupes sont installés ailleurs et ne s’en préoccupant guère. L’activité est réduite pour l’essentiel à la recherche de nourriture et, contre le froid et l’humidité, à la confection de vêtements de peau et à l’entretien du feu.
Le récit ne s’appuie pas sur des descriptions de la vie des préhistoriques, beaucoup plus complexes dans leurs activités, mais vise plutôt à suggérer ce que pourraient être les jours des humains privés d’échanges verbaux et donc de toute vie spirituelle. Dans cette fiction, il n’y a pas de parole — le récit s’achève avec l’image dans la forêt d’un homme qui « crie » — et « Hommes et femmes ignorent l’existence des rêves ». Il ne s’agissait pas pour Fabrice Caravaca de renouveler le genre de la science-fiction, simplement de rappeler que l’humanité ne vit pas sans imaginaire.
Fabrice Caravaca, lalali, éditions marguerite waaknine, 2020, 44 p., 7 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 octobre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice caravaca, lalali, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2020
Jacques Demarcq, La Vie volatile
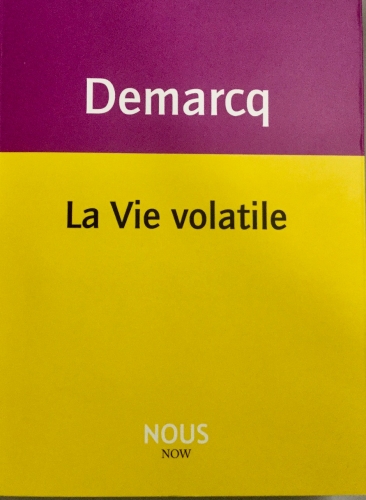
Jacques Demarcq écrit, notamment mais pas seulement, à propos des oiseaux, d’une manière différente de celle de Fabienne Raphoz ou Dominique Meens, pour citer des contemporains, ou Henri Pichette un peu plus avant ; on le retrouve dans une belle livraison de la revue PO&SIE parue en août 2019 (n° 167-168, "Des oiseaux"). Dans ses livres publiés depuis Les Zozios (NOUS, 2008), se mêlent caractère documentaire, autobiographie, poèmes et images, et c’est ainsi qu’est encore construit, très foisonnant, La Vie volatile, avec une place importante réservée aux calligrammes. La simple description des neuf parties de l’ensemble dépasserait les limites d’une note de lecture, on ne s’attachera qu’à ce qui apparaît comme des constantes de l’œuvre.
Le titre l’indique clairement, l’essentiel des textes est relatif aux oiseaux, mais si l’observation est des plus précise, complétée par des ouvrages savants, le propos n’est pas celui d’un naturaliste. Quand besoin est, il s’appuie sur un extrait d’Élisée Reclus ou un ouvrage concernant un peuple mélanésien et sa musique, il renvoie à Utamaro ou cite Chateaubriand, c’est par souci chaque fois d’exactitude : l’ouvrage s’achève d’ailleurs par une bibliographie qui énumère les sources utilisées. Le projet de Demarcq déborde largement ce qui est apparent pour le lecteur qui feuilletterait seulement une partie du livre, la restitution des cris des oiseaux : ce n’en est qu’un aspect et, à différents endroits, sont donnés des éléments pour mieux saisir l’unité du livre.
Regarder avec attention les oiseaux, étudier autant leurs mouvements et leurs cris n’est donc pas pour écrire en ornithologue, bien plutôt « Observer avec eux m’invite à regarder le genre humain avec une distance, un décentrement, une fragile excentricité ». On entend là quasiment un moraliste, sans aucune naïveté ou anthropomorphisme béat ; certes les animaux n’apprennent pas directement ce que sont les hommes mais leur fréquentation incite à voir les hommes autrement. Demarcq le dit autrement à propos d’un séjour au Sénégal, « Je traque les oiseaux pour leurs hommes autant que pour eux. Pour les paysages et sociétés qu’ils côtoient en touristes, immigrés provisoires. » Cette attention aux hommes est lisible dans les pages du Journal tenu au cours de plusieurs séjours à New York ; Demarcq y fréquente les musées mais aussi les parcs, prend le métro, cherche sans succès les traces d’un village ancien, marche beaucoup dans les rues, s’arrête devant les gratte-ciel bâtis pour les milliardaires, constate l’appauvrissement des librairies d’occasion concurrencées par internet, concluant ainsi le Journal : « New York est une loupe rapprochant ce qu’il peut y avoir de splendide et de pire dans un Bref New World. »
Un autre aspect du projet touche à l’écriture puisque, pour Demarcq, « Les rythmes et sons, degrés zéro et infini du poétique, priment sur le sens et désaxent la syntaxe ». Partant de là, proposer de noter le cri des oiseaux n’oblige en rien à tenter une restitution que seuls des enregistrements peuvent accomplir — enregistrements qu’il utilise à l’occasion. Il essaie donc d’inventer dans la langue ce qu’est pour lui le cri du bruant ou de la fauvette, « je pars de quelques syllabes maladroitement imitées d’oiseaux / ce qui raréfie, étoffe, étrangle le vocabulaire à ma disposition ». Mais les modulations du cri ? la typographie joue un rôle puisqu’il est possible de varier le corps des lettres, d’insérer une portée musicale, de donner un mouvement : les mots d’un vers ne sont pas sur la même ligne, une série de vers représente le vol d’un oiseau. On pensera que ces manipulations sont bien éloignées du cri de tel ou tel oiseau ; cela est probable mais répond cependant à ce que recherche Demarcq.
Il y a dans sa démarche un refus du sens à tout prix ; il ne s’agit pas du tout de faire comme si la langue n’existait pas mais « de la rendre naissante, enfantine et fragile, à l’instant où des mots, des articulations s’esquissent dans le bégaiement. » C’est sans doute pourquoi, attentif aux manières de prononcer qu’il rencontre, il transcrit la prononciation différente du français par une personne rencontrée en Amérique (« Les péhuches détuisent toute sôte [...]). C’est pourquoi aussi il introduit, dans les proses comme dans les poèmes, des images pour remplacer les mots, des dessins en forme de lettres — une tente pour le A, par exemple, une suite verticale de points pour le "l" de pluie —des jeux variés avec les couleurs et les formes : ainsi un texte inscrit dans une sorte d’affiche rectangulaire elle-même dans la page.
C’est pourquoi enfin Demarcq pratique le calligramme ; il définit très justement que cet « affrontement » de l’écriture et du dessin implique pour lui « le mélange de caractères disparates, la déformation de certains ou leur détournement figuratif, la dislocation ou torsion des lignes, l’introduction d’éléments non scripturaux tels que vignettes, pictogrammes ou traits rythmiques, et mieux que tout la vibration des lettres et des couleurs, proches des vibratos du chant. » Passionné de peinture, il reprend des toiles, des couleurs ou des formes de peintres, de Monet à Dubuffet, à partir desquelles il construit ses propres formes. Il rappelle d’ailleurs dans son Journal qu’il avait essayé, à partir des toiles de Pollock à New York, de « dessiner des phrases ». Le goût — et le plaisir — de l’expérimentation sont sensibles dans ses tableaux recomposés comme dans ses transcriptions de bruits, ceux de « la futaie [qui] grinsse cracke grezzille d’insectes », du pic qui « tapopote ». Comme dans le choix des paronomases (« python piteux ») et, surtout, des calembours : en plus du titre, on relèvera les titres et sous-titres, « Cygne d’étang », « Recife à ses cieux », « exquis disent plus ? », etc.
On comprend que les réponses à la question posée au tout début du livre, « Pourquoi les oiseaux ? » sont multiples, celles d’un écrivain soucieux de « se penche[r] pour voir ce qu’il y nia ». Il faut ajouter que les réponses s’inscrivent dans une histoire, celle des lectures faites : évoquant ses souvenirs d’enfant abandonné et ses lectures précoces, Demarcq note que « qui lit descend au moins autant des auteurs qu’il a fréquentés que de son milieu », et les références littéraires ne manquent pas ici, notamment de Baudelaire, Poe, Apollinaire à Cummings. Il faut du temps pour lire et apprécier tous les jeux avec la langue de cette Vie volatile, et c’est tant mieux à une époque où tout "doit" aller vite.
Jacques Demarcq, La Vie volatile, éditions NOUS, 2020, 400 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 septembre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, la vie volatile, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2020
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur
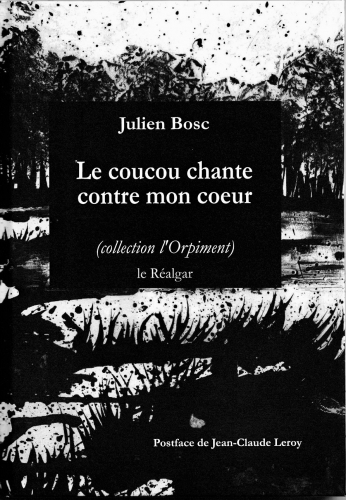
Ce livre posthume de Julien Bosc, en chantier probablement avant 2016, reprend plusieurs des motifs qui lui étaient chers et l’on y entend pleinement sa voix singulière. Le lien avec les livres précédents est au moins une fois explicite ; ainsi un fragment où il est dit qu’un homme sait lire « le verso des miroirs » a donné le titre Le verso des miroirs (2018). Mais ce ne sont pas seulement des mots semblables qui construisent des voies de passage entre les livres, plus profondément est constante la présence de ce qui le hantait : la mémoire des camps d’extermination, de la violence qui ne cesse. Le rêve mais non l’illusion d’une société harmonieuse, le lien profond avec la nature, l’amour d’une femme n’ont pu, dans une solitude choisie, contrebalancer la certitude d’un désastre général.
Julien Bosc connaissait « les souffrances d’un nom / Élu pour le pire » : juif de naissance, il portait toujours les images des camps ; motif principal d’un autre livre, De la poussière sur vos cils (2015), elles sont encore très présentes ici. La destruction n’est pas seulement celle des corps, c’est aussi celle des noms, de toute identité quand il ne subsiste que des cendres et que tout de ce qui a été vécu disparaît à jamais. Ce qui est insupportable à Julien Bosc, c’est à la fois l’extrême difficulté d’imaginer ce que fut le chemin de ceux qui ne revinrent pas des camps et le fait que la voix des survivants n’a pas été (ne pouvait pas être ?) entendue :
Les silhouettes rescapées s’extirpèrent du brouillard
Parler épousa l’innommable
Tout fut tenté pour dire
Rien ou peu fut entendu
Puis tout fut tu
Une femme morte dans un des camps apparaît dans un rêve, invisible mais active, nue sur un cheval et aux longs cheveux comme lady Godiva. Le narrateur accueille cette figure étrange, « mirage » qui « diffus(e) les songes » et qui lui apprend chaque nuit un dizain, le chargeant avant de rejoindre les morts de « poursuivre son chant ». L’écriture naît donc de la nécessité de conserver la mémoire du vécu, de dénoncer « les démences » des tyrans, de défendre ceux qui fuient « la misère et la guerre ». C’est pourquoi dans les dernières pages du livre le sort des migrants, qui meurent en traversant la Méditerranée, est rapproché de celui des Juifs exterminés par le nazisme : Julien Bosc emploie une comparaison sans ambiguïté : « Ils montent mille à bord / Quand le rafiot n’en supporte pas vingt / tels jadis les wagons / qui roulaient vers l’hourban. » ; "hourban", « ruine » en hébreu, est un terme théologique, relatif à la destruction du premier et du second Temple, abandonné aujourd’hui au profit de "Shoah". Le lien est poursuivi : la destruction des Juifs s’est déroulée sans que personne n’en dise rien et la mort des migrants laisse muet, « Qui peut entendre leurs cris ? Personne ou si peu », d’où le constat qui clôt le livre : tout le monde est coupable de garder le silence devant la tragédie, et notamment l’écrivain « À qui la langue manque : / Pour dénoncer ».
Cette impossibilité d’exprimer à propos du réel ce qui devrait l’être parcourt tout le livre ; dès son début, à côté de la forêt, de la mer, donc de la nature telle qu’elle est imaginée par le narrateur, il n’y a rien, ou plutôt « Ce qui doit être dit mais ne peut ». Face au désastre est construite la fiction d’un monde harmonieux où se réfugie un temps le narrateur ; après qu’il eut été battu et torturé parce que différent, il est exilé sur une île très étroite et s’invente alors une sorte de paradis où il est soigné par une sangsue (elle suce ses nécroses) et une épeire (ses toiles suturent les plaies) ; il apprend les oiseaux et, les jours de mélancolie, « le coucou chante contre (s)on cœur ». Tableau idyllique qui fut celui d’un âge d’or détruit par « l’invention des races », la volonté d’accumuler des biens, les conquêtes. Il y a chez le narrateur une hésitation entre une vision proprement apocalyptique (« Le ciel s’obscurcit / Chargé de cendres et de plaintes [...] ») et le rêve d’un monde réconcilié (« Le ciel s’ouvrit / Les oiseaux s’accouplèrent /[...] », parcours d’un extrême à l’autre qui ne permet pas de vivre aisément dans le monde éloigné de ces deux visions.
La tentation est toujours de se retirer, de se dépouiller de tout pour recommencer à vivre, être « Nu de peau de tout / Pour l’aventure la dérive l’amour la mort. » ; l’un des rêves du narrateur découvre d’ailleurs la femme aimée morte dans un fossé mais qui s’éveille — donc tout à fait nouvelle —, et la femme désirée, « contre soi », éloigne « les terreurs et la mort » ; mais le narrateur hésite constamment entre cette relation apaisante et le repli, en particulier la solitude devant la mer qui est « la beauté tout ici devant soi ». Le texte regorge de mots relatifs à la mer (tempête, fanal, naufrage, radeau, phare, lames, vague, écume, clapot, etc.) et aux oiseaux de mer, et l’on retrouve la fascination pour la mer à l’origine de La Coupée (2017).
La forme d’écriture privilégiée dans ce livre s’accorde avec le propos, il s’agit de l’énumération, souvent de groupes nominaux, parfois d’infinitifs, qui sortent le procès du temps et de la personne, énumération chaque fois proche de la psalmodie :
L’ivresse du pouvoir
Le dédain de la parole donnée
La compromission des maîtres
Le mépris vis-à-vis des plus pauvres
L’insanité des mieux pourvus
Les noyés dans l’indifférence
La déportation
Les camps
La mer cimetière
Que regretterai-je ?
Il s’agit, par ce procédé, de « tenter de dire ce qui est » (La Coupée, p. 26), la lecture même devrait accepter le prosaïsme des vers et viser ce but, effectuée « Sans effet ni intonation particulière // (...) non une litanie / Un chant ». Rythme d’un chant qui ne cherche pas d’effets, « dans la lignée des épopées sans gloire » comme l’écrit justement dans son témoignage Jean-Claude Leroy, l’ami de longue date.
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur, postface de J.-C. Leroy, collection L’Orpiment, La Réalgar, 2020, 84 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 23 septembre 2020.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le coucou chante contre mon cœur, postface de j.-c. leroy, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2020
Laurent Albarracin, l'herbier lunatique : recension
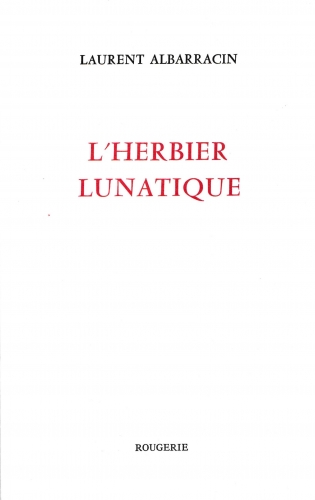
Quoi de plus naturel, de plus proche de la nature qu’un herbier, même quand il est lunatique et que, fantasque, il n’obéit pas tout à fait aux règles de confection classiques ? Celui de Laurent Albarracin réunit peu de plantes et fait la part belle à la pierre, à l’eau, à l’oiseau, au vent, au feu mais l’on y trouve aussi, entre autres choses, une clef, une chaise — et la lune. Les poèmes de L. A. visent toujours à écrire à propos des choses qui nous entourent, ce qui, trop évident, échappe au regard, mais aussi selon l’idée que cette « quête » de connaissance n’a pas « D’autre conclusion que celle qui consiste / À recommencer. »1 Ce recommencement n’est en rien répétition ; selon la manière dont une chose est regardée elle apparaîtra autre, d’où les variations autour de la pierre, par exemple quand elle est en contact avec l’eau. Quand Ponge écrit : « Sorti du liquide, il (le caillou) sèche aussitôt. C’est-à-dire que malgré les monstrueux efforts auxquels il a été soumis, la trace liquide ne peut demeurer à sa surface : il la dissipe sans aucun effort », L. A. ramasse l’observation :
Mouille un caillou
assombris-le
et son éclat sèche aussitôt
comme un peu de brume lui venant
Ce n’est évidemment pas simple observation ; s’il s’agissait simplement de noter ce qui est vu — ce qui est une voie suivie par des poètes aujourd’hui —, y aurait-il ajout au monde ? le poème peut donner à voir ce que seule une relation établie entre réel et imaginaire peut saisir, ainsi l’image de la pierre retirée de l’eau, « luit vivante et morte. / On aurait donc arraché / un cœur à ses battements ? »
La chose la plus commune peut devenir source d’évocations variées, très éloignées de la chose, c’est pourquoi la relation de la pierre et de l’eau peut être inattendue et prendre un caractère inquiétant, « Jette une pierre dans le lac / pour éveiller son gouffre ». À côté d’une notation qui rappelle qu’ajouter de l’eau au ruisseau ne change pas son cours — on se souvient d’Apollinaire —l’image de la goutte d’eau qui tombe en accélérant son mouvement entraîne deux comparaisons ; la première où le verbe s’entend à la fois pour "devenir mûr" et "méditer", « comme un fruit mûrit / longuement sa chute » ; la seconde s’éloigne de l’image de départ (le passage de la lenteur à la vitesse) avec un propos sur la vie, « et comme la vie prépare / l’impromptu », impromptu alors s’opposant à longuement.
Ce jeu dans la langue est constant dans cet Herbier lunatique ; ce qui est donné à voir n’est pas que dans le réel, certes la pierre brisée ne change pas, elle reste pierre, et la bouteille qui se vide peut évoquer le bruit d’un poisson qui respire, mais les éléments d’une réalité observable sont parfois inversés et sortent alors le lecteur de toute réalité ; ainsi, au fait que le vent agite les feuilles des arbres est substituée l’image de feuilles qui déchirent le vent — et qui aurait soupçonné que la chaise devant le paysage « attend », tout comme
La fenêtre pose
devant le paysage
qu’il reste encore
à l’ouvrir
Ces deux exemples, parmi d’autres, indiquent clairement que Laurent Albarracin est loin d’être dans le sillage d’un "parti pris des choses" — on pense dans ces exemples à certaines chaises de Magritte et à des fenêtres de Bonnard. On lira donc de courts poèmes dont la simplicité apparente ouvre sur l’imaginaire, « L’herbe qui pousse / entre ce qui n’existe pas / le démolit » ou, pour rester avec l’herbe, « La touffe d’herbe / oriente l’univers / dans le sens / de la touffe d’herbe ». Ou les mâts en mouvement dans le port inventent le bruit du lointain qui veut repartir...
Ce sont ces multiples jeux dans la langue qui construisent le monde de L’herbier lunatique et, constamment, le rythme des poèmes. Ici, dans la relation de la pierre et de l’eau s’établit l’opposition entre « opaque » et « clarté », ce dernier mot proche par anagramme partielle de « éclat » ; dans le même poème on lit le passage de « durcissement » à « dur », puis « durée ». Là, « exact » entraîne « exsude » et « prune », avec une lettre de plus, « pruine ». Si la teinte de l’eau est proche de celle du fer, le passage de « teinte » à « tintement » — le tintement d’une épée — s’impose, tout comme le vol des corneilles ne peut que « corner » le ciel qui devient une page. Un dernier exemple, qui a la concision d’un haïku2, où à l’allitération (/p/) s’ajoute la double signification des mots (quartiers, quartiers d’été) :
Pomme pourrie
prend ses quartiers
d’avoir été
Il y a comme une impossibilité de fixer un sens ; aucune chose, même quand elle paraît de prime abord "simple" à regarder, ne peut être une fois pour toutes mise en mots. On compte dans le livre plusieurs poèmes autour de la pierre, de l’eau, mais la pierre, l’eau restent cependant opaques ; le « secret enfoui tout au fond des choses », « Plus nous nous en approchons et plus il se met / À ressembler à son approche tremblante »1. Tout est toujours à recommencer, c’est là peut-être qu’est la poésie.
1 Laurent Albarracin, Res Rerum, (Arfuyen, 2018).
2 Laurent Albarracin a publié un recueil de haïkus, Plein vent (Mainard, 2017).
Laurent Albarracin, L’herbier lunatique, Rougerie, 2020, 64 p., 12 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 25 août 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, l’herbier lunatique, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2020
Pierre Vinclair, La Sauvagerie : recension
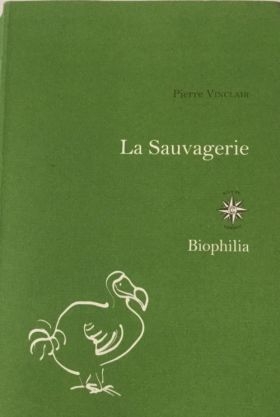
En 2012, quand elle a créé "Biophilia", Fabienne Raphoz définissait ainsi la collection : elle a « pour vocation de mettre le vivant au cœur d’éclairages ou de rêveries transdisciplinaires ». Sans faire le tour des titres disponibles, il est bon de rappeler qu’on lit aussi bien des récits de voyage, d’observateurs scrupuleux — entomologistes, ornithologues, etc. — que des contes, des fictions. Et c’est cette variété d’approches qui aide aujourd’hui à mieux réfléchir à ce que devient l’environnement et aux moyens de préserver ce qui reste du vivant. Le dernier livre paru a un statut particulier, non parce qu’il aurait pour auteur un romancier, philosophe et poète (ce qu’est Pierre Vinclair) mais, d’abord, par le choix de sa construction et de son sujet.
La Sauvagerie, divisé en 12 ensembles, est construit sur le modèle de la Délie (1544) de Maurice Scève, ensemble poétique qui comprend 1 huitain, 449 dizains et 50 emblèmes (1 tous les 9 dizains), chaque figure symbolique (la Licorne, une chandelle, Orphée, etc.), accompagnée d’une inscription lapidaire, étant en relation avec les dizains suivants. Dans La Sauvagerie, le huitain en ouverture est suivi de 499 dizains, 48 ayant pour auteurs des poètes contemporains, dont plusieurs de langue anglaise, traduits par Pierre Vinclair qui a lui-même proposé des dizains en anglais, avec leur version en français ou traduits par Alexandre Prieux. Cette forme ancienne, plutôt marginale après le XVIe siècle, n’a cependant pas du tout disparu, présente de Baudelaire à Bonnefoy, de Corbière à Queneau ; historiquement vivante, elle offre un cadre commode comme toute forme réglée — « à toute règle qu’on s’impose correspond aussitôt une liberté de l’esprit », remarquait Valéry (Cahiers, I, 1060) (1).
Le point de départ du livre n’est guère discutable, la Terre est bien en voie d’être détruite par les hommes et cela est devenu une nécessité d’intervenir pour préserver ce qui peut l’être ou, au moins, de prendre conscience qu’il sera bientôt trop tard pour arrêter la destruction de la Nature. Que peut bien faire la poésie devant l’urgence écologique ? Certainement pas (r)enseigner, se substituer à ceux qui interviennent pour informer et ralentir le saccage, faute de pouvoir le faire cesser. Il est évident que des poèmes ne vont pas interrompre les actions d’Exxon, de Total ou de Shell ni transformer « le grand cimetière qu’est la Terre ». Mais le poème, parce qu’il est rythme et musique, peut donner chair à la tragédie de plus en plus sensible que nous vivons ; parce que fait de langue, il est présence, irruption et, en cela, contient quelque chose de la sauvagerie propre à la Nature. Pierre Vinclair l’énonce clairement dans un dizain (245), « Je bâcle des poèmes célébrant le Sauvage partout où il résiste encore ».
À lire et relire les dizains, on ne trouvera pas que l’auteur (pas plus que les invités) a écrit « à la hâte et sans soin » (2), tant l’ensemble est une exploration des divers aspects de la crise écologique ; Pierre Vinclair définit son objectif dans Agir non agir paru en même temps que La Sauvagerie, « c’est bien le tout comme tout qui est en jeu : à la fois l’omnia de la pluralité du vivant (individus et espèces) subissant une extinction de masse, et le totum de Gaïa, la Terre comme système. (...) Face à un tel problème (...) le peu que (la poésie) peut, ne devrait-elle pas l’investir d’abord dans la reconsidération de sa possibilité à en donner une image ? ».
Cette image se décompose en de multiples aspects et l’on ne tentera pas de les énumérer. Le huitain d’ouverture (comme dans la Délie, donc) de Jean-Claude Pinson, refuse toute défaite et oppose au titre "À l’agonie" le ciel bleu, image de la pastorale et, par les références à la Grèce ancienne (Orphée, Gaïa) et à Scève (« object-de-plus-haulte-vertu ») donne espoir au chant, en appelant à la tradition contre l’asphyxie d’aujourd’hui. Le premier dizain, lui, donne à lire l’évolution de la terre, des rochers de ses débuts à l’état actuel : « les ice / bergs fondirent, des îles plastiques dérivèrent / sous un smog de spams, selfies et poèmes » ; ce qui compte, c’est le dernier mot, écarté des allitérations qui le précèdent. Suivent des dizains à propos de la vache, qui n’est plus depuis longtemps un animal sauvage (« comment les libérer ? »), un oiseau disparu, le dodo, la mouette et la première introduction dans le livre des deux enfants de Pierre Vinclair et de sa compagne (qui signe d’ailleurs un dizain) : les poèmes sont aussi pour l’avenir. On rapprochera cette relation au futur à celle au passé, quand il se souvient de son enfance dans le Cantal et de la nature, reconstruction à partir des notes de son père. Il est un autre passé, celui des espèces disparues et, aujourd’hui, de celles en danger d’extinction auxquelles cent dizains sont consacrés d’après une liste établie en 2012. En titre, les noms des végétaux, des animaux — papillon, singe, serpent, libellule, poisson, tortue, etc. — sont donnés en latin, comme s’il n’était plus possible de les désigner par un mot courant, « quelle langue pour protéger les arbres menacés ? » La litanie des noms propres à la nomenclature scientifique pourra probablement se poursuivre, la destruction ne cessant pas, et le poète n’a pas d’autre pouvoir que chanter, « si l’on peut appeler ça chant ».
Pourtant le chant existe bien et est partagé. Si des poétesses et poètes ont été invités, c’est qu’ils se substituent aux emblèmes de Maurice Scève avec une fonction analogue ; chaque dizain venu de l’extérieur est prolongé par un dizain de Pierre Vinclair. Ainsi, quand Valérie Rouzeau écrit en capitales une lettre (ou deux) dans chaque vers, pour que soit lu le nom d’un animal (RHINOCÉROS), le dizain suivant inscrit de la même manière le seul lieu où vit tel animal (QUE DU TONKIN). Mais la présence de ces invités a une autre sens, me semble-t-il : incarner la tragédie du vivant ne peut être le fait d’un seul.
Pour Pierre Vinclair, ses dizains revêtent des formes variées, en vers non comptés (un vers même n’a qu’une syllabe), en décasyllabes (parfois au prix de chevilles), en hexa- ou en octosyllabes, comme si l’absence de régularité restituait quelque chose de la variété du vivant. Comme dans la Délie, un dizain peut annoncer le suivant ou lui être lié syntaxiquement, un énoncé commencé dans le premier s’achevant dans le second, et l’on peut en lire trois qui s’enchaînent (voir 342-343-344). D’un bout à l’autre, les poèmes sont inscrits dans l’histoire littéraire, par les fragments cités en épigraphe des douze ensembles, par les noms cités dans le cours du texte et par les citations plus ou moins transformées et reconnaissables ; « J’ai moins de souvenirs que si j’avais / passé au pub (...) » évoque immédiatement Baudelaire, comme « genre / bibelot d’inanité abolie » renvoie à Mallarmé ; dans le contexte des dizains « la grille de parole du poème » n’est pas une référence immédiate à Celan, pas plus que « roses sans pourquoi » à Angelus Silesius ou tel vers à Desnos ; etc. Dans l’ensemble du livre, on lit une maîtrise des codes de la versification à bien des niveaux et, de surcroît, un plaisir — une « joie d’enfant » — à ne pas toujours les respecter : on ne peut ici retenir que quelques éléments.
Il faudrait relever, par exemple, les très nombreuses paronomases et allitérations, comme « avec son slip seul sur son roc », le dernier mot ici rimant visuellement avec « croc ». On peut suivre également un ensemble de figures dans une série de dizains relatifs à un animal ; la mouette entraîne l’allusion à Tchekhov et, par son vol libre, inévitablement à Éluard (« liberté / j’écris ton nom »), mais aussi amène une paronomase : mouette/moite/ moètes, où l’on entend une relation à "poètes", d’où le passage à « moèmes ». Pierre Vinclair ne néglige pas le calembour, de « l’abeille de Thélème » au « vers de terre à pied », et le jeu de mots d’une langue à l’autre ; ainsi, après la coupe « lamb/eaux », on lira « tels des agneaux (...) bêlantes ». Telle rime est une anagramme (« rouge / goure »), d’autres sont seulement des lettres (voir 353) ; ici, un é qui termine un vers est commun aux trois premiers mots du vers suivants, « bloui, trange, tranglé » ; là, un groupe est interrompu par une parenthèse de deux vers avant d’être complété (« des paysans (...) d’Inde », le hameau devient « l’hameau » pour obtenir le nombre de syllabes voulu. Etc.
On sait bien qu’une espèce vivante disparue a droit à son image sur un timbre et que « Secourir les espèces l’une après / l’autre dans un poème est sympathique / mais autant écoper sa barque avec / une écuelle trouée, non ? ». Cela ne devrait pas conduire pour autant à s’accommoder de la destruction de la Nature. Que la poésie soit un terrain de combat pour la question écologique est un fait nouveau : Agir non agir porte en sous-titre éléments pour une poésie de la résistance écologique, le dernier livre de Jean-Claude Pinson s’intitule Pastoral, de la poésie comme écologie (Champ Vallon, 2020).
Le domaine poétique a sa part dans l’évolution de la pensée et peut contribuer à faire réfléchir à ce que l’on fait quand on photographie au zoo « les singes singeant entre les barreaux / la sauvagerie qui nous charme tant ».
- On peut aussi relire Baudelaire : « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense » (Lettre à A. Fraisse, 18/02/1860).
- définition de "bâcler" dans le Trésor de la langue française.
Pierre Vinclair, La Sauvagerie, Corti, "Biophilia", 336 p., 22 €. Cette note lecture a été publiée par Sitaudis le 4 juin 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, la sauvagerie, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2020
Antoine Emaz, Personne : recension

Le livre reprend quatre poèmes, dont trois parus chacun en édition limitée — deux en 2017, un en 2018 — le dernier dans une anthologie en 2018, et un poème plus ancien (1996), "Personne", lui aussi publié en tirage limité. Il s’ouvre par la question « et donc là qui », à laquelle Antoine Emaz refuse, comme il l’a toujours fait, « d’aboyer / moi moi moi ». Ce n’est pas nier la présence de celui qui écrit mais rappeler qu’il est, d’abord, comme « chaque un », « paquet de viande / bardé de peau » ; le "je" n’est pas ce qui importe, ici mis de côté, sous la forme « j’euh » ou placé entre deux termes — « quelqu’un je ou / personne » — qui renvoient à ce qui est le plus général, comme le "on", toujours adopté dans les poèmes. Refuser l’effusion n’est pas effacer le corps, qui sera « debout / parmi les corps-mots qui bougent » ; il s’en faut d’une lettre pour que l’on entende "corps-morts". Outre "debout", le lecteur reconnaît dans ce premier poème d’autres mots propres à Antoine Emaz, "mur" et, qu’il retrouvera sous une autre forme dans les poèmes récents, le couple "dans (dedans)" / "dehors".
Il s’agit toujours de tenter de restituer quelque chose des émotions à partir de la saisie de la réalité extérieure, non de s’épancher, c’est par ce qu’il retient des choses vues que le sujet apparaît. Le poème "Passants" en est un exemple ; contrairement à la passante dont l’œil « fascine » Baudelaire ("À une passante") et qui suscite chez le "je" des images amoureuses, les passants sur la plage n’ont pas de visage, « passants / rien d’autre », et c’est la désignation elle-même qui entraîne des images et le retour aux « passés », ces temps retrouvés avec « l’œil dedans » : la scène du dehors, elle, est « vide, à nouveau ». À partir des mouvements du dehors naissent plus ou moins vivement des traces du vécu et, comparables aux mouvements des vagues à marée basse quand elles ont perdu leur « énergie », « les êtres passés » qui reviennent à la mémoire sont devenus des « ombres », les images donnent fugitivement l’illusion qu’on revient dans un autre temps, mais seules les vagues « effacent ramènent », parce que « les mêmes / pas les mêmes ».
La mer, le sable et le vent sont les motifs des poèmes des dernières années d’écriture. L’espace se définit fortement par sa stabilité — le sol « serré / sous le pas » —, familier, rassurant parce que paraissant toujours identique à lui-même, les pas s’impriment dans le sable, disparaissent avec les vagues et il suffit de reprendre la marche pour qu’ils soient à nouveau visibles. Ressassement, toutes choses semblant ne jamais se transformer, « sable mer ciel » identiques ici ou ailleurs, ce qui accroît le sentiment d’être seul, dans la solitude, au milieu du paysage. Quand on passe de la plage à la page, les mots échouent à restituer l’apparence d’immobilité du paysage, il est là et cependant manque ce qui le fait vivant, il est maintenant « un lieu sûr sans lieu / nulle part / ici », on peut le répéter mais le vent — le mouvement de la vie — y sera toujours absent.
C’est le mouvement du vent dans des branches, alors images du désordre, qui fait aussi surgir, elles aussi désordonnées, les images du passé, fouillis, avec tout ce qui aurait dû être dit. Rien de ce qui a été vécu ne peut être retrouvé par les mots, de quelque manière que ce soit, et c’est cette illisibilité qui domine quand on cherche à classer ce qui fut, parce que « passent la vie et le sable des gens ».
Quelque chose de la maladie d’Antoine Emaz passe dans les poèmes, mais ce ne sont pas tant les défaillances du corps, la difficulté à se déplacer normalement qui l’indiquent que le sentiment de ne pouvoir restituer ce que le regard perçoit, « on ne sait plus // sans avoir peur », ou de ressaisir autre chose que des bribes dans la mémoire. De là sans doute dans un poème la reprise de la fin du premier vers, « tristesse étrange », de "Semper eadem" de Baudelaire. "Plein air" s’ouvre aussi avec Baudelaire, les premiers mots, « long linceul », venus de "Recueillement" ; "linceul" est, plus avant dans le texte associé à « suaire » ; ces mots sont liés à la mort, tout comme la proximité ensuite de "linge" et de "face" — comment ne pas penser au Christ ? Mais que la vie s’éloigne semble s’inscrire dans la construction même des séquences du poème : le verbe en disparaît presque complètement, comme dans ce fragment, « mots face rien dans leur peu presque vide bleu ». L’allitération du début (rare chez Antoine Emaz), « le bleu du linge qui bat l’air là », est comme un adieu aux ressources de la langue pour le choix d’un dépouillement beckettien, bien lisible dans la fin du poème, « de l’air au bout rien d’être que bruit de langue qui passe dans le vent sous le ciel // c’est encore dire ».
La préface de Ludovic Degroote n’est pas seulement l’hommage d’un ami ; reposant sur une connaissance approfondie des livres d’Antoine Emaz, elle y situe précisément les poèmes de Personne et, suggérant sans pesanteur une interprétation, elle est une invitation à explorer une œuvre brutalement interrompue.
Antoine Emaz, Personne, éditions Unes, 2020, 64 p., 16 64 p., 16 €. Cette note de elcture a été publiée par Sitaudis le 27 mai 2020.
Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, personne, éditions unes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
02/05/2020
Paul Valet, La parole qui me porte et autres poèmes
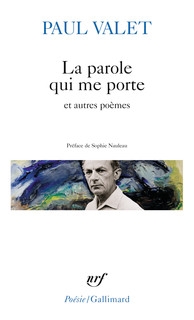
Le livre rassemble plusieurs titres, Lacunes (1960), Table rase (1963), La parole qui me porte (1965) et Paroles d’assaut(1968), choix heureux qui donne à lire un ensemble cohérent. On peut espérer que cette édition de poche fera sortir Paul Valet de l’ombre : estimé de Guy Lévis-Mano, René Char, Henri Mi chaux, Cioran, Maurice Nadeau, par Jean Dubuffet pour sa peinture et Yvonne Zervos qui l’exposa, salué par Jacques Lacarrière (Paul Valet, Soleil d’insoumission, 2001), il reste encore méconnu. Certains l’ont découvert grâce à ses traductions du poètes russes, Joseph Brodski en 1963 (Seize poèmes) et Anna Akhmatova en 1966 (Requiem). Il faut peut-être lire la préface de Sophie Nauleau avant les poèmes pour faire un peu connaissance avec un homme dont la vie et l’œuvre sont hors des sentiers battus.
Né Grzegorz Szwarc en 1905 dans une famille juive en Pologne, il passe son enfance en Russie, d’où la révolution d’Octobre 1917 oblige sa famille à s’exiler, en Pologne puis en France en 1924. Devenu Georges Schwartz, il entreprend des études de médecine, est naturalisé français en 1931 — ainsi que Chaïa Tenenbaum, épousée l’année précédente —, devient médecin en banlieue ouvrière, à Vitry-sur-Seine où il vivra jusqu’à sa mort. Sauf pendant la guerre où, après sa démobilisation, il est l’un des organisateurs de la Résistance en Haute-Loire et dans le Cantal avec le mouvement "Libération". En 1945, il apprend que père, mère et sœur sont morts à Auschwitz. Il commence à écrire et choisit le pseudonyme de Paul Valet, expliquant en 1963 dans un entretien : « je ne suis pas libre d’écrire ce que j’écris. La pensée va au-delà de la parole et, pour exprimer ma pensée, il faut que je la soumette aux lois de la parole. Je suis donc le valet de la parole, le valet de la poésie. Et puis au Moyen Âge, un valet c’est un jeune homme chargé d’un noble service. C’est joli, non ? » (1)
Les vers de Paul Valet, une large partie d’entre eux du moins, évoquent l’art classique de la maxime par leur concision, leur caractère synthétique, leur autonomie aussi ; souvent réunis en distiques, ils ne nécessitent pas a priori d’être lus avec un contexte, comme par exemple : « Chacun porte son vide / Où il peut ». La lecture s’arrête pour saisir ce que remue en soi la proposition, mais on rassemble progressivement dans l’ensemble du livre tout ce qui est relatif à l’absence, au vide, motif récurrent, et l’on revient à ces deux vers. Motif récurrent, dont l’énoncé est parfois repris sous une forme un peu différente dans le même livre ; dans Lacunes, le fort sentiment que la vie de l’homme compte pour peu entre deux bornes est exprimé à deux endroits : une première fois avec l’image traditionnelle du passage, de la porte, « La naissance et la mort / Deux portes siamoises », une seconde fois en rapprochant plus brutalement les deux moments, le début et le terme venant presque à se confondre, « Avant ma naissance / J’étais déjà mort ». La thématique du vide, si présente, est fondée sur l’expérience personnelle douloureuse, mais perçue comme propre à toute vie humaine ; de là des vers qui n’ont rien d’énigmatique, comme « Depuis des millénaires / Je mâche le même refrain ».
D’autres énoncés ont également une portée générale, présentant le sort commun comme une épreuve, quelle que soit la manière de vivre, « J’ai deux pieds / L’un patauge dans la boue / L’autre dans l’abîme ». Personne ne peut échapper à l’absence d’horizon et l’universalité de ce destin clairement exprimée, « Chaque homme est traversé / Par une voie sans issue ». C’est souvent avec la forme de l’aphorisme qu’est ôtée la possibilité d’un mouvement vers l’Autre, « Les pensées les plus tendres / Pourrissent les premières ». Dans l’univers de Paul Valet, on est toujours confronté au vide de l’existence ; l’un des très rares poèmes, titré "Liberté", l’élément naturel, vu positivement, qui apparaît est aussitôt présenté comme interdit,
À l’orée de la liberté
L’herbe se fait haute
Parfumée
Tendre
Infranchissable
Comme si l’humain n’avait, ne pouvait concevoir d’autre perspective dans sa vie que la mort ; au cogito, ergo sum cartésien, est substitué « Je péris / Donc je suis ».
On ne peut s’empêcher de lier ce lyrisme douloureux de Paul Valet aux tragédies de l’histoire qu’il a vécues, non qu’il y ait "témoignage" dans sa poésie, mais la disparition de ses proches, plus largement les camps d’extermination, constituent un arrière-plan, « tant entendu que le drame personnel est devenu exemplaire. Écrire « Je suis habité par les morts / Nourri, lavé, soigné par les morts » à la fois renvoie à un vécu et rejoint autour du motif de la mort la poésie de la fin du XVIe siècle.
Le passé, ce sont d’abord les morts, ce qui a construit celui qui écrit, « Débris de mémoire / En quête de l’oubli » ; la réalité de l’absence ne peut être annulée, cependant s’il écrit « Je suis le Valet / De l’éternel malade », ce n’est pas pour céder à un quelconque repli sur soi : avoir la certitude du vide mais affirmer « Mon destin / Le refus de l’Abri ». La parole qui me porte est aussi le titre d’un poème dont un vers (devenu le titre d’un autre livre) est un programme positif, « Que pourrai-je vous donner / De plus grand que mon gouffre ». L’art poétique de Paul Valet repose sur le refus du détour, sa poésie est une « Réponse à l’existence » et exprime sa volonté de trouver une « place pour le cri ». Il s’agit bien de comprendre, de faire comprendre ce qui guide l’écriture, rien ne pouvant effacer « la détresse / de celui qui voit ». Paul Valet note dans un poème, "Art poétique", « L’épouvante attend / Que je vienne lui rendre la parole ». C’est pourquoi il lui est difficile de trouver les mots pour restituer quelque chose de la perte, du « naufrage ».
Cette poésie exigeante n’hésite pas à jouer avec des expressions courantes, donnant vigueur au propos (« Les murs écroulés / Ont perdu leurs oreilles », « Les poètes aboient / La poésie passe », etc.), cependant les clins d’œil ou les jeux rhétoriques sont rares. On trouvera quelquefois l’emploi de l’anaphore, quelquefois des oppositions de sens (en liberté-sauvages). Quand dans un vers des mots riment entre eux, Paul Valet exprime alors avec concision ce qu’il souhaite que soit sa poésie :
Mirage Visages Image
Resterai-je toujours votre valet ?
* Entretien avec Madeline Chapsal, L’Express, 15 août 1963, repris dans Paul Valet cahier dirigé par Guy Benoît (Le temps qu’il fait, 1987), cité par S. Nauleau.
Paul Valet, La parole qui me porte at autres poèmes, préface Sophie Nauleau, Poésie / Gallimard, 2020, 224 p., 7, 50 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 30 mars 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valet, la parole qui me porte at autres poèmes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2020
Pierre Alferi, chaos : recension

divers chaos réunit des poèmes écrits ou publiés au cours des années 2000 (un seul ensemble date de 1993), sous une autre forme ou dans un autre contexte pour des poèmes isolés — par exemple, un hommage à Jude Stéfan édité isolément (ink, 2011) est intégré dans la sirène de satan. Le titre — chaoss’emploie rarement au pluriel(1) — insiste aussi bien sur la diversité des ensembles que sur la mise en question de normes formelles admises et, par ailleurs, sur l’état de la société, image du désordre.
Le premier chaos, c’est celui que retiennent les poèmes d’ouverture ; et la rue(2018) présente une vue de la ville — Paris — aujourd’hui et questionne la difficulté à restituer la réalité : comment le mot "violence" peut-il suffire à dire ce que sont les opérations de police ? La violence de l’État prend des formes diverses, visibles, abandonnant les plus pauvres, les migrants dans la rue ; aussi
la honte nous survivra
nos descendants diront
enjambaient des corps
longeaient des familles à terre
pour faire leurs courses
Alferi brise la syntaxe, ici et dans d’autres poèmes, pour que la violence dans la réalité quotidienne soit inscrite dans la langue. Le désordre s’impose à d’autres niveaux, les changements affectent la manière d’habiter la ville et rejettent à l’extérieur une partie de la population (« on va / vivre plus loin »). En même temps c’est « la laideur sans frontières », l’importance des "jeux du cirque" avec des « projecteurs / plus haut que les flèches / de leur dame », la transformation de la nourriture (« les churros les burgers »), la surveillance permanente (« souriez / vous êtes filmés »), les pratiques à la mode et leur vocabulaire (« phyto chéro déco bio »), l’omni-présence des médias (« les nouvelles nouvelles »). La « métaphore du vide » est prolongée par l’existence des parcs dits de loisir, celui de Disney et « son univers impitoyable- / ment fluide ». Monde du leurre et de la suffisance dans lequel les assis « mangent des huîtres sous faux modigliani ».
Rien d’heureux dans ce tableau, encore assombri dans rue des deux-gares. Le premier poème donne le nom de quelques médicaments antidépresseurs et, progressivement, s’impose l’image d’un monde sans assise ; on voit « une vieille qui pisse / un allemand fou aux urgences / qui hurle je suce je suce ». Dans la sirène de satan (2019) c’est encore un monde de semblant qui est présenté, où « chacun trouve un équilibre / sans se soucier des autres » : « vivre sépare ». La violence n’a rien de symbolique — on peut compter « le nombre d’éborgnés chez les manifestants » — et il faut (et l’on peut) écrire à propos de la réalité de la société, « un poème qui touche / la crasse ». Poésie non pas "engagée", mais contre le chaos pour que chacun « lève / les yeux vers le / dégagement / qui rend la ville / propre à de nouveaux / usages d’utopie ». L’écriture permet de construire un cadre pour saisir quelque chose de la réalité, dire le chaos pour imaginer ce qui pourrait être autre.
En se souvenant cependant que le sens, des mots comme des choses, échappe souvent, comme tel graffiti sur un mur : une injonction peut être claire (« rappelle-toi beryllos »), mais ni le destinateur, ni le destinataire, ni le contenu de ce qui est à se remémorer. Cette question du sens est une de celles abordées dans un livre de Jacques Derrida (La Carte postale, 1980), cité par Alferi (« chez nous tous les messages / dépassent leur cible / je n’oublie pas la carte / postale de mon père »). On peut orienter le sens de la lecture d’un énoncé grâce notamment à l’emploi de paronomases (« l’arrêt alité », « des gafa gaffe à », « l’intime mité », etc.), ou par le rejet (« la rentrée des classes / sociales »). On s’arrêtera aussi à la manière dont est travaillée une forme traditionnelle, le sonnet.
Écrire l’histoire du sonnet, ce serait sans doute retracer les transformations du modèle pétrarquiste et du modèle français jusqu’aux sonnets en prose de Roubaud. Pierre Alferi, lui, abandonne la langue et propose un sonnet en 14 dessins, sonnet que l’on peut reconnaître de forme shakespearienne : (ABBA) x 2 CDCDEE — cette forme est aussi celle de quelques pièces (dont la première) des Holy sonnets de John Donne (2). Des personnages en noir au premier plan dans la première image sont en grisé dans l’image, vue comme dans un miroir, qui "rime" avec elle, et ceux au départ en grisé viennent alors au premier plan ; ils sont en mouvement dans les "quatrains", plutôt immobiles dans les "tercets". Une simple description du dispositif montre donc que les règles sont respectées si l’on accepte l’équivalence une image = un vers. Cependant, on est loin du projet des poètes du XVIe siècle pour qui le sonnet visait à illustrer les ressources de la langue ; ici, le lecteur peut commenter l’attitude des personnages (coureur, lutteurs de sumo, femme aux seins nus sur un piédestal, équilibriste, etc.) sans qu’il soit possible d’introduire une continuité propre au genre : c’est le contenu même du mot "sonnet" qui vacille.
D’autres ensembles mêlent texte et dessin. Algologie est écrit à partir de dessins d’algues empruntés au livre d’une botaniste ; sous le titre beryllos des lettres en désordre de l’alphabet grec annoncent le graffiti au centre du poème. La première page de gauche de propre à rien (où "propre" est aussi à entendre pour « bien lavé ») évoque dans une chambre les odeurs du corps (cou, seins, sexe), évocation qui s’ouvre par une homophonie, « chair amie », et se ferme par une paronomase, propriété-propreté, en accord avec la relation suggérée ; la chambre est dessinée page de droite, réduite à un lit et à un téléviseur. La plupart des poèmes suivants sont liés aux odeurs avec une répartition texte-dessin analogue ; la dernière image présente un homme fort concentré pour lâcher des vents, image du refus de la bienséance, « — tout plutôt que / l’arrogance du neutre / du littéral déodorant / réputé libre ».
Le dessin n’est pas une simple illustration de ce que les mots suggèrent, et d’ailleurs les mots ne suggèrent parfois que des stéréotypes — une des formes du chaos ? C’est le cas, sous le titre "serial", dans des poèmes en français avec leur traduction en anglais (ou l’inverse), qui énumèrent des situations souvent propres aux films de série B ; ainsi ce résumé de scénario qui ouvre l’ensemble, « une pièce brisée / une boîte noire / une balle de cuivre / sept perles / qu’est-il arrivé à marie ? / avec qui se marie marie ? ». On notera que dans le second scénario, également concis, sont accumulés des mots suggérant l’absence, le manque : perdu, caché, fantôme, sans clé, j’aimais, attachée, bâillonnée.
Il est un autre regard vers l’anglais avec le souvenir des poètes américain John Asbery et anglais Tom Raworth, annoncé dans le premier vers d’un poème par « j’ai deux amours ». Cette allusion transparente à une chanson de Joséphine Baker est peut-être à intégrer dans la pratique d’Alferi qui introduit dans les poèmes, parfois très brefs, quantité d’homophonies, paronomases, allitérations, assonances et allusions, de « cèdre crayon craquant copeau » à patchouli-pâte jolie et au « j’y suis » de Rimbaud. Alferi essaie des formes en prenant son bien partout, y compris avec une forme proche du haïku (dans été passé) ou une mise en page de poèmes chinois. Ce qui reste constant, c’est le choix du vers bref, le plus souvent de 4, 5 et 6 syllabes, vers qui exclut le récit — d’ailleurs un poème s’achève par « l’histoire manque ». L’unité de ces chaos n’est pas que formelle, ce qui domine à la lecture, c’est le rejet du convenu.
- Un exemple dans La Légende des siècles("Le Satyre"), « Au-dessus de l’Olympe éclatant, (...) Plus loin que les chaos, prodigieux décombres ».
2. Pierre Alferi a traduit John Donne (Paradoxe et problèmes, Allia, 2011).
Pierre Alferi, Divers chaos, P. O. L, 2020, 270 p., 18 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 9 mars 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre alferi, chaos, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2020
la revue de belles-lettres, 2019, 2 : recension

La revue de belles-lettres, plus que centenaire — 143ème année ! —, surprend toujours le lecteur, à la fois au plus près de la poésie d’aujourd’hui et ouverte à des zones peu explorées. Cette livraison propose cette fois un dossier de plus de cent pages autour de la poésie russe d’aujourd’hui, "Polyphonie russe", qui rassemble des poètes tous inconnus en France. Mais la revue donne aussi sa place à une poétesse russe de la génération précédente, Elena Schwarz et, comme chaque fois, à des voix de langue française.
Le numéro s’ouvre avec Pierre Voélin et ses Douze poèmes trop courts, plus deux ; poèmes de quatre ou cinq vers inégaux, le dernier plus court, modestie des motifs et simplicité du vocabulaire : les oiseaux du jour et de la nuit, les arbres, les plantes, le bord des chemins et la figure ancienne du cantonnier qui les entretient, la poule, et
La courtilière sur le sentier,
la huppe dans les vignes,
où je passe — là
est mon chemin.
On lira aussi Sylviane Dupuis ("Muta eloquentia"), Jacques Roman ("Qui instruira le livre du calme") et quatre poèmes de Muriel Pic, extraits d’un ensemble à paraître. Autour de la mer Égée, les corps des migrants sur les plages, « La nuit, les noyés s’y baladent / en traînant des pieds » ; les îles ne sont pas que des paradis pour touristes. « Tu voulais toucher le soleil ? / D’autres veulent toucher la terre. ». Le dernier poème est un hommage, en particulier par son dépouillement, au poète américain Robert Lax (1915-2000) qui passa plus de trente ans de sa vie sur l’île de Patmos avant de revenir dans son village natal en 2000.
C’est avec un court récit de Bruno Pellegrino, "L’appartement", que se clôt le numéro. Le narrateur rapporte un travail qu’il a accepté lorsqu’il était étudiant : à la mort d’une écrivaine, il a été chargé de « classer les papiers et établir l’inventaire de ce qui deviendrait un fonds d’archives ». Il a passé de longues semaines à vider des cartons et à entrer dans l’intimité de la disparue mais, en même temps, sa vie « se poursuivait à l’extérieur de l’appartement » et, par ailleurs, c’est au cours de cet été qu’il corrige les épreuves de son premier livre.
Hélène Henry présente la poétesse russe Elena Schwarz (1948-2010) et propose huit poèmes datés de 1988 à 2007, un long poème écrit à la suite de l’incendie de son appartement en 2004, quelques pages en prose dont Trois caractéristiques de ma poésie où elle dit construire « un petit modèle du monde », inventer des thèmes nouveaux (« Les amoureux aux funérailles »), être attachée, comme Ovide, aux métamorphoses. Très tôt « créatrice de l’ombre », « son refus des compromis, son travail poétique nocturne et obstiné, l’inscrivent naturellement dans la dissidence littéraire ». Rappelons que Joseph Brodsky après son procès en 1964 est contraint à l’exil, et ce n’est qu’après 1981que l’étau officiel se desserre : Elena Schwarz peut alors lire ses poèmes et les éditer ; surtout, elle voyage à l’étranger, notamment en Italie, « son pays d’élection ». Les pages d’Hélène Henry sur les contenus et la métrique, font regretter l’absence de traduction de l’œuvre en français, seuls 31 poèmes (1948-2010) ont été publiés en français (La Vierge chevauchant Venise et moi sur son épaule (traduction H. Henry, éditions Alidades, 2004). Le poème d’Elena Schwarz est « à la fois discours à la première personne, négligent, accidenté, bariolé, lexicalement cahotant, et ces confuses paroles que laissait échapper la pythie delphique dans ses moments d’"enthousiasme" ». Un exemple autour de « l’infini de la mémoire » :
Quand je regarde au fond du gouffre de ma vie —
J’y trouve tout un tas de choses
On dirait à mes pieds un entonnoir béant —
Ce qui fut autrefois, ce qui nous arriva,
Et m’arriva à moi et ne reviendra pas.
(...)
L’ivresse, dira-t-on, de lire Khlebnikov,
Le vieux 6x6 de ma jeunesse, et le souhait
De souffrir pour tous, pour tous et plus que tous,
Et cette écolière qui s’appelait Vovk Kourelekh,
Ce passé si pareil à un dépotoir
Il gronde, il griffe, et je suis sans regret.
Le dossier autour de la nouvelle poésie russe est présenté par le poète russe Alexander Markin (qui vit en Suisse) et rassemble neuf poètes nés après la dernière guerre, surtout à la fin des années 1970 ou après 1980. Leurs poèmes prouvent que, malgré le peu de souci du pouvoir de promouvoir une culture vivante, il y a aujourd’hui un « extraordinaire épanouissement » de la poésie, comparable à ce qui s’est passé au début du XXe siècle, avec « expérimentation formelle, thématiques inédites ». Ces nouvelles générations de poètes sont nées dans la foulée de la littérature clandestine d’avant la chute de l’URSS — la littérature libre dans un pays sans liberté diffusée sous forme de polycopiés (les samizdats). Elles ont aussi découvert la poésie européenne et américaine du XXe siècle, ce qui a facilité la rupture avec les formes traditionnelles de la poésie russe. Les poètes retenus ici, parmi d’autres possibles, « thématisent l’expérience traumatique des catastrophes historiques du XXe siècle, les guerres, les répressions, l’effondrement d’un pays immense ».
Plusieurs ensembles de poèmes (tous en bilingue, sauf un) sont suivis d’un entretien avec le traducteur ou de ses réflexions (Yvan Mignot, traducteur par ailleurs de Daniil Harms, les donne sous la forme d’un poème), à propos de ce qui est nouveau par rapport à la poésie russe connue. L’un des poètes, Alexander Averbukh, commente lui-même son travail ; évoquant ici la vie en URSS en 1932, il a écrit à partir de documents et de récits, pour « absorber une diversité de voix ». Cet exilé a tenté d’écrire une « sorte de requiem » et cherché, en s’appuyant sur des témoignages, à faire que toutes les paroles oubliées, enfouies « continu[ent] à résonner (...) avec les incorrections, les dialectes, les accents ». De nationalité israélienne et vivant au Canada, il sait ce que signifie « l’absence de langue ».
Beaucoup de poèmes tournent autour du motif de la mémoire ; Lida Ioussoupova, par exemple, écrit ce qu’a été une enfance sous le régime soviétique, les scènes évoquées glissant progressivement dans le fantastique. La méditation sur le temps d’une autre poétesse, Maria Stepanova, prend un autre chemin : comme l’analyse sa traductrice, il s’agit pour elle de refonder « la mémoire du corps féminin, absent des grands récits », et elle puise dans les mythologies, les littératures, l’histoire. Un passé plus proche de nous, celui des guerres de Tchétchénie et d’Afghanistan, est évoqué par Elena Falaïnova à partir, comme elle le rapporte, de ce qu’elle a entendu raconter par un ancien soldat ; à la lire, on regrette que seul un poème ait été traduit, dont voici la première strophe :
...Les voici repartis sur leur Afghanistan,
Grosny aux grosses roses noires épanouies,
Quand sur la place, ils se sont mis en rang
En carré pour être réduits en bouillie.
Quand a eu lieu le jour de fête du serment
Elle est venue pour se donner à lui,
Elle était la nouvelle Iseut de son Tristan
(Attention, attention, tous à l’écoute !)
[...]
Il faudrait citer d’autres poèmes de cet ensemble foisonnant qui, en effet, rappelle la richesse des années 1920 en URSS, quand le stalinisme n’avait pas encore détruit toute créativité.
La revue de belles-lettres, « polyphonie russe », 2019, 2, 216 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 3 mars 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2020
Rosanna Warren, De notre vivant : recension

Quelques poèmes de trois livres publiés depuis 2003 ont été rassemblés dans De notre vivant et leur réunion esquisse des traits de la société telle que la vit Rosanna Warren. On pourrait ne retenir que la vision d’un désastre quand une allusion est faite à la rue Mutanabi : marché aux livres dans le vieux Bagdad, lieu de culture et d’échanges, mais dans une ville en feu, sous les bombardements. Le monde, là comme ailleurs, connaît « le feu éternel, dit Héraclite », et la quasi citation du philosophe garde son sens si, quittant l’Irak, est évoquée la vie aux États-Unis.
Ce que le lecteur rencontre alors, c’est un monde qui se défait, où tout semble ne pas pouvoir durer et devoir disparaître ; dans un poème titré "Après", il ne reste ici et là que les ruines des temples d’aujourd’hui, magasins propres au mode de vie dominant lié à la consommation, mais une consommation pour laquelle la relation entre ce que le sol peut produire et ce qui est proposé aux consommateurs n’existe pas — ainsi une épicerie asiatique au « toit défoncé ». Subsiste cependant, symboliquement, un McDo toujours ouvert qui « vend toujours des tas de graisse ». Après ? sans doute après un déluge, après une destruction d’une partie de la planète : ici des vieillards noyés, là une fille noyée elle aussi, « la tête dans la boue ».
C’est un monde où triomphe le « marché ». Partout, les lieux voués à des activités culturelles, à la création, à la connaissance sont « noircis et criblés de balles », partout le sol est creusé pour des bâtiments à l’assaut du ciel à côté de terrains vagues emplis de déchets. À Berlin, des quartiers sont rénovés après la réunification, c’est simplement que « le nouvel ordre démantèle l’ancien » ; mais ce nouvel ordre n’empêche pas le monde dans son ensemble de se désagréger, ce ne sont partout que malades à cause d’une nourriture inadaptée ou de la pollution, de la drogue, et partout des « décombres moisis », des terrains abandonnés. Du haut du ciel, la terre semble n’être qu’un tapis usé, terne. Le bonheur existe, puisqu’il est promis sur une affiche...—mais ce qui semble venir, c’est l’Apocalypse.
Rien ne semble échapper pour Rosanna Warren à la violence et à la destruction. Même les arbres ont perdu les caractéristiques qui en font des arbres, restent des « cyprès squelettiques », des « fantômes de pins », et l’on ne voit que le « chaos du ciel », on ne longe qu’une « rivière massive et crasse », le vent arrache tout : réponse à l’« ouragan de misères » dans la ville où l’on aurait voulu trouver l’art. C’est peut-être dans la relation à celui (celle) avec qui on partage les jours qu’est vécu un peu de liberté ; à la question « tranchante comme une lame » : « Tu m’as dit la vérité ? », question posée un jour de neige, un jour de lumière laiteuse, la réponse est « non ».
D’autres moments loin du désastre de la vie ont été vécus, mais ils sont éloignés : dans l’enfance, il était possible de croire qu’on ne deviendrait pas adulte ; on apprenait Pétrarque et on le récitait, on imagine devenir soi par la création, par l’amour, en donnant naissance, en accompagnant un mourant puisque tout se résout dans le cimetière : alors « les ennemis font la paix ». Des allusions à Krishna, à la perte d’un rapport au divin (« avons-nous perdu le ciel, les yeux fixés au sol ? ») laissent ouverte dans le livre une voie spirituelle, sinon religieuse, mais sont aussi fréquents les renvois à la musique (Liszt), à la littérature (Hölderlin, Schiller, Pétrarque) et à la peinture, même si dans les tranches de vie des toiles de Bonnard « l’âme reste sombre ».
Les œuvres humaines représentent le vivant, tout comme le poisson découpé dont le cœur continue de battre, métaphore de la vie qui s’obstine. Il y a dans la nature vue par Rosanna Warren une humanisation constante, image peut-être d’un espoir de renouvellement indéfini du vivant : les courants « luttent », on découvre « la ceinture du dégel », les « cuisses luisantes » des blocs de glace, etc. Le lien entre l’humain et la nature s’opère aussi fortement la nuit, lors d’une éclipse ; si la lune à ce moment paraît « avalée » par les gratte-ciels, elle est présente par ce qui est alors visible de sa couleur, « traces menstruelles », aussi vives que « des bouts de poèmes » qu’on donnerait à lire sur un mur.
Lisant ce choix de textes, on souhaiterait voir traduit un livre entier. Pour l’heure on appréciera le choix des dessins de Peter H. Begley : limités à quelques lignes sereines, ils sont une balance au monde souvent sans assise des poèmes.
Rosanna Warren, De notre vivant, traduction (américain) Aude Pinin, dessins P. H. Begley, Æncrages & CO, 2019, np, 21 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 6 janvier 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rosanna warren, de notre vivant, aude pinyin, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/01/2020
Ariel Spiegler, Jardinier : recension
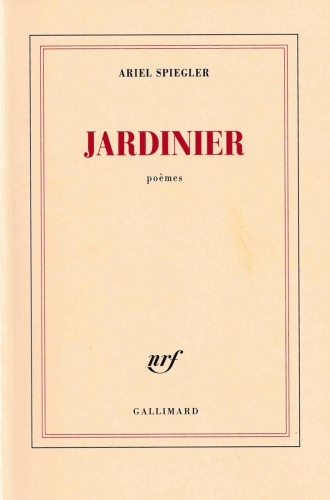
Voici un livre de poèmes qui rompt avec les thématiques dominantes aujourd’hui ; il n’abandonne pas la forme devenue classique du vers libre, mais il se développe autour de deux passions perçues comme inconciliables — voir Thérèse d’Avila — l’amour du divin et l’amour de la chair. Le titre évoque bien un lien à la nature, en l’occurrence il s’agit du jardin où a lieu la résurrection du Christ : "jardinier" renvoie à la méprise de Marie-Madeleine qui, trouvant le tombeau vide, s’adresse à un homme — Jésus — qu’elle prend pour un jardinier, voulant savoir où a été transporté le corps crucifié. La citation en épigraphe, « il nous viendra comme la pluie », extraite du Livre d’Osée, un prophète de la Bible hébraïque, est en relation directe avec l’existence de Jésus quand on lit son contexte :
(1) Connaissons, cherchons à connaître l’Éternel ;
sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie,
comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
(6.3, traduction Louis Segond, 1874)
Il faut ajouter que l’amour d’Osée pour son épouse Gomer (qui avait été une prostituée) est aussi inconditionnel que son amour de Dieu, thématique qui n’est pas étrangère aux poèmes d’Ariel Spiegler : la passion pour le divin et celle pour l’homme se mêlent au point qu’on ne peut toujours établir un partage entre elles. Le premier ensemble, le plus long (23 poèmes) est majoritairement occupé par la quête du Christ, comme le troisième, le quatrième et le dernier (11, 5 et 12 poèmes), le cinquième est consacré à l’amour humain (5) alors que le second est partagé entre les deux.
Les poèmes de Jardinier ont souvent un caractère sibyllin, l’alternance du "je" et du "tu" ne représentant pas toujours des sujets définissables, l’un et l’autre pouvant parfois renvoyer au divin ou à l’humain et, à deux reprises, l’introduction de "Ariel" désoriente la lecture. Il semble que le va et vient entre les deux instances est la trace d’un débat intérieur, d’un mouvement de doute et d’espérance, d’hésitation et d’élan, l’objet même de la recherche étant d’abord difficile à cerner ; « tu ne sais pas (...) ce que tu cherches » a pour réponse, plus avant, « Je sais où aller », sans que le pronom "tu" ici renvoie clairement à tel ou tel sujet, "tu" pouvant devenir "je". Celle désignée par « petite » par le personnage divin — ou dans le dialogue intérieur — entend « l’appel d’un homme incompréhensible / à le suivre tambourine » ; cet inconnu n’est jamais nommé mais sa figure se dessine par ce que les évangiles rapportent de ses actions et paroles. Ainsi, « il a vaincu le monde » reprend le « j’ai vaincu le monde » du Christ (Jean, 16.38), « le souffle devant qui tomber à genoux » — se souvenir que esprit a pour origine le latin spiritus, "souffle" — fait penser à la Lettre de Paul aux Éphésiens, « je tombe à genoux devant le Père » (traduction Ernest Renan), etc. Les allusions à l’action du Christ parsèment les poèmes, comme « renverser les tables » — les tables des marchands du Temple (Jean, 2.15) ou « reviens sur un petit âne » (Marc, 11.7), ou encore l’allusion au moment de la crucifixion (« ce qui a pu arriver un jour d’avril »). Le lecteur reconnaîtra le vocabulaire du christianisme, parfois la parole mystique avec la récurrence du mot "lumière" : « ses paroles commencent / par la lumière », « j’ai senti sa lumière », etc., et, dans le dernier ensemble du livre est dite la fusion désirée avec le divin, « Soulève-moi jusqu’à ta face / (...) disperse-moi dans ta lumière ». On relève encore « colombe », pour parler de la "petite", l’oiseau symbolisant la recherche de Dieu, « grâce », « feu », etc. Ces éléments sont d’autant plus remarquables que des formes analogues apparaissent à propos de l’amour humain.
Si l’on revient à l’épigraphe initial, le sauveur est attaché au printemps, à une nouvelle naissance ; l’arrivée de l’amant emporte aussi loin du monde quotidien mais dans un autre temps, « De loin, dans l’hiver, il est venu à moi, / une veste de moto sur les épaules, et le royaume. » Royaume cette fois de la chair, sans ambiguïté, l’union des corps étant aussi totale que celle d’une autre nature avec le divin — « je me suis mélangée à son corps —, sans pourtant que la présence divine, sous la forme de la mère-vierge, soit abandonnée : dans l’étreinte, « Marie sur sa médaille est entrée / mille fois dans ma bouche et m’a bénie ». La relation amoureuse aboutit elle aussi à abolir le temps (« Délivre-moi du futur ») et à connaître un paradis autre que celui promis par le divin, « Tu as fait de ma vie un jardin ». Le contexte de la rencontre, c’est celui d’un espace qui contient, par le biais de l’extrême variété des couleurs, toutes les formes vivantes possibles, cette diversité étant lisible également dans la beauté du corps féminin :
(...) Et qui l’attend ma cuisse pêche aurore
thé. Quand il la touche framboise
dragée bonbon la chair.
L’éloge du corps, de la chair est-il contraire à la parole divine qui, s’adressant à la "petite", oppose l’amour de Dieu, « irrémédiable », c’est-à-dire que rien ne peut changer, à la passion humaine : « Je suis le désir (...) le seul » et « À toi les multiples », en précisant sur ce point : « Tu sais (...) tourner autour de l’odeur d’un homme / de la saveur de son sperme ».
Y a-t-il opposition irréductible entre le divin et l’humain ? Le dernier ensemble du livre laisse entendre que les deux peuvent coexister, même si l’élan vers le Christ semble parfois dominant. Les poèmes sont ici majoritairement liés à la lumière et à l’eau, par exemple avec l’allusion au baptême de Jésus par « son cousin » (« l’eau de l’attente sur les cheveux »), avec le début d’une chanson de Guy Béart, "L’eau vive", l’eau vive étant le symbole de la purification, avec les derniers mots du livre, « Donne-moi à boire », mots de Jésus à la Samaritaine près d’un puits. Il n’y a aucune hésitation, avec le retour de la question à propos du Christ, « Qui est cet homme en sandales (...) ? », suivi aussitôt de l’écho à l’épigraphe d’ouverture, « Qui est cet homme venu sur la terre / comme une rosée par terre ? ». L’ordre terrestre n’est pas absent, avec le souvenir avant le poème final du pays de l’enfance, des danses (et non des prières) pour appeler la pluie fécondante, de l’herbe odorante, d’un chanteuse brésilienne populaire, Elis Regina (1948-1982) et d’un « chagrin d’enfant / confié aux coquillages ».
Dans Jardinier, des tensions se vivent entre le spirituel et le charnel sans que l’un l’emporte sur l’autre ; la "petite" affirme bien « Je suis ton esclave éperdue », donc folle d’amour, mais ces mots sont prononcés dans un contexte ambigu ; d’une part, ils semblent répondre au poème précédent (« Il m’a dit : « N’aie pas peur de mourir / je suis là »), d’autre part, ils sont suivis de propos sur « l’orchestre de la vie », sur le « vent [qui] danse haut dans les feuilles ». Les deux passions sont vécues, entières, sans conflit, au moins dans l’écriture.
Ariel Spiegler, Jardinier, Gallimard, 2019, 104 p., 11, 50 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 15 décembre 2019.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariel spiegler, jardinier, recension, passion. | ![]() Facebook |
Facebook |





