09/02/2026
L'Ours Blanc, automne 2025

Georges Perec, installé au café de la Marie, place Saint-Sulpice à Paris, relève « ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages », ce qui aboutit à Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (1975). Gilles Furtwängler procède de façon analogue, principalement avec des énoncés oraux de nature très diverse, de langue française ou anglaise, et ajoute quelques énoncés écrits. On peut soupçonner des inventions de l’auteur, l’ensemble réunit cependant des énoncés que chacun a pu ou aurait pu entendre ; sans en faire une étude que proposerait un sociologue, le lecteur reconnaîtra quelques traces de comportements qui ne donnent pas une image enthousiasmante de la société contemporaine — parfois, mieux vaut en rire.
Plusieurs groupements recueillent des énoncés très disparates, on sait que ce que l’on écoute dans une journée n’a évidemment aucune cohérence, que l’on se déplace ou non dans plusieurs lieux ; le vide de la plupart des notations hors contexte provoque le rire ou (et) laisse penser que les préoccupations des humains sont d’une grande futilité. Par exemple :
(…) Ma couille*, dans une autre vie, j’étais une bouteille en plastique. Dans la prochaine vie, je ne sais pas, une fausse dent ou un fer à béton. Petits sauts. Graines de tournesol dans la poche. Cheveux coupés sur la place. Dédicace. 6.8 pouces. 6.1 pouces. Ergonomie. Dream big. Dignité, non.
Certains énoncés ne peuvent être interprétés que comme une critique de la société contemporaine où les valeurs classiques sont abandonnées : le travail ne viserait pas à l’utile mais à produire n’importe quoi, le seul but étant de vendre ce n’importe quoi. La langue elle-même se plie aux exigences de la simplification, et il y a une exaltation du « propre », rien ne doit dépasser, se distinguer d’une norme jamais énoncée :
J’aimais que tout soit propre comme nos verrines, notre famille et la rue. Réduire. Actif. Asap [= as soon as possible]. Passif. S’adapter. S’affoler. Win-win [= gagnant-gagnant]. Zéro défaut. Produire du néant pour vendre du néant. Atout plus plus. Future is an attitude.
Une série de questions sans lien entre elles suscite le besoin de construire un texte homogène ; La continuité est absente, mais l’alternance du singulier et du pluriel (il, ils) facilite l’essai de mettre en place un récit, alors même que les phrases ont pu être notées des jours différents — ce qui peut entraîner des réflexions à propos de ce que nécessite un récit.
(…) Est-ce qu’ils avaient l’air jeune ? Est-ce qu’il avait un linge sur la tête ? Est-ce qu’ils ont dit Peace ou au moins merci ? Est-ce qu’ils roulaient lentement ? Est-ce qu’ils ont provoqué tes chiens ? Est-ce qu’il avait l’air d’être sobre ? (etc.)
Une autre série, qui rassemble plutôt des textes écrits, rend compte longuement de ce qui est un inquiétant fait de société, l’assassinat de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint ; on sait que le nombre de féminicides ne décroît quasiment pas d’une année à l’autre et il est bon que les relevés de conversations ou d’articles de journaux soient nombreux.
(…) Tuée à coups de barre de fer par son mari. Volontairement percutée par le véhicule conduit par son conjoint. Découverte dans une mare de sang. Décapitée. 22 ans. Frappée à mort à l’aide d’une chaise par son compagnon, il est avéré que sa fille de 7 ans a assisté au meurtre. Violée avant d’être assassinée. (etc.)
Chacun tirera une leçon de l’amas de banalités qui font l’essentiel des conversations, celles que l’on saisit au vol et les nôtres. Le petit livre de Gilles Furtwängler peut faire comprendre que l’on énonce souvent des sottises, sans pour autant être un "beauf" ; il peut aussi suggérer de poursuivre les relevés dans notre environnement pour de nouvelles « voix de velours ».
* Appellation familière en s’adressant à un homme ou une femme.
L’Ours Blanc, Héros-Limite, automne 2025
n° 45, 32 p., 6 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 15 décembre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'ours blanc, automne 2025, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2025
Laura Tirandaz, J'étais dans la foule : recension

Être dans la foule — « J’étais dans la foule » revient trois fois dans le livre — c’est à la fois être au plus près des "autres" et, en même temps, vivre la solitude, « Solitude aiguisée de qui passe à portée de main ». La narratrice se trouve dans ce lieu provisoire par nature, qui apparaît à la fois « Dédale piège refuge » ; La foule réunit ici des hommes et des femmes qui semblent manifester contre un pouvoir violent ; la narratrice rapporte : « Je passe / un homme glisse une insulte, insulte répétée plus avant, et la mort est présente, « on continue on continue / on s’est mis à ramper / à jeter des poignées de sable pour cacher le sang ». Images de répression collective qui s’exaspèrent quand les femmes sont objet de violence :
Je marchais et me souvenais
des femmes traînées par les cheveux jusqu’au cœur de la ville
l’été écrasé sous les bottes
Le pouvoir tue pour terroriser, choisissant ses victimes, « ce matin deux exécutions », et presque aussitôt « ce matin — une exécution », et les notations ne laissent aucun doute sur la volonté de faire taire toute opposition (« le sang ouvrier », « Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes », etc.). Une des plus tragiques restitutions de la violence mêle les gestes quotidiens à ceux d’une exécution, dont la banalité est ainsi mise en valeur : « Ce que je me suis forcée à finir / la phrase / l’assiette / et sa tombe — je devrais y aller / Il a tourné le dos face au mur ». Cependant, « Plus il y a d’ennemis / plus il y a d’amis » et, dans l’avant-dernier poème, « J’attends la foule / Derrière le paravent / les ombres respirent toujours la même fleur ».
Les citations précédentes pourraient laisser croire que le long poème qu’est J’étais dans la foule est un récit concernant ce qui se passe en Iran, le nom de l’auteure étant transparent ; elles sont relevées et rassemblées parce qu’il y a bien une visée politique dans ces poèmes que l’on met en exergue. Mais autre chose, qui déborde la terrible actualité. Et d’abord une perception de la foule en même temps restituée et devenant objet d’imagination : « (…) Des phrases, des coups de rame / Les corps glissent / Les visages se superposent / Il pleut » ; on lira plusieurs fois ce genre de passage où le réel semble, mais semble seulement, mis à distance et perçu alors avec plus de force. Le dernier vers du poème s’achève d’ailleurs sur une de ces notations qui introduisent un effet de réel, « Des mouches sur mon rouge à lèvres ».
Écrire ce qu’est la foule n’implique pas une description comme on peut en lire chez Zola ou Hugo (la foule comme une mer, une marée). La narratrice regarde et le texte se divise, les éléments vus tous différents, juxtaposés, sans que le chaos du monde soit organisé : tout le contraire d’une description, ce qui donne au lecteur le sentiment d’être aussi devant un désordre impossible à réduire. D’autres séries sont limitées à une suite de mots et tout se mêle, choses vues, bruits, textes lus, toujours pour donner du réel une perception différente : « Les insectes les rumeurs les alarmes / les comptines où l’animal trouve refuge ». La foule est aussi un lieu sonore, dans l’immense confusion des bruits se détache parfois brusquement, la nuit, une voix qui dit, pense-t-on, sa souffrance, « Une femme criait / Qu’on m’emporte / Qu’on m’emporte ». Quand la narratrice écoute une personne, ici un adolescent, dont les mots sont tout autant inorganisés que les paroles saisies dans la foule, « (il) te parle des nuits d’alcool en famille / du silence dans la cuisine / de l’épaisseur de l’air et du velours des voix âpres, rares », ce qui est plus réel qu’une restitution d’une prétendue oralité.
La narratrice n’est pas seule, sans que les personnages introduits soient mieux définis qu’elle. La double injonction qui ouvre le livre — « Abandonne la route », puis « Reviens vite » — peut s’adresser à un lecteur imaginé comme au "vous" de ce début ou au "tu" qui entre dans l’histoire à différents moments ; d’autres pronoms apparaissent, un « nous » et un « ils », qui peuvent renvoyer à des figures diverses : il y a assez régulièrement dans J’étais dans la foule des traces d’un ailleurs, d’un dehors qu’on peut bien appeler le réel. Le seul pronom récurrent, "tu" ("te") joue avec le "je", mais il n’est pas certain, et le lecteur ne le saura pas avec certitude (heureusement !), que le couple formé par le je-tu soit toujours le même. Il y a l’idée d’une fusion totale, mais qui ne peut être qu’imaginée, « qui envahissait le rêve de l’autre ? / Nous avons la même insomnie / la même honte ». Il est fait état une brève conversation entre je et tu et, plus longuement, de la fin d’une relation, mais avec un passage brutal de je à elle : le poème commence par « j’écrirai un jour le récit d’un amour qui s’achève » et se poursuit par « (…) Elle lui tient la main, penche la tête / Lentement elle le massacre ».
On voudrait relever tous les entrelacs d’un poème qui, rappelant régulièrement le contexte, des moments de vie en Iran aujourd’hui, s’échappe des circonstances et, constamment, offre une lecture passionnée du réel, en refusant de présenter une image ordonnée de la violence, du chaos où chacun, qu’il le veuille ou non, vit sa vie, même éloigné des tueries contemporaines ou de la crainte de « tomber dans le vide » — ce sont les derniers mots de ce très beau poème.
Laura Tirandaz, J’étais dans la foule, Héros-Limite, 2025, 72 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 28 octobre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2025
Bruno Fern, des tours, suivi de Lignes : recension
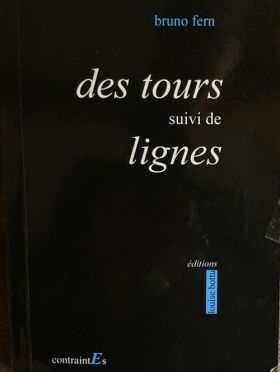
On peut écrire en « vers libres » pour faire part de ses amours ou de son désespoir de vivre, plus prosaïquement de ce qui se passe dans sa vie, et cela finit par devenir un livre de "poèmes" ; chacun en trouvera chez son libraire un grand choix. Autre chose est d’écrire en prenant la langue comme matériau, en s’imposant des contraintes formelles ou en les réinventant — le sonnet, par exemple, est toujours vivant sans être toujours selon les règles du sonnet de Ronsard. À l’intérieur du cadre que l’on a choisi, ou construit, d’autres contraintes s’imposeront. Bruno Fern invente une contrainte, très littéraire, dans chaque partie du recueil, à partir de laquelle d’autres jeux rhétoriques se développent.
La règle dans des tours, qu’on lit aussi immédiatement "détours", titrée heureusement « Fabrique », est énoncée avant le premier poème et reprise en quatrième de couverture :
Chaque poème est issu d’un texte dont l’origine est indiquée. Un extrait y a été prélevé puis scindé en deux parties : la première est placée à la fin du poème et la seconde au début. Entre ces extrémités figure un écho plus ou moins lointain au texte original, comme les images dans les glaces déformantes d’une fête foraine.
L’allusion à la fête foraine n’est pas de hasard ; populaire par excellence, elle est une parenthèse dans le quotidien — même évidemment si elle appartient à la vie sociale ; ce qu’on y fait n‘a pas de conséquences : on tire sur des leurres, on tamponne des autos qui repartent, etc., donc tout est vrai (on a une carabine) et tout est faux (personne ne meurt).
Le premier poème part du début de la première des Élégies de Duino, dans les traductions les plus courantes, « Qui donc, si je criais ». La "fabrique" retient d’abord le cri dans sa matérialité (des sons), puis comme manifestation d’un trouble (« plainte »), écho au poème de Rilke, mais aussitôt « plainte » est entendu comme terme de droit ("plainte contre X"), ce qui autorise l’introduction de l’emprunt :
donc si je criais il en sortirait quoi d’arti
culé — au minimum un son, ça
c’est sûr, mais pas forcément une plainte
déposée par les voisins
ou l’on ne sait trop qui
La fabrique, ici, joue sur la polysémie et, avec le rejet du vers 2 (« culé »), introduit un vocabulaire familier, une des constantes ensuite dans le recueil.
Dans un poème construit à partir du treizième vers (« De rudesse envers moi, je veux tes mains baiser »), d’un sonnet d’Étienne Jodelle, des mots sont repris (« endurer », « meilleur ») ou légèrement transformés (« tendrelette » devient « tendre »), mais les gestes de l’amour ne sont plus ceux policés du poème, à ce qui n’est que suggéré dans le vers 14, « Si un baiser meilleur au moins ne te vient plaire », correspond crument ce que la Renaissance ne publiait que sous le manteau : « je veux tes mains baiser ta fente et ton anneau ». Bruno Fern introduit aussi des paronymes, en les liant avec « & », plutôt courant au XVIe siècle même si absent de ce sonnet, et en signalant leur présence : « avant que tous deux liés en corsage & en cor / dage — c’est le jeu qui veut ça ». Le jeu sur « corps », « sage » et « [d’] age » s’accorde avec les sonnets de Jodelle.
On appréciera ces "détours" parfois complexes, joués à partir de poèmes d’Apollinaire, Baudelaire, Villon, Zanzotto, Saint-Amant, etc., avant de suivre l’exercice d’une autre règle. Elle est énoncée dans une note à font 5 de E. E. Cummings : « Comment obtenir le mouvement en divisant les mots, c-à-d en composant par syllabe ? » (traduction Jacques Demarcq). Les phrases de départ sont, là encore, choisis dans des textes littéraires — on pouvait prendre des modes d’emploi ou des publicités, etc. — d’Apollinaire encore, de Christian Prigent, Malherbe, etc. Certaines « lignes », commencent à partir d’un fragment (Tristan Tzara, « Et si je m’égare c’est que je ») :
ET
si étêté je pique encore excusez-moi un sprint
et intègrent en cours de route une autre citation, ici, vers 2, la partie en italique vient d’Andrea Zanzotto.
SI
si en as des cascades qui saute de strates en strates
Ce n’est plus la relation au texte de départ qui importe, plutôt la construction de brefs récits en jouant sur la prononciation, par exemple, pour défaire l’attente du lecteur (qui s’arrête) ainsi, dans « je m’égare », la syllabe « m’é » devient « mes » et cette transformation est commentée : (…) je suis / M’É /propre pas, je m’épate moi-même mais / GARE / à ne pas se gargariser de haut langage.
La « ligne » prise dans le Sonnet en X de Mallarmé, « Aboli bibelot d’inanité sonore » suscite de multiples transformations analogues (« LI / tes râlements », au / BE / au milieu », etc.) et la répétition de la syllabe initiale : pLIés, Lisant, Lit, pâLIr, L’Identité, Lisible, Livide, reLIer, Lie.
On ne boudera pas le plaisir de retrouver un vers de Villon ou de Queneau (autre travailleur expert de la langue) point de départ des modifications que lui impose Bruno Fern. Ajoutons qu’au "détour" d’un jeu sur une syllabe il multiplie des allusions littéraires ; toujours avec le vers de Mallarmé, on reconnaîtra un (presque) fragment de vers de Nerval, « TÉ / nébreux consolable ».
Bruno Fern, Des tours suivi de lignes, Louisse Bottu, 2025, 96 p., 10 €.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, des tours, suivi de lignes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2025
Julia Peker, Marelle : recension

« démêler les ombres »
Jusqu’à une époque récente les enfants blessés dans leur vie et éprouvant les plus grandes difficultés à se construire, finissaient le plus souvent, devenus adultes, à la dérive ; l’aide extérieure nécessaire pour les aider, relativement récente, en sauve une partie du désespoir de vivre. Julia Peker, psychologue clinicienne, reçoit ces enfants et adolescents, garçons et filles, que la vie a commencé très tôt à détruire. Ses poèmes ne sont pas des comptes rendus de séances, ils ont été écrits à partir de soins faits d’écoute et d’échange, aussi l’expression « poèmes cliniques » de l’auteure pour les définir paraît-elle inadéquate : ils n’ont pas vocation à être lus par ceux et celles qu’elle a accompagnés dans leur détresse, mais par des lecteurs de poésie. Ces poèmes, en strophes de quelques vers brefs, rarement plus de vingt, restituent, en belle page, le "portrait" d’une rencontre qu’un titre, page de gauche, tente de présenter.
Marelle est aussi le titre d’un poème qui met crûment en lumière, la quasi-impossibilité d’un enfant cabossé de s’adapter à certaines pratiques sociales, ici à un jeu qui, en principe, n’est pas solitaire, courant dans les cours de récréation autrefois. Après avoir tracé sur le sol le dessin d’une marelle, l’enfant ne parvient pas à sauter, sans doute par crainte d’échouer ; preuve d’un rapport au monde, difficile ou peut-être impossible, qui apparaît avec force au lecteur. Souvent, les titres des poèmes sont éloquents : le saut, SOS, Noir, le cri, mutique, survivre à la nuit, la langue de personne, etc.
On devine que des drames familiaux, des violences, le décès d’un proche ou (et) l’absence des plus simples sentiments d’affection ont été à l’origine des troubles profonds que la psychologue tente de comprendre pour chercher avec l’enfant à les réduire. Mais il est rare que quoi que ce soit s’exprime à ce sujet. Souvent l’enfant reste muet, se ferme, parle d’autre chose, parfois quitte la pièce en refusant la main tendue, ce que traduit, parmi d’autres, une strophe :
tes mots ont pris le pli
s’avancent sur des lignes parallèles
pour ne jamais croiser
ce qui pourrait remonter du dedans
ne rien déterrer de tes nuits
ne rien voir de ce qui s’écroule
quand tu cherches à tenir
Quelle que soit la qualité de son écoute, l’adulte se retrouve régulièrement devant un enfant qui garde « un secret/défendu par la peur ». "Peur" est un des mots récurrents, marque du malaise d’exister, d’être là : c’est « la peur d’être vu », c’est « la peur [qui] secoue sans bruit [l]es épaules », c’est la peur de dire ce qui provoque la peur. Alors la voix « trébuche » de ne pouvoir dire, de ne pouvoir sortir d’un « labyrinthe à sens unique », et si l’on s’extrait du dédale c’est pour rester devant des « portes closes » : personne n’attend personne à la sortie.
La rencontre avec l’enfant ou l’adolescente(e) s’organise pour l’essentiel à partir de ses gestes, de ce qu’il peut dire et non de questions ; parfois, des mots mal acceptés parce qu’ils viennent de l’adulte — de l’autre —, provoquent le refus, interrompent toute possibilité d’échange, l’enfant s’absente ou se retire de la pièce, « le moindre mot/le moindre geste/et tout explose ». À l’inverse, le refus de la proximité peut se manifester par un flot de mots qui, d’une autre manière que le silence, éloigne la parole amie en face de soi, alors « les mots s’empilent/sans vraiment s’enchaîner ». Ce n’est pas dire que toute tentative d’approche échoue, que la psychologue ne peut rien faire ; même quand l’enfant se vit « seul contre tous », il essaie toujours de ne pas rompre avec ce "tous" et c’est par le regard qu’il accepte une aide, ce que relève l’auteure, « pour ne pas sombrer/ dans un gouffre sans fond/tu te contentes/ de croiser mon regard ». Le regard est, souvent, la voie d’où part une sorte de dialogue et, aussi, celle qui le bloque — on lit , parmi d’autres exemples, « ton regard se retire », « tes yeux sans regard s’enroulent en dedans ».
Même quand les mots s’échangent, ils ne font pas disparaître une tristesse, une douleur, des manques, la hantise de la perte, le sentiment que « les couleurs de la vie / [sont] introuvables ». Comment évacuer « les gravats de l’enfance » ? comment restituer sa plénitude à des « corps en morceaux », à une « unité morcelée » ? comment cette « plage secrète / délivrée des cris et du temps » à laquelle tous ces êtres blessés aspirent ? On sait que toute cette misère, depuis toujours, naît et se développe parce que la société ne se soucie pas, ou très peu, de la difficulté à se vivre, parce que les uns et les autres ignorent cette souffrance. Pourtant, elle est souvent proche et Julia Peker dit justement « mais que verrions-nous/sans tes questions qui font tourner le monde ? »
Le commentaire de sitaudis.fr
Julia Peker, Marelle. Dessins d’Edna Lindenbaur. Préface de Jean-Louis Giovannoni. L’Atelier contemporain. 176 p.. 25 €. Cetterecension a été publiée par Sitaudis le 18 janvier, 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia peker, marelle, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2024
Étienne Faure, Séries parisiennes : recension
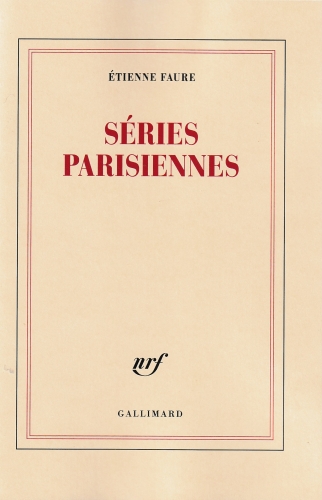
On pourrait rêver de réunir les poèmes, vers et proses, écrits à propos de Paris entre 1900 et aujourd’hui, on aurait sans doute le sentiment qu’il existe plusieurs villes du même nom dans le même lieu, d’Apollinaire à Réda, de Léon-Paul Fargue à Roubaud. Séries parisiennesentrerait aisément dans cet ensemble, on y entend la voix particulière d’Étienne Faure, sa manière de vivre la langue qui invente "son" Paris, on y reconnaît des motifs présents depuis ses premiers livres, on y retrouve une forte attention à la composition et à l’unité d’un ensemble.
Séries parisiennes est composé de 16 ensembles, tous titrés "Côté + nom" : "Côté Seine", "Côté rue" pour les premiers, "Côté voix", "Côté H" pour les derniers. "Côté cage" (la cage de l’ascenseur d’un immeuble) rassemble « Dix-sept haïkus dans l’ascenseur » de construction syllabique régulière (5-7-5) ; tous les autres groupes comptent 6 vers ou proses, sauf "Côté mains" avec 12 quintils — donc 15 groupes de 6 vers à quoi s’ajoutent 6x2, soit à nouveau 17. Jeu des nombres et la thématique hors la cage est présente dans les haïkus : le baiser, les oiseaux, les voix, les écrivains (avec Balzac), etc. Les figures sont limitées à quelques paronomases, « les remous/les rumeurs », « intemporelles/intempéries », « se carapatent/Carpates » ; l’emploi du vocabulaire noté familier ou argotique par les dictionnaires, très rare chez Étienne Faure, est présent ici peut-être pour mieux marquer le caractère urbain de l’ensemble (zef, se tirer, (d’une femme) la mieux roulée, piaule).
La phrase des poèmes se développe le plus souvent à partir d’un mot ou d’un thème ; elle peut s’ouvrir avec deux mots repris à la sortie en ordre inverse avec changement de genre, (nom/ adjectif, « le vert et le noir »/« paysage noir et vert tendre »). Dans la prose d’ouverture, le lecteur passe de fenêtre à spectacle, manteau d’arlequin, théâtre, scène de genre, acte un, acteurs, jeu, chandelle (pour évoquer le théâtre ancien). Ces reprises sont un des moyens pour construire des poèmes, en prose ou en vers, d’un seul tenant, l’unité pouvant aussi être obtenue par l’emploi d’un ensemble homogène de couleurs : dans le second poème du recueil pour caractériser la saleté de la Seine, « vert trouble », « or gris sale », « eau rouille », couleurs opposées au bleu outremer, à l’azur. L’aspect trouble de l’eau n’empêche pas son mouvement, symbole habituel du « temps qui coule », comme l’eau « passe et file » vers la mer.
Le ton est donné, on ne découvrira pas un Paris insolite, pas plus que ses monuments ; rien d’autre à voir que le quotidien, ce qu’offrent la rue, les bancs, les allées du cimetière, les parcs, quelques personnages résolument à l’écart de la société, « (ces) vieux Rimbaud qui marchent ». Rien que le quotidien et s’attacher à ce qui échappe souvent au regard alors qu’il suffit de lever la tête, suivant en cela le Baudelaire des fenêtres : « Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. » Le piéton des Scènes parisiennes observe ce qui semble être une « scène de théâtre », reconstitue ou invente « Tout un fracas de vies intérieures », engrange un matériau offert à qui veut le voir tout comme il saisit au cours de ses marches des phrases, des fragments de récits. L’observation des habitués des bancs, dans les parcs, est différente. Immobiles et souvent silencieux, ils semblent « à l’écart du temps qui passe », dans un autre univers, celui des souvenirs.
Le narrateur sans cesse imagine des vies, également des scènes amoureuses où le couple, bien que dans la chambre, semble hors du monde de la ville, comme s’il s’étreignait sur un « grabat de feuilles / de paille » et s’entend aussi un « froissement de litière » ; l’étreinte entraîne un vocabulaire connotant la nature et elle impliquait également une position des corps pour rappeler la dyade Éros-Thanatos : devenus des « gisants » et « leur mort est à son comble ». Il reconstitue aussi des ruptures (« pour avoir trop bu »), l’un partant « refaire sa vie », ou « attendant l’autre (elle ne vient pas) ». Tout peut être point de départ d’une fiction, voix et gestes glanés dans les rues suscitant de courtes pièces. Cette attitude de voyeur en quête de ressources est d’ailleurs dite dans un poème qui renvoie le lecteur « aux livres anciens » où un personnage observe une scène érotique par le trou d’une serrure avant de devenir lui-même acteur.
Les livres — les livres de poèmes — sont partout dans les Séries parisiennes. Un ensemble de poèmes est consacré à des écrivains qui, tous, ont été attentifs aux choses ordinaires de la vie ; ils sont nommés (Follain, Guillevic, Réda, Goffette, Vaché), ou reconnaissable par un détail, Stéfan par « litanies », « Judas », plus clairement par « stéfaniennes ». À côté de ces hommages, le lecteur collecte des citations, de ces auteurs et, dans les poèmes, de Rimbaud (« On ne part pas »), de Ronsard ("Mais ce mien corps enterré/s'il est d'un somme fermé/Ne sera plus rien que poudre »), fragment recopié par le narrateur qui le lit au Père Lachaise. Il repère une allusion probable à un titre d’Étienne Faure (Vues prenables, 2009) dans « Rêvent-ils (…) d’autres vues imprenables », ou il se souvient du Verlaine de Sagesse(« Le ciel est, par-dessus le toit ») avec « La mort est par-dessus les toits ».
La mort est présente pour le narrateur par le souvenir des disparus, proches ou non, par le souvenir de ce qu’ils furent ; ainsi la mère définitivement absente, « un beau vide », ou tous ceux devenus sans visage ; parfois, il se vit « rattrapé par le néant des aïeux sans racines, qui n’auront bientôt jamais existé ». À côté des drames personnels, l’Histoire est le temps pour tous de la mort ; le dernier ensemble, est titré « H » — initiales dans « Les Humbles champs d’Honneur de l’Histoire Humaine » — et plusieurs recueils d’Étienne Faure s’achèvent avec l’évocation de ce qui ne fait en rien honneur aux humains. La guerre était annoncée par les cloches et leur bruit peut encore l’évoquer, trace d’un autre temps, comme les couteaux des bouchers dans un abattoir ; pour le narrateur, c’est le grincement des roues, des freins d’un vélo qui appelle le souvenir des années 1940 et des rafles de juifs, l’envoi dans les camps d’extermination, ce sont aussi les déformations du corps à cause des privations qui restent les empreintes des années de guerre.
Les potences finissent par être « arrachées » et tous sont enfin « à l’air libre »… On sait bien que la poésie ne changera pas le cours des choses, qu’elle n’empêchera pas le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie (parmi d’autres plaies trop présentes) de prospérer ; cependant, qu’un ensemble à propos d’une perception très personnelle de Paris se termine en évoquant la peste brune, toujours vivante sous des formes plus ou moins avenantes, n’est pas indifférent.
Étienne Faure, Séries parisiennes, Gallimard, 2024, 156 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 19 juillet 2024.
Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, séries parisiennes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
12/05/2024
Edoardo Sanguineti, Codicille : recension

Des proses d’Edoardo Sanguineti (1930-2010) ont été traduites en français dans les années 1960 par Jean Thibaudeau, Capriccio italiano (1964) et Le noble jeu de l’oye (1969), mais il n’y eut aucune publication jusqu’en 2013 avec Corollaire, puis L’amour des trois oranges (2016) et Cahier de brouillon(2022), tous trois aux éditions NOUS. Aujourd’hui, nous lisons Codicille ; beaucoup de lecteurs pensent sans doute bien peu "poétique" ce titre ; un codicille, en effet, est un ajout à un testament sans, cependant, en modifier les dispositions principales. Sanguineti a publié le livre (Codicillo) en 1982, soit loin d’être à l’âge où l’on estime nécessaire de fixer ses "dernières volontés" ; c’est le prétexte pour, une fois de plus, déclarer son amour à l’épouse — « toi », jamais nommée mais toujours là, de dire aussi la vie de la cité, mais ce qui importe le plus, c’est son écriture.
Le livre s’ouvre avec la relation amoureuse — « mante aimée » — mais imaginée sans vive activité, elle comme lui perdant ses dents, l’un et l’autre âgés, donc malgré la présence de la chambre peu aptes à être, elle, une mante amante, lui se décrivant plus avant comme « muet, cocu, assis, débile, immobile ». Le discours amoureux peut-il être toujours reçu ? Il s’agit surtout de mots écrits et, une fois qu’ils sont lus, le papier peut servir à jouer : on le plie de diverses manières pour fabriquer un bateau, un chapeau, un avion, etc., et le discours disparaît. Tout serait, ainsi, toujours à recommencer, le couple n’étant vivant qu’à être sans cesse construit pour exister et cette nécessité est répétée à tous moments sous des formes explicites : « je te demande ta main », « je te séduis trois fois », « je suis à la recherche d’un habitat : de toi », « je sors de mon rêve de toi (de moi) ». Quand les aléas du quotidien sont déplaisants — des chaussures trop étroites, par exemple, qu’on ne peut changer — la vision de soi devient négative, « je suis moins sexuel, moins sexué et sexualisable ». À l’inverse, libre cours à l’imagination quand rien ne s’y oppose ; il suffit d’inventer une situation favorable pour, dans le discours, (re)connaître son corps et le corps de l’autre dans l’échange amoureux. Composer un numéro de téléphone au hasard libère la parole et les possibilités dans l’imaginaire, toutes propositions pouvant être faites, « puis je dis : prends-la, serre-la, secoue-la ; et je dis : je te la mets (ou tu te la mets) : et je dis : et je te l’enfile : ça dépend de la voix que je prends : [etc.] ».
On comprend que la passion pour l’aimée si régulièrement exprimée passe, d’abord, par des mots pour mimer un discours lyrique — mais pourrait-il être autre chose ? Sanguineti assure que non quand il revient sur leur vie, « ton bonheur fut mon devoir » ; cependant, lorsqu’il lui faut indiquer ce qu’il lui lègue, ce sont les biens sans intérêt, représentatifs de la société qu’il exècre, qui sont énumérés :
je n’ai plus de mots
mais par signes et clin d’œil (et
gros coups de coude, et très gros coups de pied dans
les tibias) […] je te remets le reçu d’un bracelet Black&white,
d’un porte-clé Yves Saint-Laurent (6 crochets), ainsi
que de la résurrection (de la cave à la cuisine) de la
gigantesque relique de ma pendule paternelle
Un humour politique parcourt le texte ; dans une comparaison. Sanguineti se présente dans la position de la prière, « puant comme un saint agenouillé » et, une autre fois, invité à l’Élysée avec d’autres intellectuels, il n’a parlé que de « classes sociales, lutte des classes, et caetera ». Plus constamment, c’est par le refus de la logique propre au récit qu’il montre le chaos du monde, dans des assertions telle : « je me souviens de mon futur comme d’un cauchemar : je ne sais pas prévoir mon passé ». À côté de ce renversement de l’ordre, on lira l’impossibilité de situer le lieu, le temps, et la manière d’aborder la question du "moi", et même de se poser cette question, « j’ai lu je ne sais où / je ne sais quand (et je ne sais comment et je ne sais à quel propos) ». L’impossibilité de dire pour être compris concerne toute chose et toute personne dont Sanguineti parle, y compris de son aimée ; des séries d’éléments disparates pointent un univers en folie : de la femme figurée par un carré le narrateur assaisonne « dément, en salade, [son] hypothétique hypoténuse, hypnotisée, diaphorétique éidétique ».
On voit par cet exemple que le texte se construit à partir d’une reprise de sons ; c’est une des constantes de Codicille et c’est souvent par la répétition de sons que le sens émerge, ce qui soulève le problème de la traduction, même si la proximité de l’italien et du français aplanit les difficultés. Un exemple parmi d’autres illustre la relation étroite son/sens :
non ti sto a dire lo scacco e lo smacco (e lo
scasso e lo scazzo, e lo sballo e lo svacco) che
mi voglio, ogni volta, cosi vivo […]
je te passe le saccage et le dommage (le forçage et la
rage et le vertige et le naufrage) qui me réveille, chaque
fois, si vivant.
Reprise de sons et, également, de situations, avec l’anecdote du chauffeur de taxi à Neufchâtel, puis à Bâle, Fribourg, Zurich, à Lausanne où cette fois, il s’agit d’une femme « s’intéressant à tout (ma non a me) ». Le français apparaît dans le texte italien, mais aussi l’allemand, l’anglais, le latin. Les séries de mots proches aboutissent régulièrement à donner l’idée d’un monde sans axe, sans avant ni après, puisque l’on peut écrire pour le dire avec des assonances et des allitérations : « (et je gâte les gâteaux) : (et je grille les grilles) : (et je barre la barbe) [etc.] » ; pour l’original : « (e casso la cassate) : (e cancello i cancelli) : (e biffo i baffi) : ». Une autre caractéristique de l’écriture, qui n’est pas propre à ce livre, est l’emploi constant des parenthèses et des deux points, qui organisent le rythme de la lecture, une phrase trouvant parfois sa résolution plusieurs lignes après son début, ou n’ayant pas de fin. Chaque poème s’achève par deux points, ce qui transforme l’ensemble en un seul poème ; quant au dernier poème, il ne compte que du texte entre parenthèses, des commentaires et explications sans appui, achevés aussi par deux points, ce qui laisse le livre ouvert.
Peut-on rêver que soit entreprise la traduction de l’œuvre poétique, du théâtre et des essais ? Il est curieux qu’un écrivain de la stature de Sanguineti soit resté un peu à l’écart de l’édition française. Pour l’instant, lisons cette traduction précise et élégante d’un texte tonique.
Edoardo Sanguineti, Codicille, Bilingue, traduction de l’italien Patrizia Atzei et Benoît Casas, NOUS, 2023, 72 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 mars 2024.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edoardo sanguineti, codicille, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/01/2024
Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne : recension
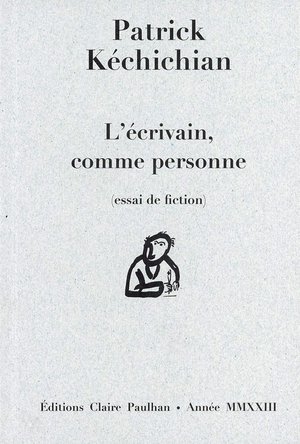
« Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais », ce refus de Maurice Blanchot, dans La Folie du jour, est un des quatre textes mis en épigraphe et repris dans l’un des trente chapitres de quelques pages du livre. Au cours de la lecture, on relève encore « on ne réécrit pas l’histoire, et pas davantage sa propre histoire ». De quoi donc s’agit-il ? non d’une autobiographie — on y reviendra — mais du parcours complexe qui aboutit à cet "Autre" qu’est l’écrivain. Pour autant que l’on puisse se dire « écrivain » : dans sa préface, Didier Cahen souligne l’ambiguïté du titre, comme si Patrick Kéchichian « jouait des mots pour dire deux choses en une ».
Le livre, l’écrit sont vécus comme fondateurs depuis l’enfance, comme si pour Patrick Kéchichian les premiers contacts avec l’extérieur étaient passés, d’abord, par les mots, ceux reçus, entendus et lus, tout autant ceux écrits pour essayer de transcrire — non de décrire quelque chose de ce qui s’éprouvait et, de cette manière, « découvrant le monde en se découvrant lui-même au bout de son crayon ». Expérience particulière de construction du "Je", cette certitude, ou illusion, que l’écriture, les mots ont faculté d’atteindre le vrai des choses, de soi. Ce qui conduit pendant un long temps à accumuler les pages, cahiers, feuilles volantes et, sans doute dès les premiers essais, à multiplier les énumérations pour cerner au plus près ce qui (sa propre vie, le monde) resterait sinon opaque, obscur. Tout ce qui fait les jours devrait donc être noté, les mots sur la page conférant aux instants les plus divers du vécu un supplément de réalité. Une citation, amputée de son début et de sa fin, éclaire sur la diversité des « fragments d’existence » que conservait Patrick Kéchichian :
(…) souvenirs dépareillés, rêves éveillés, ensommeillement et/ou insomnies, obsession du recensement de soi, drames et anecdotes, additions minutieuses ou multiplication de vétilles, inventaires dûment consignés des nostalgies et des regrets, troubles de l’esprit encourageant ceux du comportement, deuil prolongé, rires couverts de pleurs et inversement (…)
Cette liste partielle fait comprendre le caractère anarchique de ce qui est retenu et l’impossible approche du livre désiré, dont les mots auraient un peu restitué des « images de l’invisible et [des] figures, même approximatives, de l’existence ». Livre qui donnerait à lire la vie de quelqu’un, mais « étoffée et dramatisée par l’auguste geste d’écrire ». Feuilletant les nombreux "récits de vie", journaux, carnets édités ces dernières années, le lecteur sait bien qu’ils relèvent d’une imposture — Jude Stéfan avait très justement publié des bribes d’un journal (plus ou moins inventées) sous le titre Faux journal. C’est cette imposture qui arrête Patrick Kéchichian, « tout ce qui pouvait être narré, (…) rapporté, encensé, pensé, analysé, catalogué, comptabilisé trouvait, en marge du livre à venir (…) une possible expression ». "Livre à venir"1 donc, qui ne peut être écrit qu’en sortant de l’imposture, du désordre pour lui « opposer l’idée, la volonté, le projet, la recherche d’un ordre. »
Abandonner les facilités des notes d’un journal, "intime" ou non, ne peut se décider qu’après une prise de conscience de « l’ampleur de [son] ignorance, de la hauteur et de la profondeur de [son] désarroi » ; la conscience est la « porte du discernement », ce qui donne la possibilité d’une certaine cohérence à « des fragments, des bribes, des lambeaux de cette histoire invisible » qu’est une vie. Non pour écrire sa vie comme exemplaire, mais l’écrire « hors de tout titre de propriété » — et devenir écrivain. En sachant alors qu’écrire n’est pas « une fonction, un métier, un statut, sauf à accepter de porter sa vie durant un masque (…). L’être de l’écrivain est vide, disponible (…) » et « Ce vide, cette absence (…) sont habités par l’acte présent d’écrire ». L’une des lectures du titre du livre est en relation avec cette affirmation et est explicitée dans ce parcours à propos de ce qu’est écrire, « Je suis quelqu’un pour la seule raison que je ne suis personne ». C’est cela qui autorise Patrick Kéchichian à projeter un « livre de vie et de vérité, de nudité et de lumière », qui l’a guidé également dans son activité de critique : il lui fallait toujours, écoutant « la voix de l’autre », non pas disparaître, effacer ce qu’il était, mais « la restituer à elle-même, (…) lui faire écho » ; c’est bien le même qui écrit un « essai de fiction » et à propos d’un livre.
On reconnaît dans cette méditation sur « l’étrangeté de la parole littéraire »2), sur la difficulté à en rendre compte, au-delà d’une certaine proximité avec Maurice Blanchot, les traces d’un lent cheminement, d’une volonté de comprendre. Comme si Patrick Kéchichian avait eu à cœur d’éclaircir ce qui était resté très longtemps obscur, « Il y avait en moi, depuis l’enfance, sans que j’en prisse l’exacte conscience, encore moins la mesure, une attente, une mystérieuse alerte, une gestation secrète du cœur ».
Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne, éditions Claire Paulhan, 2023, 160 p., 18 €. Cette recension a étépubliée par Sitaudis le
1 Le livre à venir est le titre d’un livre de Maurice Blanchot, repris à nouveau au début de l’avant dernier chapitre de L’écrivain comme personne.
2 Maurice Blanchot, op. cité, p. 39.
Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne, éditions Claire Paulhan, 2023, 160 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick kéchichian, l'écrivain comme personne, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2024
Liliane Giraudon, La jument de Troie : recension

Dans un "livre d’artiste" contemporain, dessins ou peintures accompagnent des poèmes, accompagnement dont les écrits peuvent souvent se passer. Tout autres sont les livres dans lesquels poèmes et dessins sont étroitement liés, hier par exemple avec Les Mains libres, "Dessins de Man Ray illustrés par les poèmes de Paul Éluard", aujourd’hui Pierre Alferi écrivain et dessinateur dans divers chaos. Le dessin ou la calligraphie est parfois le poème lui-même ; souvenons-nous qu’Apollinaire avait eu le projet de réunir ses calligrammes sous le titre Et moi aussi je suis peintre.
Liliane Giraudon propose un titre, par exemple "Poème intervalle", calligraphié en vert, et ce qui pourrait être la représentation en couleurs, mauve et vert, de ce qui est alors interprété comme un intervalle. Le lien entre titre et dessin stylisé semble clair la plupart du temps ; par exemple encore, sous "poème casserole" le dessin d’une casserole que l’on reconnaît comme telle sans le secours du titre. Dans bien des cas pourtant, le dessin pourrait représenter tout à fait autre chose que ce qu’annonce le titre ; la relation entre un ovale rouge et le titre "poème vaginal" n’existe que par leur proximité, de même, cet ovale rouge traversé par une ligne ne sera pas toujours reconnu, sans son titre, pour être une vulve. Les critères en œuvre sont très variés — c’est un des plaisirs de la lecture que de chercher les liens entre l’écrit, qui est une annonce et le dessin : « poème toasté » laisserait penser qu’un poème pourrait être (sur) un toast…, le dessin donne à voir deux toasts qui portent quelques traits (6 et 8) à interpréter comme étant de l’écriture (donc le poème écrit), ou le dessin lui-même est le poème.
On échoue parfois à lire une relation qui devait être évidente pour l’auteure. Le titre "Poème maman" précède une série de lignes, de couleurs différentes, qui se croisent, chacune ayant une entrée en bas de page mais aucune de sortie ; on peut imaginer bien des connotations, pas vraiment positives ici, attachées au rapport à la mère. Il est plus difficile, semble-t-il, d’interpréter la relation entre le titre "Poème papa" et le dessin qui le suit, sorte d’intestin en trois parties, rouge, verte, bleue : c’est un des cas où la sagacité du lecteur est nécessaire. Pour l’ensemble, on peut apprécier l’humour (parfois potache) de l’auteure. Le "Poème singe" surmonte un buste, le visage seulement figuré par le tracé de la tête et une forme orangée à l’intérieur ; l’ensemble est en rapport avec le texte, paginé, qui précède les dessins titrés et est annoncé par « Guenon, je singe ».
Le passage du singe à la guenon est analogue à la substitution de la jument au cheval dans le titre du livre ; Liliane Giraudon précise qu’ici « Pénélope répond à Ulysse. / Ithaque c’est terminé. Elle ne brode plus mais dessine… ». Elle rapporte aussi dans les quelques pages liminaires son parcours d’écrivaine, transformée par la lecture de Reznikoff, la maladie (« Arrivée du crabe ») qui l’a conduite au dessin, « Dans une pratique de substitution ». Elle évoque le Bauhaus et la Black Mountain, deux lieux d’expériences et de formation qu’elle aurait souhaité connaître, et Anni Albers artiste textile qui y fut présente. À partir de la « séquestration imposée à tous », en 2020, elle entreprend chaque jour ces « Poèmes)(Dessins », devenus aujourd’hui, ajoute-t-elle, une « Sorte d’acte de survivance. Traçant les lignes de ma propre survie comme celles de l’objet du poème ».
Pour le lecteur, qui passe du "Poème aphasique" au "Poème casselangue", outre le plaisir de découvrir cette accumulation de poèmes-dessins, il ne manquera pas de s’interroger à propos de ce qui est « poésie » (voir Les Mains libres). Au moins lira-t-il la fin de l’introduction de la guenon : « La quasi-manie d’une « qui ne sait pas dessiner » devient un virus dans la Forteresse du Monument-Poésie ».
Liliane Giraudon, La jument de Troie, P.O.L, 2023, np, 18 €. Cette recension été publiée dans Sitaudis le 17 novembre 2023.
P.O.L, 2023
np
18 €
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, la jument de troie, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2023
Ludovic Degroote, Le début des pieds : recension

Si l’on se fiait seulement au titre, saurait-on que La Sorcière de Rome(André Frénaud) ou La pluralité des mondes de Lewis (Jacques Roubaud) sont des livres de poèmes ? Ceux qui annoncent leur contenu ne sont pas les plus nombreux, loin de là, tels Ode pour hâter la venue du printemps (Jean Ristat) ou Poésie ininterrompue (Paul Éluard). Sauf à connaître l’auteur, la plupart des titres n’orientent pas le lecteur vers un genre plutôt qu’un autre. Le début des pieds est un exemple de titre qui surprend ; les nombreux blasons du corps, depuis Marot et son Beau tétin, n’ont retenu que des parties du corps communément érotisées, de du Bellay à André Breton. De quoi s’agit-il chez Ludovic Degroote ? Le titre apparaît dans la première partie "un peu de monde" : « avec la bière le vin la quiche le fromage le pain et le dessert je ne suis plus qu’un ventre chaque jour / je ne vois plus que le début de mes pieds » — c’est aussi le titre de la troisième partie, après "un peu plus au bord".
Des poèmes autour du corps, de la place du sujet dans le monde, de la solitude, de la disparition se construisent à partir de ce type de notation. On ne quitte pas le lyrisme, mais il s’accompagne d’un certain détachement, et d’un humour, qui ne sont pas sans évoquer les grands moralistes classiques. La forme même du texte, proses brèves et rythmées réunies en courts ensembles, renforce le rapprochement. Les motifs sont agencés de manière complexe, on retient celui, récurrent, de la solitude et de la difficulté de vivre dans le monde, déclaré dès l’entrée : « il y a des jours où j’embrasse le monde à pleine bouche, j’y mets toute ma langue, et je ne sens rien ».
Il est inutile d’essayer de trouver une place dans ce monde, où l’on est et dont pourtant on se sent séparé (« c’est comme si le monde se dérobait à force que je sois dedans »), puisque ce n’est pas le monde qui exclut, mais ce que nous sommes, vides, sans regard pour autrui : « nous voyons cet effondrement du monde comme s’il était séparé de nous alors qu’il ne s’agit que de notre propre effondrement — nous sommes séparés du monde ». Vertige de l’inquiétude, de l’incertitude, de savoir que chacun vit la « faille du présent [...] sans cesse recommencée », la chute vers « le manque » — la mort —, mais que rien n’est dit, que tous vivent dans le silence. Solitude irrémédiable : chacun tombe /de son côté / sans heurter les vides / qui nous relient ».
Que faire de sa peur ? La supporter, puisque rien ni personne ne peut réduire ce qui est ruine en soi et l’« on ne se débarrasse pas si bien de soi ». S’enfermer pour ne plus vivre, au moins provisoirement, l’instabilité du dehors. Le monde n’est alors "visible" que par le biais des images : il est alors suffisamment à distance, et donc sans danger : le "je" oublie alors quelle place il y occupe et ce qu’il est lui-même : « et par instants je ne sais pas d’où je viens, j’aime bien la télécommande, le monde je le choisis tant pis si ça n’est pas vrai à l’instant qu’il défile sous mes yeux […] quel bonheur à la télé tout coule ». Ce retrait, qui s’exprime souvent, permet à bon compte d’être « constamment ailleurs » et de ne retenir du dehors que tout ce qui ne peut blesser et parfois même ce que tous s’accordent à estimer "poétique" : « je regarde la télé / la fenêtre est ouverte / on entend les oiseaux ».
Il y a chez Ludovic Degroote une manière tranquille de reprendre les motifs du lyrisme et d’aller à côté, du côté du politique, « j’essaie de m’en sortir / nous n’avons pas la chance de vivre au darfour » ; manière affirmée dans une esquisse d’"art poétique" sans concession. Parce que la poésie n’a pas à se limiter à la seule évidente subjectivité (Ah Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie), qu’elle n’a pas de thèmes privilégiés. Pourquoi pas les pieds plutôt que la douleur amoureuse ou les petits oiseaux ?
j’ai envie d’une bière
voilà de la poésie prise au vif
58% de français se plaignent de la poésie contemporaine leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils pensaient que ce serait autre chose, ils ont déjà tant de mal, c’est inutile d’en rajouter, ils croient qu’on le fait exprès
Voilà bien une autre façon d’en rajouter… Rien de plus immédiatement lisible et bien éloigné de ce qui est rangé, classé, étiqueté dans la case "poésie". Ce qui est écrit repose bien sur une expérience du monde sans emprunter les formes répertoriées, mais avance « par petits bouts sans suivi de rien ». L’écriture n’est pas moyen de guérir de la difficulté d’être là, et évacuer la poésie-pansement, comme la poésie-décorative, est travail de salubrité publique, revigorant pour le lecteur.
j’aimerais bien pouvoir écrire que le petit pansement c’est l’écriture ou que l’écriture en ôtant le pansement met le monde à nu plaie du monde plaie de soi écrire quelque chose active son petit symbole et apporte sa grandeur au poème j’aimerais bien écrire une petite obscurité populaire en achevant le torrent oh raim du peuple libre incendie le froid chambranle des montagnes
mais j’en reste à la vie qui nous ronge
Le début des pieds est suivi d’un ensemble de poèmes titré Ventre. Les poèmes sont composés cette fois de vers très courts, avec parfois jeux d’assonances et allitérations (« langue gavée gangue », « rien rot mot air mort », « mots hachés hachis ») et une syntaxe brisée, les éléments de la phrase juxtaposés ou la phrase inachevée. On pense parfois aux derniers textes de Samuel Beckett ; par exemple : « durer pour durer / encore un peu même si / peu qui quand même /avant drap ongles et chapelet blancs / », etc. Comme s’il était difficile, voire impossible de dire ce qui importe, le manque, la solitude, la perte, la fin, comme s’il fallait le ressassement pour que le vide de toute vie soit perçu — « et partout des mots / qui cherchent leur silence ».
Ludovic Degroote, Le début des pieds, suivi de Ventre, éditions Unes, 2023, 128 p., 21 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 14 novembre 1023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degrootd, le début des pieds, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2023
Jean-René Lassalle, Ondes des lingos-poèmes : recension
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-rené lassalle, ondes des lingos-poèmes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2023
Esther Tellermann, Ciel sans prise : recension
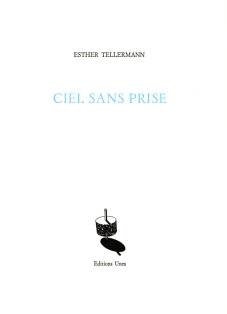
« Voilà / tout finit / et commence »
Il suffit d’ouvrir Ciel sans prise pour reconnaître l’écriture d’Esther Tellerman : poèmes entre dix et quinze vers, lesquels comptent rarement plus de trois syllabes, très peu ponctués mais parfois un blanc introduit une légère pause ; aucune rupture d’une page à l’autre, comme si s’écrivaient par touches les moments d’une histoire, celle peut-être d’un jeet d’un tu/vous très vite présents. L’ouverture du livre donne l’impression que se poursuit un autre livre par la rupture dans une durée :
Soudain nous avions / fermé / les persiennes
Le début rapporte un avant, un passé, où s’est vécu un acte de retrait, le « nous » s’isolant de son entourage et le livre s’achève avec une ouverture, par deux mots détachés, « Qui noue / les chemins et les cercles / toujours arrache / la couleur // fait face ». Ouverture sur l’avenir, vers un autre livre, non pour répéter ce qui a été écrit, mais pour continuer à dire ce qui ne peut être un fois pour toutes énoncé. Parce que rien, ou très peu, de ce qui est écrit ne peut être lu comme "réel", seulement pour une trace possible d’un moment, plus ou moins lisible, plus ou moins transformée : l’un des derniers textes, repris en quatrième de couverture, renvoie ainsi au début du livre, « Qui / soudain / ferme les persiennes », après un autre qui reprend la première scène, « Soudain / nos persiennes étaient closes ».
Comment décider de ce qui est réel, de ce qu’est le réel dans le livre. Dans le premier poème quand le "je " revient au présent après un temps dans le passé (plus-que-parfait, « avions fermé »), cela se passe dans un mouvement où l’univers semble se défaire (« Tout près / les continents / me traversent), est-ce l’image d’un ailleurs que l’on retrouve plus loin (« avant l’incandescence / d’une unique fièvre / où s’engouffrent / les continents ») ? d’une confusion où l’espace s’étire jusqu’à déborder toute limite ? Parallèlement, les divisions temporelles s’effacent pour laisser place à une durée continue, sans présent ni passé, et à la proposition : « un lendemain n’est-il / un jadis suspendu à l’aurore », une réponse : « l’absence de lendemains » d’où naissent l’obscurité, la « ténèbre ». L’écriture ouvre à « un absolu », à « l’infini » (« Nous humions l’infini »), l’absence de verbe parfois ne situant plus rien dans la durée, « l’encre psalmodiant / l’exactitude / des naufrages / le dessin / des univers / tus ». Il suffit d’un mot, « soudain », pour qu’il y ait rupture, l’univers semble se défaire, perd tout contour et sa raison d’être, « Soudain / ne respirent / les vieux mondes / trébuchent / sur les constellations » et plus avant, « les vieux mondes dérivent ». Tout pouvant devenir mots, ce qui était achevé peut recommencer, comme si un changement d’ordre météorologique suffisait à provoquer une métamorphose, « Puis reviendra / l’orage /(…) et notre chemin / sera visible » — futur d’un "nous" dont les composants sont insaisissables.
S’agit-il d’un "nous" amoureux comme le laisseraient supposer, par exemple, les allusions à la chambre close, au mouvement des reins ? Un "nous" complice au regard commun pour observer ce qui est en dehors de lui : « nous écartions / les persiennes pour / deviner / un monde / qui palpite » ? Mais de ce monde bien peu est dit, le lecteur découvre — ou invente en partie — des allusions à l’Histoire passée à partir des « rafales de souvenirs ». Les éléments propres à un récit sont évidemment absents et si l’on cherche des paysages, on ne trouve que des « horizons » ; les noms variés de fleurs et d’arbres participent au rythme des poèmes, non à une description de lieux — dans l’ordre d’apparition : amandier, jasmin, sauge, saule, hibiscus, gardénia, hysope, églantier, myrtille, châtaignier, cyprès, aubépine, lilas, saule, laurier, pavot, orme, hyacinthe. Quant aux noms généraux (terre, ciel, mer, continent), ils ne renvoient à rien de concret et la relation au visible est même explicitement effacée ; ainsi, l’ombre surgit, fabrique d’obscurité (« Tout à coup / une ombre / tourmente le bleu / dépose un peu de nuit »), mais plus souvent l’ombre, et donc l’obscurité, apparaissent comme des éléments intérieurs : « sans ombre que celle du dedans », et il est inutile de chercher à « tresser des chimères / apprivoiser l’ombre ». La mer, présente dans les poèmes, a un statut analogue à celui de l’ombre, ce qui est répété : « sans / mer // que celle du dedans », puis « sans mer / que celle du / dedans ».
Cette présence absence semble définir ce qu’est le "tu / vous", de là toute fondation d’un "nous". L’interlocuteur est lié à une odeur, proche par sa salive, il partage une chambre avec la narratrice et, également, des rêves (« nous inventions des sommeils ») s’avère être une création verbale, « je cherche encore / la langue / où / vous dire ». Construit peu à peu il s’évanouit brusquement (« Puis soudain je vous perds »), comme si les mots manquaient pour maintenir sa consistance. Ils sont bien là, les mots, mais pour exprimer nettement qu’ils sont la seule existence du "tu / vous" ; c’est « celui qui ne fut / à qui je parle », « Vous avez été / serez / (…)/ un dieu absent / ouvrant les paumes / frère / d’un ailleurs ». "Tu" comme suite de mots, seulement une forme nécessaire pour explorer ce que pourrait être un échange, « Je serai / vous / celui qui fut / à qui je parle / ou / qui ne fut pas / mais demeure ». Peut-être qu’une relation entre un "je" et un "tu" n’existe qu’avec les mots — Car / rien n’est / que / l’au-delà de / la forme » —, la présence du "tu" étant plusieurs fois affirmée comme suspendue au désir du "je" ; l’un et l’autre comme des formes à investir — c’est leur statut dans la langue. C’est une condition suffisante pour que les souvenirs, les temps de l’enfance, le passé donc, renaissent dans le présent, souvent avec leur charge émotive qu’on lit proche d’un Verlaine : « Dans les vieux parcs / viennent les chagrins / au souvenir / des pavots et des / musiques ».
On voit là que Ciel sans prise n’a rien d’un livre de poésie abstrait. Parfois énigmatique, qui suggère plus qu’il ne dit, qui demande à être relu, et la forme choisie est un élément important dans le plaisir de la lecture. Esther Tellermann use rarement de la paronomase (jaspe / gypse) et des répétitions de sons (« des paupières et des paumes ») ; outre les ellipses de verbes, elle introduit régulièrement des constructions syntaxiques qui exigent une (re)lecture attentive (compléments multiples ou éloignés du verbe, cascade de relatives) ou dont l’ambiguïté n’est pas immédiatement levée — un exemple : « (…) peut-être / secret / que le / corps porte / et soudain / irradie / la brûlure », où « secret » peut être lu comme sujet de « irradie ».. Livre que l’on peut lire sans rien connaître des ensembles précédents, auxquels on peut le rattacher tant l’œuvre est homogène.
Esther Tellermann, Ciel sans prise, éditions Unes, 2023, 220 p., 20 €.
Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 octobre 2023.
Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités
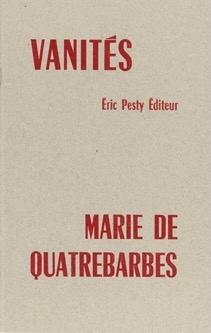
« Plutôt que de prendre racine, nous passons »
Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.
Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».
L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).
Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :
On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi »
Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».
Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.
- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 mai 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie sz quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités : recension

« Plutôt que de prendre racine, nous passons »
Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.
Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».
L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).
Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :
On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi
Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».
Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.
- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis en mai 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2022
Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien. : recension

« Où vivre / et dire ? »
Quatre ensembles titrés, suivis d’un épilogue ("Je ne chante plus, je rêve"), composent le livre : "Ne fuis pas, je te suis", Ne t’encombre pas de la nuit", "Je souffle, et rien." (qui donne le titre), "Ne t’éloigne pas, mon ombre fragile te suit". Une postface de Jean-Marc Sourdillon ("Le regard d’Eurydice") propose une analyse qui rattache les poèmes au mythe d’Orphée à partir de plusieurs indices, dont le titre des séquences ; dans le jeu du je-tu, le tu serait le père disparu, la voix d’Eurydice-je« l’accompagnant (...) dans l’événement de sa disparition pour aller le rechercher ». Les arguments sont convaincants et l’on peut suivre cette lecture. Jean-Marc Sourdillon précise cependant que « le lecteur pourra suivre d’autres fils, découvrir d’autres intrigues, Je souffle et rien, est un livre ouvert. » À côté de sa suggestion, on peut en effet lire autrement les poèmes en les liant aux livres déjà publiés.
L’auteure, plus peut-être que dans d’autres livres, se confond avec la narratrice. Les paysages et les lieux sont ceux où elle vit, la ville des Andelys, la Seine, l’île de Seine, les falaises très présentes, les hameaux (le Petite Andely, Noyers, plusieurs fois cité). Dans ce décor rassurant où tout peut se nommer, le motif de la disparition est repris d’un bout à l’autre du livre : les mots, les étoiles à un moment donné sont présentés comme disparus, et aussi de manière récurrente le tu, « Mes doigts écartés, je te tiens ici, toi qui disparais, disparu ». À ce motif est étroitement associé celui de la perte ; l’absence du tu provoque celle de sa voix, donc le support même de la parole ; ce n’est qu’avec la voix que le Sujet se manifeste, elle rend possible l’existence même du tu, toute relation d’échange avec l’Autre, ce qu’exprime précisément la narratrice, « Tu es perdu / ta voix s’éloigne » et, de là : « mesurant à te perdre l’identité / du pronom nous ». La perte du tu implique aussi symboliquement celle du paysage (« regardant perdu l’horizon ») et celle peut-être du je, au moins de toute intériorité (« mon cœur perdu »). `
Le souhait d’un retour du tu est immédiatement associé à une autre perte, celle du chemin vers un hameau — lieu de naissance et de vie du je ou du tu ? — : « Comme si tu revenais n’ayant pas trouvé perdu le chemin de Noyers ». La narratrice, dans un élan christique, invente même sa résurrection, « Je cours vers toi sur les eaux / pour te faire renaître ». Elle invente aussi « un rendez-vous », sachant que personne ne l’y rejoindra, ou une fiction qui permettrait au nous de se recréer, « Je recompose / le passage secret où te retrouver, / je l’appelle "coquelicot" » ; la fleur incarne pour Isabelle Lévesque (par exemple dans Voltige ! et dans Le Chemin des centaurées) la nature l’été et, par sa couleur, le vivant, l’amour, et tout autant le caractère éphémère de ce qui est. Cependant (« Fini les fées »), aucune métamorphose ne restituera ici le tu qui ne sera présent que par les mots, le temps effaçant progressivement la présence ancienne.
Toute évocation souffre de l’incertitude de la mémoire, d’où n’émergent que l’ombre du tu, que des images indécises — « Je ne rattrape que / ton reflet », écrit la narratrice dans la dernière partie de son parcours —. ; « ombre » est l’un des mots récurrents, présent dans le titre de l’avant-dernière séquence mais relevé dès les premiers poèmes, « Nous savons que s’éloigne / chaque ombre saisie » — il semble d’ailleurs que le lecteur soit inclus dans ce "nous". Les jours de l’enfance du tu sont rappelés (« genoux écorchés tu es l’abandonné »), mais ces jours anciens sont quasiment devenus hors d’atteinte, « Des morceaux de temps / (...) s’écartent de l’origine » et tout est voué à l’oubli, tout ce que la narratrice tente de rassembler, l’ombre même du tu comme le reste. L’écriture restitue ces jeux complexes de perte et d’oubli et empêche la disparition complète du tu : ce rôle ancien de la poésie est ici renouvelé.
En effet, le poème (« Je l’écris pour toi, il existe ») donne un sens à l’absence. Le tu écrit est donc ainsi indéfiniment recréé, « Tant que je vis je te donne forme » et, du même coup, donne aussi raison de vivre au je, « Je change, je chante ». Parce que les mots sont considérés comme « vivants », destinés à faire apparaître l’absent. Dans Le Chemin des centaurées, une autre version de la disparition était empruntée à la Grèce antique avec la question « Ulysse, reviendras-tu ? » ; ici, « Rien ne change nous sommes / laissés pour compte d’une histoire interrompue », et l’histoire est toujours à récrire, à réinventer sachant que l’ombre ne peut être dissipée. C’est pour cela que le coquelicot est présent d’un livre à l’autre, symbole de l’amour et du passage, et que l’épilogue propose en épigraphe quelques lignes de Beckett, extraites de la fin de L’innommable, « (...) il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a (...). Ressassement pour que, dans l’imaginaire, le nous soit recomposé.
Fabrice Rebeyrolle, accompagne les séquences de huit peintures non figuratives. Elles donnent à voir une matière opaque qui peut évoquer celle de la falaise et les couleurs de certaines figurent ciel, eau et horizon des poèmes.
Isabelle Lévesque, Je souffle, er rien., Peintures de Fabticve Rebeyrolle, postface de Jean-Marc Sourdillon, L’Herbe qui tremble, 2022 , 152 p. 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 août 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, je souffle, et rien., recension | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2022
Paul Klee, Paroles sans raison : recension
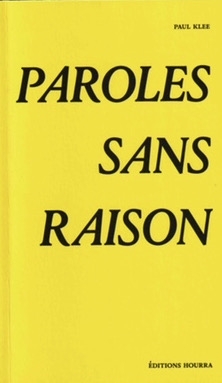
Dans sa jeunesse, Paul Klee (1879-1940) jouait sans cesse Bach au violon et se demandait s’il ne devait pas consacrer sa vie à la musique ; il écrivait aussi des poèmes de contenus variés, dont des quatrains érotiques. On suit dans son Journal* son désir de s’engager dans diverses voies et il s’établissait un programme au printemps 1901 (p. 50) :
au premier chef, l’art de la vie, puis, en tant que profession idéale : l’art poétique et la philosophie ; en tant que profession réaliste : l’art plastique et, à défaut d’une rente : l’art du dessin (illustration).
Comme le rappelle Pierre Alferi, c’est au cours de son voyage en Tunisie (avec August Macke et Louis Moilliet) qu’il a décidé d’être peintre ; il écrivait le 16 avril 1914 après un voyage à Kairouan, « La couleur me possède. (...) Voilà le sens du moment heureux : la couleur et moi sommes un. Je suis peintre. » (p. 282)
C’est avec le regard du peintre qu’il écrit « Voir c’est le savoir », mais la lecture des récits de rêve découvre un Paul Klee proche de Desnos ou de Leiris. Certaines images de son monde onirique, bien éloignées de la vie diurne (un banc de roses, un sorcier), empruntent cependant en partie à la réalité : la fille du sorcier qu’il regarde ferme les rideaux, mais l’observe par une fente ; ces images d’une relation à peine esquissée sont commentées dans la seconde partie du poème par Klee, pour qui on rêve à partir de « ce qui nous a un instant désarmés ». Dans un autre rêve de la même année (1906), s’effectue un mouvement du corps désorganisé vers une origine où se trouverait « Madame l’Archicellule », symbolisant la fertilité ; en même temps, son activité de peintre est évoquée et heureusement reconnue, avec la mention d’une « délégation (...) / pour rendre grâce à son travail ». Rêve encore, cette fois de l’absence de tout espace, de tout corps (« ma nudité volée »), de tout signe qui évoquerait une existence (« effacée, l’épitaphe ») — vision frappante de la disparition, du néant.
La mort, la violence sont présentes autrement, exprimées de manière lapidaire : « Animal humain / heure de sang ». Dans les poèmes retenus apparaît aussi le motif de la claustrophobie, avec l’enfermement dans un lieu clos (« grand danger / pas d’issue ») et, pour en sortir, le plongeon par une fenêtre, mais l’image de la liberté retrouvée (« Libre je vole ») est mise en défaut : la chute sans fin figurée par la répétition : « Mais la pluie fine, / la pluie fine, / la pluie / tombe, / tombe... / tombe... ». Enfermement encore avec le retour de l’enfouissement, lié au monde des morts ou au passage du temps avec l’image classique du « ver qui ronge ». La préoccupation de l’au-delà est aussi mise en scène ironiquement dans une fable où un loup dévore un homme et tire une conclusion de son acte : l’homme peut être le dieu des chiens si le loup peut le manger, et la question demeure, « Où donc est leur [=des hommes] Dieu ? ».
La diversité des poèmes permet de lire d’autres aspects de l’écriture de Paul Klee qu’Alferi rattache notamment à Christian Morgenstern (1871-1914) pour la bouffonnerie, par exemple dans "Parole sans raison" avec des propositions comme « 1. Une bonne pêche est un grand réconfort », « 7. Douze poissons, / douze meurtres ». Ce qui apparaît souvent, ce sont les jeux avec les mots : adjectif qui change de sens selon sa position (« des gens petits / pas de petites gens »), verbe accompagné ou non de la négation : « lui qui sait qu’il ne sait pas / à l’égard de ceux qui ne savent pas / qu’ils ne savent pas / et de ceux qui savent qu’ils savent ». Un poème de quatre courtes strophes est construit avec cinq mots, deux adjectifs de sens opposés, "grand" et "petit", accompagnés de "calme", "forme" et "mobile, mobilité" qui s’achève par le retour du peintre, « calme petite forme s’appelle "peinture" ». Des vers à propos des états de la lune selon le lieu rappellent Max Jacob avec des vers comme : « que le cactus ne la crève pas ! ». Paul Klee avait aussi l’art de la pirouette, un portrait de chat qui saisit ses qualités sensorielles bien différentes des nôtres — « l’oreille cuiller à sons / la patte prête au bond [etc.] » — s’achève par un trait qui le sépare des humains : il « n’a, au fond, rien à faire de nous »
À la suite des poèmes, après une photographie de Paul Klee, sont excellemment reproduits onze tableaux et dessins, tous légendés, le plus ancien de 1915, le plus récent de 1940. Pierre Alferi retrace à grands traits dans sa postface le parcours de Paul Klee, qui continue d’écrire jusqu’à sa mort, en prose et en vers. Traducteur également de John Donne et d’Ezra Pound, il restitue le caractère singulier de l’écriture du peintre ; il propose un choix de traductions en suivant l’ordre chronologique, retenant des textes écrits de 1901 à 1939. L’ensemble des poèmes de Paul Klee est aujourd’hui traduit dans plusieurs langues, pas en français... : espérons que ce premier ensemble de 21 poèmes, publié par les éditions Hourra installées en Corrèze, décidera un autre éditeur d’entreprendre la publication de la totalité.
Paul Klee, Paroles sans raison, Choix, traduction et postface Pierre Alferi, reproduction de onze tableaux, éditions Hourra, 2022, 48 p., 15 €. Cette recension a té publiée par Sitaudis le 22 août 2022.
* Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959 ; le Journal est maintenant disponible en poche dans la collection "Les Cahiers rouges" chez le même éditeur.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, paroles sans raison, pierre alferi, recension | ![]() Facebook |
Facebook |





