20/01/2020
Ariel Spiegler, Jardinier : recension
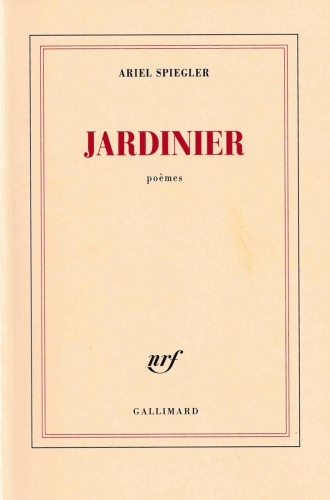
Voici un livre de poèmes qui rompt avec les thématiques dominantes aujourd’hui ; il n’abandonne pas la forme devenue classique du vers libre, mais il se développe autour de deux passions perçues comme inconciliables — voir Thérèse d’Avila — l’amour du divin et l’amour de la chair. Le titre évoque bien un lien à la nature, en l’occurrence il s’agit du jardin où a lieu la résurrection du Christ : "jardinier" renvoie à la méprise de Marie-Madeleine qui, trouvant le tombeau vide, s’adresse à un homme — Jésus — qu’elle prend pour un jardinier, voulant savoir où a été transporté le corps crucifié. La citation en épigraphe, « il nous viendra comme la pluie », extraite du Livre d’Osée, un prophète de la Bible hébraïque, est en relation directe avec l’existence de Jésus quand on lit son contexte :
(1) Connaissons, cherchons à connaître l’Éternel ;
sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie,
comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
(6.3, traduction Louis Segond, 1874)
Il faut ajouter que l’amour d’Osée pour son épouse Gomer (qui avait été une prostituée) est aussi inconditionnel que son amour de Dieu, thématique qui n’est pas étrangère aux poèmes d’Ariel Spiegler : la passion pour le divin et celle pour l’homme se mêlent au point qu’on ne peut toujours établir un partage entre elles. Le premier ensemble, le plus long (23 poèmes) est majoritairement occupé par la quête du Christ, comme le troisième, le quatrième et le dernier (11, 5 et 12 poèmes), le cinquième est consacré à l’amour humain (5) alors que le second est partagé entre les deux.
Les poèmes de Jardinier ont souvent un caractère sibyllin, l’alternance du "je" et du "tu" ne représentant pas toujours des sujets définissables, l’un et l’autre pouvant parfois renvoyer au divin ou à l’humain et, à deux reprises, l’introduction de "Ariel" désoriente la lecture. Il semble que le va et vient entre les deux instances est la trace d’un débat intérieur, d’un mouvement de doute et d’espérance, d’hésitation et d’élan, l’objet même de la recherche étant d’abord difficile à cerner ; « tu ne sais pas (...) ce que tu cherches » a pour réponse, plus avant, « Je sais où aller », sans que le pronom "tu" ici renvoie clairement à tel ou tel sujet, "tu" pouvant devenir "je". Celle désignée par « petite » par le personnage divin — ou dans le dialogue intérieur — entend « l’appel d’un homme incompréhensible / à le suivre tambourine » ; cet inconnu n’est jamais nommé mais sa figure se dessine par ce que les évangiles rapportent de ses actions et paroles. Ainsi, « il a vaincu le monde » reprend le « j’ai vaincu le monde » du Christ (Jean, 16.38), « le souffle devant qui tomber à genoux » — se souvenir que esprit a pour origine le latin spiritus, "souffle" — fait penser à la Lettre de Paul aux Éphésiens, « je tombe à genoux devant le Père » (traduction Ernest Renan), etc. Les allusions à l’action du Christ parsèment les poèmes, comme « renverser les tables » — les tables des marchands du Temple (Jean, 2.15) ou « reviens sur un petit âne » (Marc, 11.7), ou encore l’allusion au moment de la crucifixion (« ce qui a pu arriver un jour d’avril »). Le lecteur reconnaîtra le vocabulaire du christianisme, parfois la parole mystique avec la récurrence du mot "lumière" : « ses paroles commencent / par la lumière », « j’ai senti sa lumière », etc., et, dans le dernier ensemble du livre est dite la fusion désirée avec le divin, « Soulève-moi jusqu’à ta face / (...) disperse-moi dans ta lumière ». On relève encore « colombe », pour parler de la "petite", l’oiseau symbolisant la recherche de Dieu, « grâce », « feu », etc. Ces éléments sont d’autant plus remarquables que des formes analogues apparaissent à propos de l’amour humain.
Si l’on revient à l’épigraphe initial, le sauveur est attaché au printemps, à une nouvelle naissance ; l’arrivée de l’amant emporte aussi loin du monde quotidien mais dans un autre temps, « De loin, dans l’hiver, il est venu à moi, / une veste de moto sur les épaules, et le royaume. » Royaume cette fois de la chair, sans ambiguïté, l’union des corps étant aussi totale que celle d’une autre nature avec le divin — « je me suis mélangée à son corps —, sans pourtant que la présence divine, sous la forme de la mère-vierge, soit abandonnée : dans l’étreinte, « Marie sur sa médaille est entrée / mille fois dans ma bouche et m’a bénie ». La relation amoureuse aboutit elle aussi à abolir le temps (« Délivre-moi du futur ») et à connaître un paradis autre que celui promis par le divin, « Tu as fait de ma vie un jardin ». Le contexte de la rencontre, c’est celui d’un espace qui contient, par le biais de l’extrême variété des couleurs, toutes les formes vivantes possibles, cette diversité étant lisible également dans la beauté du corps féminin :
(...) Et qui l’attend ma cuisse pêche aurore
thé. Quand il la touche framboise
dragée bonbon la chair.
L’éloge du corps, de la chair est-il contraire à la parole divine qui, s’adressant à la "petite", oppose l’amour de Dieu, « irrémédiable », c’est-à-dire que rien ne peut changer, à la passion humaine : « Je suis le désir (...) le seul » et « À toi les multiples », en précisant sur ce point : « Tu sais (...) tourner autour de l’odeur d’un homme / de la saveur de son sperme ».
Y a-t-il opposition irréductible entre le divin et l’humain ? Le dernier ensemble du livre laisse entendre que les deux peuvent coexister, même si l’élan vers le Christ semble parfois dominant. Les poèmes sont ici majoritairement liés à la lumière et à l’eau, par exemple avec l’allusion au baptême de Jésus par « son cousin » (« l’eau de l’attente sur les cheveux »), avec le début d’une chanson de Guy Béart, "L’eau vive", l’eau vive étant le symbole de la purification, avec les derniers mots du livre, « Donne-moi à boire », mots de Jésus à la Samaritaine près d’un puits. Il n’y a aucune hésitation, avec le retour de la question à propos du Christ, « Qui est cet homme en sandales (...) ? », suivi aussitôt de l’écho à l’épigraphe d’ouverture, « Qui est cet homme venu sur la terre / comme une rosée par terre ? ». L’ordre terrestre n’est pas absent, avec le souvenir avant le poème final du pays de l’enfance, des danses (et non des prières) pour appeler la pluie fécondante, de l’herbe odorante, d’un chanteuse brésilienne populaire, Elis Regina (1948-1982) et d’un « chagrin d’enfant / confié aux coquillages ».
Dans Jardinier, des tensions se vivent entre le spirituel et le charnel sans que l’un l’emporte sur l’autre ; la "petite" affirme bien « Je suis ton esclave éperdue », donc folle d’amour, mais ces mots sont prononcés dans un contexte ambigu ; d’une part, ils semblent répondre au poème précédent (« Il m’a dit : « N’aie pas peur de mourir / je suis là »), d’autre part, ils sont suivis de propos sur « l’orchestre de la vie », sur le « vent [qui] danse haut dans les feuilles ». Les deux passions sont vécues, entières, sans conflit, au moins dans l’écriture.
Ariel Spiegler, Jardinier, Gallimard, 2019, 104 p., 11, 50 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 15 décembre 2019.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariel spiegler, jardinier, recension, passion. | ![]() Facebook |
Facebook |





