05/04/2025
Henri Thomas, La Joie de cette vie
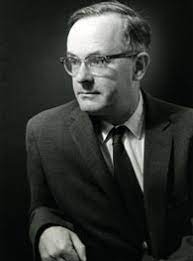
Il est vrai que j’ai toujours erré seul, c’était mon goût. Mes compagnons étaient les barres de fer des clôtures, les arbres qui vous suivent très peu, le sable endormi u éveillé, le ciel ennuagé ou non. Pourquoi de préférence personne ? Ou bien les bavardages passionnés et incertains, impatients ?
Il n’y a pour un homme que son passé qui existe vraiment, et de plus en plus à mesure que le passé s’approfondit en s’éloignant.
Q’est-ce que la vérité d’un poème — je ne l’ai jamais su ; Mais quelquefois un poème m’a fait plaisir comme un théorème bien compris, après travail et attente, et ce n’était pa s un théorème. Un moment de ma vie, une vivante belle ?
Henri Thomas, La Joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 72, 83, 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, passé, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2025
Henti Thomas, La Joie de cette vie
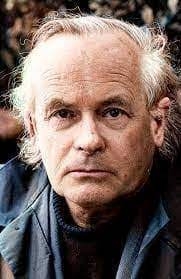
Si l’existence des pauvres (qui seront toujours nombreux, même si le nombre des riches et demi-riches augmente) est fatalement basse, inculte, sans esprit, alors la beauté de la nature est empoisonnée (puisqu’elle n’est que pour les favoris de la fortune) et ce monde est un lieu sinistre. Essayez des systèmes sociaux différents, aucun n’y remédiera.
La parole qui nous libèrerait, qu’est-ce qu’elle peut contre la lourdeur et la bêtise du corps. Elle n’est pas inscrite quelque part où on pourrait la trouver : elle n’est pas avant que tu sois elle, et elle toi.
J’essaie parfois d’imaginer l’absence totale qui ferait que plus rien ne me toucherait. Le monde de l’émotion, des liens du cœur, si puissants ici, aurait disparu. Il n’y aurait plus ni enfermement ni ouverture, dans le nulle part.
Henri Thomas, La Joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 57, 65, 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, lao joie de cette vie, nullipare | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2025
Henri Thomas, La joie de cette vie
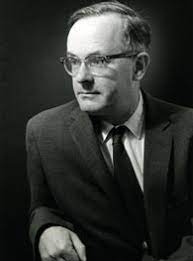
N’essaie pas de rejoindre en réalité quelqu’un qui n’a pas la même pensée que toi. Cela ferme beaucoup de chemins ! mais qui a la même pensée que toi, rien ne te séparera de lui, sauf la réalité.
Vivre, être, s’exprimer — je ne vois rien de plus — car voir ne passe pas outre.
Non, je n’ai pas peur de la mort, ce qui m’effraie, me gêne, m’ennuie, me fait honte, c’est ce que les hommes ont fait de la mort : une horreur privée, un embarras public.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 44, 45, 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2025
Henri Thomas, La joie de cette vie

Si la mort est la solution forcée du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c’est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.
Paulhan a buté là-dessus toute sa vie, « comme une grosse mouche dans une vitre », dixit Leyris.
Un ami —Il lui faudrait des qualités que je n’ose rêver de personne et dont je n’ai pas en moi le modèle. C’est en ce sens que « Ô mes amis, il n’y a pas d’amis ».
Ce n’est pas la vérité qui remonte du puits mais quelque chose de noyé et vivant à la fois, un passé.
Écrire, pour moi, ç’a a toujours été une déclaration d’amour à la vie, et quelquefois elle l’acceptait.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 29, 32, 33, 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2025
Henri Thomas, Le Migrateur

Je ne peux pas vivre les souvenirs des autres, de quelques-uns, d’un seul, rien. Quelle limitation, quelle prison, quel manque de sympathie ! L’idée que d’autres n’ont même pas accès, souvent, à leurs propres souvenirs, n’est pas pour me consoler. Mes propres souvenirs sont aussi un chemins vers ceux des autres (et l’inverse), et, plus loin, vers une mémoire totale, qui est peut-être à l’origine perdue de chaque souvenir.
Oui, mais qu’a-t-on donc à aimer que ce que l’on vit, que ce que l’on a vécu ? C’est là que toutes les extrapolations et paraboles prennent origine. Je ne verrai, je n’imaginerai, je ne devinerai que ce que j’ai aimé, à ma mesure.
Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
31/03/2025
Henri Thomas, Le Migrateur
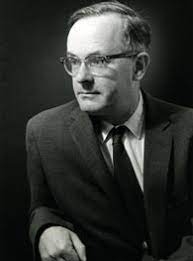
Le langage ne nous est ni plus ni moins personnel que la respiration, qui nous vient avant lui et qui le reçoit, de la même source lointaine. « De même que nous avons été enfants avant d’être hommes… » (Descartes), et de même qu’avant d’avoir été enfants, quoi ?
« Je n’ai pas connu la douce folie des enfances paysannes », écrit Sartre dans Les Mots : La douce folie : la dure raison, ni simple ni dialectique, la raison des bêtes et des choses, des éléments, des saisons.
J’ai un peu l’impression d’avoir écrit mes livres comme dans un rêve dont je ne me souviendrais pas, et dont ces livres ne sont pas le récit, mais le résultat, ou le reflet fragmenté, comme écrits dans la marge étroite d’un éveil. Quelquefois aussi, je me souviens de l’amour, et je me demande ce que c’est.
Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin /Gallimard, 1983, p.156, 187, 206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, écrit | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2025
Henri Thomas, La joie de cette vie
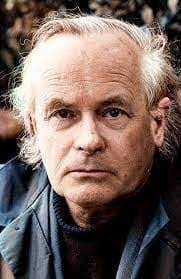
Nous avons un corps, j’ai un corps comme le soleil est là dans le ciel, ni plus ni moins.
Après la mort, mo corps sera une chose comme tous les autres. Jusque-là, il est moi — qui ne suis pas comme les autres.
J’écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l’on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Je n’aurais pas trop d’un océan pour m’aider à vivre/ Mais quelle fatigue de l’atteindre ! Si je mourais en chemine ? Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.
Incapable de désespérer — en cela pareil aux animaux auxquels nous attribuons l’indifférence devant la mort.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 13, 21, 24, 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/03/2025
Henri Tomas, Le Migrateur
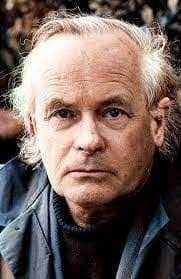
Le soleil du solstice d’hiver sur la mer, par un jour sans nuages. Les ombres des rochers sonnent quelque chose d’étrange à la lande, comme s’il y avait là un langage ignoré qui affleure au jour. Je songe que tout ce que j’ai pensé est en moi de la même manière, sujet au mouvement de la vie que je ne connais pas.
Appelle cela l’inspiration, si tu veux : en tout cas ce n’est pas la raison (ou alors drôlement masquée) qui donne le feu vert aux mots, à tout le train des phrases.
Une des vagues de l’esprit, sans doute — mais on peut en dire autant de tout ce qui bouge.
À la manière dont cette jeune femme s’écrie : « Nuance ! », au Lipp, côté « limonade », on comprend le comique, l’affreux comique du salon Verdurin.
Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 110, 114, 117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, inspiration comique | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2025
Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul : recension
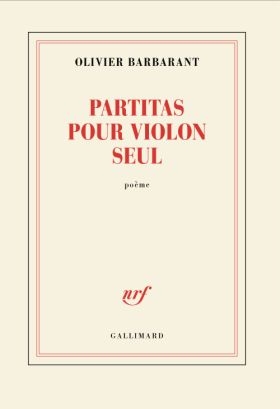
Le livre réunit six ensembles, dont plusieurs déjà publiés dans des revues, sous le signe de la musique dès le titre, "partita" impliquant aussi l’idée de variations. Un des groupements de poèmes évoque avec "chaconne" ("Chaconne pour une planète") une danse à trois temps née au XVIIe siècle ; un autre est plus explicite, "Musiques sur quelques départs". Enfin la conclusion du premier texte en exergue consacré à l’emploi par Bach du violon pourrait résumer ce qu’ambitionne Olivier Barbarant dans le recueil, « [à propos du violon chez Bach, instrument double, harmonique et symphonique] Cette dimension porteuse d’opacité, de relief et d’une sorte d’au-delà de lui-même. Cet équilibre aussi d’un cante jondo[chant profond] ne sortira rien qui se contente d’être lisse et beau, mais âpre et réel et vrai ».
"Enfantines" ouvre le livre avec une quadruple référence dans le premier poème : le titre, « Qui je fus », est emprunté à Michaux (1), le port dans l’adolescence du triangle rose (2) est une allusion transparente à l’homosexualité, des noms d’écrivains, un d’une femme politique, sont ceux des modèles à égaler (« devenir Hugo, Gide, Verlaine, ou Louise Michel) », est cité Glenn Gould avec son « jeu très lent construit au bord du gouffre » dans son interprétation des Variations Goldberg de Bach. On peut lire là une manière de programme. Comme Michaux dans Qui je fus Olivier Barbarant s’appuie souvent ensuite sur des éléments biographiques : amours homosexuelles, rappel du lien à Aragon à propos de qui il a publié plusieurs livres (ici, le titre du second ensemble est l’incipit d’un chapitre d’Aurélien), souvenirs de l’enfance, etc. Le dernier groupe de poèmes se présente comme un bilan (« Quelle étrange vie à la fin / (…)/ Aura été la tienne »), avec à nouveau la présence de Paris, des proches qui portent des prénoms (Bérénice, Aurélien) issus d’Aurélien, l’amour au centre de sa vie, les disparitions (« Vivre était donc apprendre à perdre ») et un sentiment de solitude, « Sans doute la plupart ignorent / Que j’ai su si bien les aimer ».
Le recueil est dominé par deux motifs complémentaires : la fin accélérée du monde et la manière dont l’individu peut vivre ce désastre. « Toute la terre est périssable », ce qu’annonce le rappel elliptique de destructions récentes, « Des tours jumelles. Des cathédrales / Une centrale […] ». Ce qui est détaillé, c’est la disparition future des œuvres d’art, « Il ne restera rien de nos musiques mortes », ni de Matisse, Chardin ou Caravage. Mais rien non plus du "nous", des humains comme individus : devenus un « troupeau docile ». Cet avenir n’est pas l’Apocalypse de la religion, seulement une conséquence des actions humaines qui aboutiront au néant, au rien, à « l’ultime chaos ». S’il est à faire une prière — tout à fait inutile cependant — elle ne s’adresse pas à un dieu absent mais aux humains, « Ayons pitié de nous / Ayons pitié de nous ». On note le choix du 12-syllabes ou du décasyllabe, vers "nobles", pour chaque fois conclure des annonces de destruction (« Mais qui entend vraiment la cloche d’incendie », « Pas de grand écran pour notre agonie »). Ce tableau sombre, désespéré, préfigure le sort de l’humanité et il n’est pas difficile de penser qu’il ne s’agit pas d’une fiction, tant se manifeste en effet une indifférence générale, pas seulement celle des gouvernants, devant l’extinction d’espèces animales ou les changements du régime des eaux. Que faire quand tous les signes d’une catastrophe s’accumulent.
La réponse d’Olivier Barbarant n’est pas un sauve-qui-peut, plutôt le choix de retenir ce qui reste pour, chacun, vivre au mieux le présent : « dans cet enfer promis / Passent quelquefoisdes abeilles » (souligné par moi), au béton opposer la glycine et au rien « un autre infini » constitué par la lumière, le vent, les fleurs, les oiseaux, les regards, les échanges, « Un accord entre deux pensées ». Partir du fait que « L’essentiel n’existe qu’à peine » implique que tout ce qui éloigne du désastre est fragile, que l’on ne saisira que des « buées », des « balbutiements », des « instants », des « miettes », « une poudre »,
Pour toute force l’éphémère
la vraie vie parie sur le givre
qu’on regarde aux fenêtres fondre
On se proposera de lire, de regarder, d’écouter, d’écrire peut-être, sachant que toutes les œuvres humaines disparaîtront, comme disparaissent les lieux que l’on a connus et appréciés, et l’on comprendra que l’amour dans tous les sens du mot appartient à la « vraie vie »,
L’art et l’amour ouvrent l’amande
du monde enfin déshabillé
dont ne tombent que les mensonges
L’amour des corps, homosexuel ou non, sauve donc du gouffre par la beauté des corps ou la grâce de l’étreinte, même quand elle a lieu au fond d’un garage. C’est le fait d’être deux qui donne un sens à sa propre existence, ce que reprend Olivier Barbarant sous différentes formes, « L’important n’est pas de savoir qui l’on est / mais ce que d’un corps l’on offre à la vie ».
Les poèmes d’Olivier Barbarant ne cherchent pas à innover en abandonnant toute règle : pas de tentative de faire naître le sens par l’illisible ou en prétendant fonder une autre langue. Comme d’autres contemporains (Ristat ou Paulin, par exemple), il utilise le vers libre compté (surtout l’hexa- et l’octosyllabe), ne néglige pas les images (« une farine de visages », « la neige du sourire », etc., l’anaphore ou l’énumération qui arrête un instant la variété du réel. Il s’agit toujours de saisir ce qui ne dure pas, de dire et redire que ce « monde menacé » peut encore être « l’écho d’être deux ».
- Henri Michaux, Qui je fus, "Une Œuvre un Portrait", Gallimard, 1927.
- Le triangle rose était le symbole porté par les homosexuels masculins dans l’univers concentrationnaire nazi ; les lesbiennes portaient le triangle noir, symbole désignant les asociaux.
Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul, Gallimard, 2025, 96 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 février 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2025
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Nuits Folles — nuits Folles !
Si j’étais avec toi
Les nuits Folles
Seraient notre luxe !
Inutiles — les vents —
Au Cœur qui est au port —
Il en a fini avec le Compas —
Fini avec la Carte !
Ramant au Paradis —
Ah — la Mer !
Pourrai-je mouiller — cette nuit —
En toi !
Emily Dickinson, Du côté des mortels,
traduction François Heusbourg,
éditions Unes, 2023, p. 139.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, folie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2025
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Marcher pour toujours à Ses côtés —
La plus petite des deux !
Cerveau de Son Cerveau —
Sang de Son Sang
Deux vies — Un Être — désormais —
Partager Son sort pour
En cas de chagrin — l’essentiel —
En cas de Joie — abandonner ma part
À ce cœur bien-aimé —
La vie entière —pour connaître l’autre
Que nous ne pouvons jamais apprendre —
Et petit à petit — un Changement
Appelé Paradis —
Voisinage d’humains en extase —
Découvrant alors — ce qui nous troublait —
Sans le lexique !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2023, p. 135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, connaître, partager | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2025
Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus

Présents faits main et mots embarrassés
Au cœur humain ne racontent
Rien
« Rien » est la force
Qui rénove le monde —
Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2017, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, ses oiseaux perdus, rien | ![]() Facebook |
Facebook |
24/03/2025
Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus

Ce n’est pas le corps chancelant qui nous manque —
C’est le Cœur inébranlable,
Qui s’il avait battu mille ans,
N’aurait ployé que dans l’Amour —
Sa ferveur d’Aviron électrique,
Qui l’a porté au-delà de la Tombe —
Nous-mêmes, ce privilège refusé,
Présumons inconsolablement —
Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2017, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, ses oiseaux perdus, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
23/03/2025
Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes

Pas une Romance qu’on lui vend
Ne pourrait autant captiver un Homme —
Que l’examen de
La sienne propre —
C’est à la Fiction — de diluer jusqu’au plausible
Notre — Roman. Quand il est assez petit
Pour être cru — Il n’est pas vrai —
Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes,
traduction François Heusbourg, éditions Unes,
2015, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, nous ne jouons pas sur les tombes, romance, fiction | ![]() Facebook |
Facebook |
22/03/2025
Emily Dickinson, Un ciel étranger

Jusqu’à la mort — Aimer est étroit —
Le plus faible Cœur qui soit
Te maintiendra jusqu’à ce que ton privilège
De Finitude — soit épuisé —
Mais Celui dont la perte te procure
Un Dénuement tel que
Te Vie trop abjecte pour elle-même
Imite dorénavant —
Jusqu’à ce que — Ressemblance parfaite —
Toi-même, à Sa recherche
Aux joies de la Nature — renonces
Fais preuve d’Amour — en quelque sorte —
Emily Dickinson, Un ciel étranger, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2019, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, un ciel étranger, renoncement | ![]() Facebook |
Facebook |





