15/10/2022
Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien. : recension

« Où vivre / et dire ? »
Quatre ensembles titrés, suivis d’un épilogue ("Je ne chante plus, je rêve"), composent le livre : "Ne fuis pas, je te suis", Ne t’encombre pas de la nuit", "Je souffle, et rien." (qui donne le titre), "Ne t’éloigne pas, mon ombre fragile te suit". Une postface de Jean-Marc Sourdillon ("Le regard d’Eurydice") propose une analyse qui rattache les poèmes au mythe d’Orphée à partir de plusieurs indices, dont le titre des séquences ; dans le jeu du je-tu, le tu serait le père disparu, la voix d’Eurydice-je« l’accompagnant (...) dans l’événement de sa disparition pour aller le rechercher ». Les arguments sont convaincants et l’on peut suivre cette lecture. Jean-Marc Sourdillon précise cependant que « le lecteur pourra suivre d’autres fils, découvrir d’autres intrigues, Je souffle et rien, est un livre ouvert. » À côté de sa suggestion, on peut en effet lire autrement les poèmes en les liant aux livres déjà publiés.
L’auteure, plus peut-être que dans d’autres livres, se confond avec la narratrice. Les paysages et les lieux sont ceux où elle vit, la ville des Andelys, la Seine, l’île de Seine, les falaises très présentes, les hameaux (le Petite Andely, Noyers, plusieurs fois cité). Dans ce décor rassurant où tout peut se nommer, le motif de la disparition est repris d’un bout à l’autre du livre : les mots, les étoiles à un moment donné sont présentés comme disparus, et aussi de manière récurrente le tu, « Mes doigts écartés, je te tiens ici, toi qui disparais, disparu ». À ce motif est étroitement associé celui de la perte ; l’absence du tu provoque celle de sa voix, donc le support même de la parole ; ce n’est qu’avec la voix que le Sujet se manifeste, elle rend possible l’existence même du tu, toute relation d’échange avec l’Autre, ce qu’exprime précisément la narratrice, « Tu es perdu / ta voix s’éloigne » et, de là : « mesurant à te perdre l’identité / du pronom nous ». La perte du tu implique aussi symboliquement celle du paysage (« regardant perdu l’horizon ») et celle peut-être du je, au moins de toute intériorité (« mon cœur perdu »). `
Le souhait d’un retour du tu est immédiatement associé à une autre perte, celle du chemin vers un hameau — lieu de naissance et de vie du je ou du tu ? — : « Comme si tu revenais n’ayant pas trouvé perdu le chemin de Noyers ». La narratrice, dans un élan christique, invente même sa résurrection, « Je cours vers toi sur les eaux / pour te faire renaître ». Elle invente aussi « un rendez-vous », sachant que personne ne l’y rejoindra, ou une fiction qui permettrait au nous de se recréer, « Je recompose / le passage secret où te retrouver, / je l’appelle "coquelicot" » ; la fleur incarne pour Isabelle Lévesque (par exemple dans Voltige ! et dans Le Chemin des centaurées) la nature l’été et, par sa couleur, le vivant, l’amour, et tout autant le caractère éphémère de ce qui est. Cependant (« Fini les fées »), aucune métamorphose ne restituera ici le tu qui ne sera présent que par les mots, le temps effaçant progressivement la présence ancienne.
Toute évocation souffre de l’incertitude de la mémoire, d’où n’émergent que l’ombre du tu, que des images indécises — « Je ne rattrape que / ton reflet », écrit la narratrice dans la dernière partie de son parcours —. ; « ombre » est l’un des mots récurrents, présent dans le titre de l’avant-dernière séquence mais relevé dès les premiers poèmes, « Nous savons que s’éloigne / chaque ombre saisie » — il semble d’ailleurs que le lecteur soit inclus dans ce "nous". Les jours de l’enfance du tu sont rappelés (« genoux écorchés tu es l’abandonné »), mais ces jours anciens sont quasiment devenus hors d’atteinte, « Des morceaux de temps / (...) s’écartent de l’origine » et tout est voué à l’oubli, tout ce que la narratrice tente de rassembler, l’ombre même du tu comme le reste. L’écriture restitue ces jeux complexes de perte et d’oubli et empêche la disparition complète du tu : ce rôle ancien de la poésie est ici renouvelé.
En effet, le poème (« Je l’écris pour toi, il existe ») donne un sens à l’absence. Le tu écrit est donc ainsi indéfiniment recréé, « Tant que je vis je te donne forme » et, du même coup, donne aussi raison de vivre au je, « Je change, je chante ». Parce que les mots sont considérés comme « vivants », destinés à faire apparaître l’absent. Dans Le Chemin des centaurées, une autre version de la disparition était empruntée à la Grèce antique avec la question « Ulysse, reviendras-tu ? » ; ici, « Rien ne change nous sommes / laissés pour compte d’une histoire interrompue », et l’histoire est toujours à récrire, à réinventer sachant que l’ombre ne peut être dissipée. C’est pour cela que le coquelicot est présent d’un livre à l’autre, symbole de l’amour et du passage, et que l’épilogue propose en épigraphe quelques lignes de Beckett, extraites de la fin de L’innommable, « (...) il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a (...). Ressassement pour que, dans l’imaginaire, le nous soit recomposé.
Fabrice Rebeyrolle, accompagne les séquences de huit peintures non figuratives. Elles donnent à voir une matière opaque qui peut évoquer celle de la falaise et les couleurs de certaines figurent ciel, eau et horizon des poèmes.
Isabelle Lévesque, Je souffle, er rien., Peintures de Fabticve Rebeyrolle, postface de Jean-Marc Sourdillon, L’Herbe qui tremble, 2022 , 152 p. 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 août 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, je souffle, et rien., recension | ![]() Facebook |
Facebook |
24/05/2022
Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien

Mon « corbeau » resté sur le fil (la ligne s’amenuise),
le son noir et ses ailes trompeuses acheminent,
lorsque loin tu parais encore, l’ombre tenace.
Tu es sur le rempart, la falaise qui s’effondre.
Le corbeau, son bec,
ton sur ton cassé, les syllabes emmêlées
des brins tordus de l’hiver. Il a neigé,
plis rien n’est perçu. L’indistinct porté
dans son vol, son cri.
Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien,
l’herbe qui tremble, 2022, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, je souffle, et rien, corbeau, cri | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2021
Isabelle Lévesque, en découdre

Demain départ
Demain, terre où les graines avivent les sons. Toute ordonnance sillonne et attache l’écorce brune que nous soulevons. Un arbre de plus, et la route.
Demain je quitterai le point fixe de la branche, mon heure aura proscrit l »immobile. Nous ferons corps des nuages. Le chant vers l’ascension. Rien contre ? Tu ne peux retenir les sons, leur écho dissout le temps. Inévitablement.
Sans qu’une faille présume du sort.
Isabelle Lévesque, en découdre, L’herbe qui tremble, 2021, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, en découdre, demain départ | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2019
Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées : recension
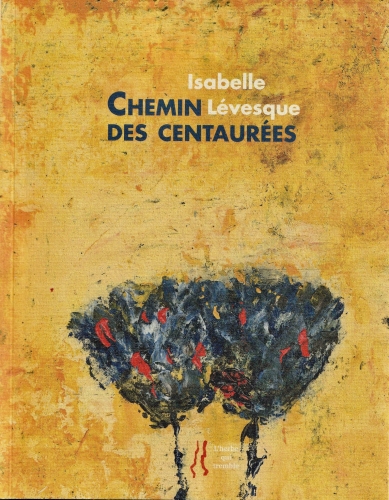
Emprunter "le chemin des centaurées", c’est d’abord accompagner la renaissance, chaque année, du monde ; le livre débute avec mars, suivent les mois jusqu’à la période titrée "Depuis le solstice". Parallèlement se construit le poème (en mai « Nous échafaudons / le poème et le blé bleu / la métamorphose ») et se vit aussi l’attente, celle de l’amour — le "tu" est présent très tôt dans le texte. Rien cependant de propositions lyriques lisses ; sans doute, « La secousse du printemps / délivre vingt fleurs », il n’empêche que d’un bout à l’autre de ce long poème, le lecteur retrouve aussi le motif de l’ombre.
Le renouvellement des choses est marqué par la couleur vive, celle du forsythia, et par les pluies, qui favorisent la naissance des plantes, le verbe "naître" est là et répété. D’autres couleurs viendront plus tard, celle des bleuets — les centaurées—, celle aussi des coquelicots ; ces deux fleurs sont associées, vivant toutes deux dans le blé, céréale de la vie ; elles symbolisent de manière récurrente la nature l’été dans la poésie d’Isabelle Lévesque. Le coquelicot a d’autres caractéristiques ; plus fortement que toute autre fleur, il signifie le caractère éphémère de toute chose, de tout sentiment, y compris de l’amour auquel le coquelicot est lié par sa couleur, comme le sang (« Amour rouge sang cerise »). Mais si « Au plein vent, le coquelicot / défend sa vie », ses pétales finissent par être dispersés et, dans la vie de chacun, « nous savons que rien ne dure ». La relation entre l’amour et les fleurs est beaucoup plus large et, par exemple, le verbe "fleurir" s’emploie aisément à propos de la relation amoureuse, ici « Des baisers fleurissent », comme dans un autre livre* où amour et écriture étaient un instant unis (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).
Le motif de l’amour est une charpente de ce poème des saisons, très vite présenté comme ce qui peut apporter la lumière, écarter ce qui rend la vie difficile, « l’amour / envahit l’ombre — miracle il croît ». Ce n’est pas pour autant que la clarté s’impose, l’ombre ne se dissipe jamais complètement, elle est là, s’éloigne peu, « quelle ombre soudain ? », « l’ombre est telle », etc., et peut-être faut-il finir par l’accepter comme partie de la relation à l’Autre, alors « le rideau laisse passer l’ombre et le soleil caché ». L’Autre, c’est toujours celui qui est attendu, dont on ne sait quand — et si — il (re)viendra ; espéré, il s’apparente à un personnage mythologique (« Ulysse, reviendras-tu ? ») ; appelé, il reste absent et l’union "je-tu" est indéfiniment reportée dans le futur ; de l’ouverture du livre (« tes lèvres promettront / promettent toujours ») à son issue (« Demain (...) / Je courrai vers ta venue »), l’Autre semble n’être qu’une image toujours — et vainement ? — poursuivie, et l’on se souvient de l’"amour lointain" du troubadour Jaufré Rudel. Le lecteur ne peut décider si le "je" s’emploie à imaginer une figure plus ou moins idéale, comme le laissent penser certains vers ; à « je t’ai cherché » correspond « Tu es toujours caché » — mais ce "je" dans ce jeu d’ombres n’a guère plus de présence (« je reste cachée »). Images fuyantes qui s’estompent, disparaissent et se reforment, comme si toute réalité n’avait de consistance que si et seulement si elle était nommée, seul le mouvement du sujet donnerait vie à l’Autre et l’intègrerait dans la nature (« Lorsque je danse autour de toi / tu deviens un nom — tu es / l’écorce et la sève »), nature vivante d’ailleurs grâce aux mots prononcés (« val d’une forêt / que j’imagine »).
L’instabilité caractérise la relation à l’Autre et le sujet ne peut lui donner une assise qu’en rêvant d’être maître du temps (« Je veux devenir le temps »), désir sans autre accomplissement que dans l’imaginaire. C’est dire qu’il est exclu de penser à une continuité (« Soyons éphémères et secrets ») et que vivre implique de reprendre sans cesse « l’impossible quête ». Il s’agit bien, symboliquement, de suivre le mouvement des saisons en sachant, ce qui est répété, que « Tout commence à peine, toujours ». La narratrice engage chaque fois sa recherche par « Je suis perdue qui va — sombre état » pour reconnaître que « Le chemin des centaurées / se donne sans compter ».
Isabelle Lévesque a consacré trois pages au peintre Fabrice Rebeyrolle dont dix peintures accompagnent les poèmes. Ses peintures toujours ressemblantes et pourtant toujours autres, parce qu’elles suggèrent sans représenter, font heureusement écho aux poèmes.
Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées, peintures de Fabrice Rebeyrolle, L’herbe qui tremble, 2019, 132 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 25 septembre 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, le chemin des centaurées, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2018
Isabelle Lévesque, Ni loin ni plus jamais
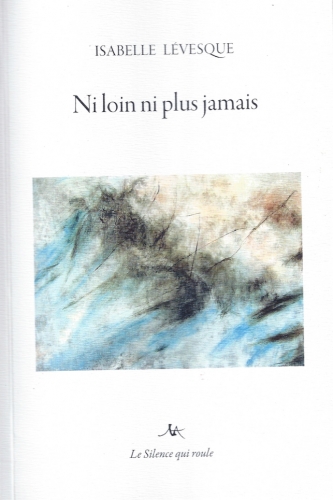 Ni l
Ni l
Certains de mes contemporains, et non des moindres — Jean-Claude Pinson, Nathalie Quintane —, écrivent qu’ils lisent de moins en moins de recueils de poésie, mais plutôt des essais, « sur la poésie, mais pas que »(1). J’ignore si cet éloignement de la poésie vivante, des livres de poésie édités aujourd’hui est répandu, je sais cependant qu’il n’est pas bon d’être un poète mort : qui lit encore André Frénaud, Jean Follain ou Jean Tortel ? Mais si le poète a eu le mauvais goût de se suicider jeune, il a peu de chances de trouver des lecteurs à notre époque. C’est le cas de Jean-Philippe Salabreuil, né en 1940 et suicidé en 1970, après trois livres publiés par le découvreur que fut Georges Lambrichs dans sa collection Le Chemin, La Liberté des feuilles(1964 ; repris dans la collection Orphée, 1990), Juste retour d’abîme(1965), L’Inespéré(1969). Aucun de ces titres, malheureusement, n’est disponible, et aucun n’a été réédité ou proposé dans la collection Poésie / Gallimard(1).
On saluera donc la revue en ligne Possiblesqui, dans son n° 35 d’août 2018, reprend trois poèmes de Salabreuil, suivi de l’hommage que Jacques Réda lui a rendu après sa disparition dans Les Cahiers du Chemin(n°9), mettant en valeur un aspect de son écriture : « (…) ainsi se débat dans la douleur, avec ses sursauts baroques, ses maniérismes, ses audaces, ses apaisements insondables, chaque poème de Salabreuil d’une seule foulée qui bouleverse, car elle est du passage d’un être vers l’amour impossible, le retour impossible, l’impossible et pourtant profonde innocence du cœur. » Presque cinquante plus tard, Isabelle Lévesque lui rend à son tour doublement hommage, d’abord avec une brève étude ; un extrait en est cégalement ité dans Possibleset j’en retiens ces lignes : « Toujours en quête d’une identité poétique, Salabreuil n’aura cessé de chercher et d’expérimenter une langue, il fait songer aux poètes baroques soulevés de tempêtes et d’accumulations flamboyantes ».
L’étude est précédée de poèmes (onze) qui forment une suiteet reprennent quelques éléments de l’œuvre de Salabreuil, outre sa présence (« Il ») liée notamment au personnage de l’Aimée, qui devient l’Absente. Isabelle Lévesque retient dans l’œuvre du poète des traces de sa vie et recompose avec bonheur une figure forte du poète. Par ailleurs, elle introduit aussi le motif de la neige en ouvrant son livre avec un vers de L’Inespéré, « Il a neigé sur l’aurore » — d’où le soleil blanc, les « nuées pâles », la « nacre (…) de l’aurore », la « craie du ciel », la « rose blanche », etc. Mais, vrai hommage, elle conserve ce qui la caractérise, une écriture parfois elliptique qui cherche la tension entre les mots, elle répond au blanc de Salabreuil par le bleu, ciment des poèmes avec les aspects les plus variés — le bleu des fleurs (dont celui des bleuets et des pervenches), des étoiles, du livre, de l’eau, de l’âme… Reste à souhaiter que ce poème contre l’oubli conduise des lecteurs vers Salabreuil, espérons que « L’ardeur est telle / encore », pour citer la fin de la suite d’Isabelle Lévesque.
_____________________________________--
- Un nouveau monde (Yves di Manno & Isabelle Garron) consacre une page à Salabreuil (214) et donne plusieurs poèmes (215-222).
Isabelle Lévesque, Ni loin ni plus jamais, huile de Marie Alloy, Le Silence qui roule, 2018, 36 p., 9 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 14 août 2018.
08/05/2018
Isabelle Lévesque, Pierre Dhainaut, La grande année
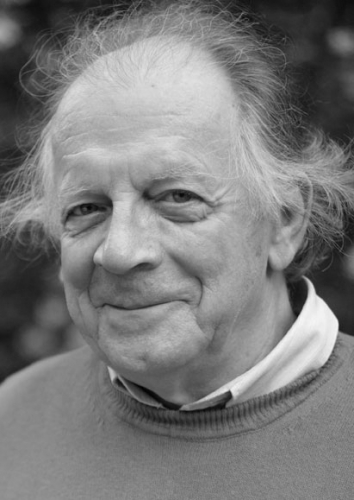
Au milieu des prairies, chaque année,
nous guettons le jour où fleurira le cerisier,
nous ne doutons jamais de la surprise,
de la fête augurale : il nous enseigne
à maintenir, l’année entière, le regard
qui ne flétrit pas l’arbre fidèle.
Pierre Dhainaut, dans Isabelle Lévesque et
D., La grande année, L’herbe qui tremble,
2018, p. 26.

Ici, Aux Andelys
L’ombre d’un cercle dépossédé
glisse dans la nuit.
Si léger.
Ascension cavalière. Blanc comme songe,
la falaise a terrassé les monstres,
il reste un peu de givre sur nos lèvres.
Les marguerites capturent la lumière.
Nous savons deuxqui résonne et tombe.
À midi tout recommence.
Isabelle Lévesque, dans voir supra, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, pierre dhainaut, la grande année, printemps, nature, éveil | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2018
Isabelle Lévesque, Voltige ! (recension)

Les vers d’Apollinaire cités en exergue — « C’est la chanson des rêveurs / Qui s’étaient arraché le cœur / Et le portaient dans la main droite » — annoncent le thème de l’amour (le couple présent-absent) et celui de l’imaginaire. Tous deux, avec le motif du temps (la fleur éphémère, les saisons, le passé), charpentent le recueil, dont le lyrisme se lit d’entrée dans l’abondance d’éléments qui connotent la naissance du monde. Le premier poème commence avec l’aurore, le matin, le chant du coq, l’ouverture des fleurs, mais également avec la présence d’un couple qui semble surgir d’ailleurs (« nos pieds nus / sur la terre »). La nourriture même apparaît première : « les blés le pain la couleur ». La couleur, c’est celle, symbolique de la vie, le rouge ; rouge de la crête du coq, rouge du coquelicot.
Une narratrice sollicite le regard de l’Autre (« Vois mes mains ») et son acquiescement (« Sais-tu », « Veux-tu »), sans qu’une présence continue au cours du livre soit assurée, peut-être réelle, peut-être rêvée. C’est le lieu présent qui signifie l’existence du couple (« ici / nous unissait ») ou, d’une manière différente, la couleur. Le bleu, c’est celui des yeux de l’Autre, mais aussi celui du bleuet, qui croît toujours dans les mêmes champs que le coquelicot, c’est-à-dire la fleur attachée à la narratrice (« Je suis / coquelicot »). L’association des deux fleurs figure une union source de vie, la parole amoureuse même est liée aux fleurs par la couleur et l’épanouissement (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).
Cependant, la fleur est aussi le symbole de l’éphémère, de l’impermanence ; « le vent faucheur » les emporte, le temps les tue. Quand vient le matin, c’est la pensée que le soir sera bientôt là qui domine, et les saisons se succèdent dans le recueil, l’hiver, le printemps et ses « fruits verts », l’été. La neige, élément récurrent, signale aussi l’engourdissement de la nature, image de la fin et, par ailleurs, renvoie sans ambiguïté à un passé lointain : « neiges d’antan » ne peut évoquer que Villon. Le couple formé ne vainc pas le temps et c’est ce que signifie, à sa manière, le lai du chèvrefeuille auquel il est fait allusion. Dans le texte de Marie de France, en effet, Tristan et Iseut se rencontrent grâce à une absence du roi Marc, leur complémentarité n’est donc que passagère, vient rapidement la séparation et l’attente d’une nouvelle circonstance favorable pour d’autres retrouvailles, comme si toute stabilité était exclue, « jamais toujours : seule proposition ».
Pourtant, la vie l’emporte. Le temps, au moins provisoirement, serait vaincu par la trace gravée sur l’arbre, un cœur percé d’une flèche, figure de l’union comme l’étreinte : « Ce soir, cercle clos // tes bras m’entourent ». Mais la vie n’est pas dans l’immobilité pour Isabelle Lévesque, bien plutôt dans la « danse folle » : le titre « Voltige ! » évoque les déplacements rapides, comme ceux de l’acrobate qui sans cesse cherche-trouve-perd son équilibre. La danse est image de la vie, comme le coquelicot dont les pétales s’envolent, « Danse coquelicot ! / Le vent ne peut rester debout, je cesse et libre. // Voltige. » D’un bout à l’autre du livre, on lit le passage de la présence à l’absence, de l’ « ici maintenant » de plénitude à la quête du moment « qui confond le passé le présent ».
Le passé est un temps analogue à celui du rêve : tout désir y a été réalisé, et le passé le plus riche est celui de l’enfance. Revisitée, elle offre le plaisir de revivre ce qui est ordonné, sans épines, « aubaine / à miracles espérés ». Il suffirait de s’y transporter avec l’aimé pour connaître l’accomplissement ; cependant, la proposition « Prendre ta main, nous sommes enfants » n’est qu’un désir qui ne fait pas disparaître le « désarroi de vivre », ni le fait que le vent disperse du coquelicot « les pétales nus loin des blés ». Le caractère souvent rêvé de la plénitude de la femme est restitué par Colette Deblé, qui allie le rouge et le bleu dans ses lavis d’après des figures peintes dans le passé.
Françoise Ascal, dans sa postface, rapproche la thématique d’Isabelle Lévesque des romantiques allemands, notamment pour sa quête « réconciliant le réel et l’imaginaire » et la place particulière faite aux fleurs. Elle note aussi le caractère souvent elliptique des vers ; ce caractère oblige avec bonheur le lecteur à construire ses images, comme dans ce vers parmi d’autres : « Gestes, souffles, prières, rester, poursuivre, garder la fièvre » — on relève ici une régularité du rythme (2/2/2/2/3/4) que l’on retrouve dans l’ensemble du livre. On sera également sensible aux récurrences de quelques mots (vent, rouge, bleu, coquelicot, par exemple) et aux homophonies (rive, rires, rythme ; laisse, lai ; signe, saigne, etc.) qui, comme le rythme, contribuent à l’unité du livre. Voilà une voix singulière à découvrir.
Isabelle Lévesque, Voltige !, peintures de Colette Deblé, L’herbe qui tremble, 2017, 96 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 janvier 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, voltige !, colette deblé, coquelicot | ![]() Facebook |
Facebook |





