05/02/2019
La revue de Belles-Lettres, 2018-2 : recension
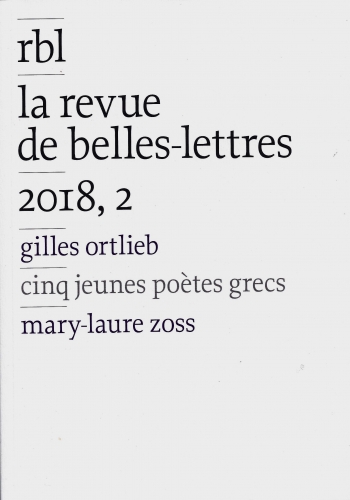
La dernière livraison de la revue éditée à Lausanne propose un dossier consacré à Gilles Ortlieb, occasion de reprendre quelques-uns de ses livres parmi la trentaine publiée. L’ensemble s’ouvre avec une prose, comme issue d’un journal si l’on se fie aux dates qui la jalonnent, autour d’un passage dans une ville, Arles, que la vie semble en partie abandonner ; l’imagination lit des traces de délaissement qui, progressivement, iront « Jusqu’à ce que les anciens marais reprennent possession des jardins et de la campagne environnante ». Journal ou carnet duquel des notes seraient extraites ? le lecteur reconnaît une manière analogue de regarder les choses du monde dans les essais et les poèmes.
La vision de la ville de province, celle de l’essayiste qui « replace[…] sous la lampe » des écrivains peu ou mal lus, s’accordent en effet avec ce que Jacques Réda met en valeur dans l’œuvre. Chaque fois, Gilles Ortlieb « discerne, dans le fouillis du réel, cet inaperçu qui paraît en être l’accessoire sinon le rebut »., il « enregistre, et s’en tient là » ; il saisit le réel comme l’a fait le peintre Thomas Jones,, notamment avec en 1782 Un mur à Naples : on y voit, au milieu d’une muraille dont le crépi s’écaille et laisse apparaître les pierres, deux fenêtres closes et, séchant à la rambarde d’un petit balcon de l’une, un drap et (peut-être) une couverture, et à une ficelle fixée au mur, un vêtement blanc, un autre bleu ; au-dessus à gauche un pan de mur, le ciel bleu à droite : rien d'autre. La comparaison avec le peintre anglais est forte : il y a chez Gilles Ortlieb un semblable « souci d’exactitude » qui, selon Jacques Réda, est peut-être « la seule parade que nous puissions opposer au rien qui, dans l’inaperçu, puise le moyen paradoxal de revêtir toute une variété de formes. » Patrick McGuinness, lui, insiste sur le mélange des genres, le chevauchement des formes dans l’écriture de Gilles Ortlieb qui, prenant toujours pour motif les choses ordinaires de la vie, parvient à y distinguer ce qu’elles contiennent de mystérieux, d’inattendu. C’est que notre quotidien est « comme perçu à travers un télescope tenu du mauvais côté » ; de là non seulement la mise au jour de ce qui demeure caché pour la plupart d’entre nous mais aussi, régulièrement, la « révélation d’une sorte d’algèbre kafkaïenne ».
Le quotidien a sa part dans les extraits de la correspondance (année 1984-1985) avec Henri Thomas, qui fut un modèle pour Gilles Ortlieb avant d’être un ami. Chacun fait part à l’autre de ses activités, de ses lectures, de ses voyages — l’ensemble s’achève avec une longue lettre d’Ortlieb à propos de l’île grecque où il se trouvait. Les difficultés de la vie sont présentes : Henri Thomas propose par exemple son aide pour l’édition d’un texte, Ortlieb, qui traduisait pour une collection aux éditions Laffont, pose une question sans réponse, « Comment concilier gagne-pain et le reste ? La question m’a l’air souvent insoluble ». Comme il le raconte dans une lettre, elle l’est aussi pour Paul de Roux, qui dirigeait la collection : de retour d’une semaine en Bretagne, « il avait suffi d’un jour pour que Laffont lui pèse à nouveau bien lourd ». Mais tous deux s’accordent dans leur correspondance sur la nécessité de l’écriture, sur « la chimère d’y voir plus clair dans la vie et le réel » grâce à elle.
Gilles Ortlieb écrit également à propos d’autres écrivains, ici du dramaturge Arthur Adamov dont il relate quelques moments de la vie*, et, passeur, il est traducteur de l’allemand, de l’anglais et du grec : il donne dans ce numéro cinq bref récits de Tanassis Valtinos. Son "autoportrait" est construit à partir de ses propres proses par Marcel Cohen, non pas pour caractériser l’œuvre mais retenir quelques attitudes de l’écrivain devant le monde ; ainsi dans cet extrait, « Quelle est la nature du plaisir que l’on éprouve (…) à se trouver là où l’on ne devrait pas être et à fuir autant que possible chaque fois que cela est possible, les lieux où la plupart jugent bon de se trouver ? »
À côté de ce dossier, le lecteur retrouvera ou découvrira dans la revue une figure un peu oubliée, celle d’Armel Guerne, poète et grand traducteur, grâce à un hommage de Jean-Yves Masson qui insiste sur l’importance du rôle du rêve chez ce traducteur de Novalis et des romantiques allemands. Un autre écrivain un peu à part, Jean-Loup Trassard, est lu par Mary-Laure Zoss ; attentive au rythme et à l’allure des textes, à « une langue qui engage le corps et le souffle » ; elle montre qu’il se tient dans son œuvre au plus près du vivant et qu’il a su restituer une présence à une civilisation agraire en voie de disparition. On lira encore, réunis par Jean-Daniel Murith, cinq jeunes poètes grecs (dont quatre femmes), non encore traduits, et une longue note de lecture qui clôt le riche sommaire, à propos de Un nouveau monde, poésies en France 1960-2010, d’Yves di Manno et Isabelle Garron ; Jacques Lèbre en regrette les limites, avec des choix qui excluent, d’Edmond Jabès à André Frénaud, de Robert Marteau à Philippe Jaccottet.
* La revue Europe a consacré son numéro de janvier-février 2018 à Arthur Adamov, numéro évoqué par Gilles Ortlieb.
La revue de Belles-Lettres, 2018- 2, Société de Belles-Lettres de Lausanne, 208 p., 25 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 18 janvier 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, 2018- 2, gilles ortlieb, adamov, réda, zoss, masson | ![]() Facebook |
Facebook |





