04/12/2019
Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés d'Alberto Caeiro : recension
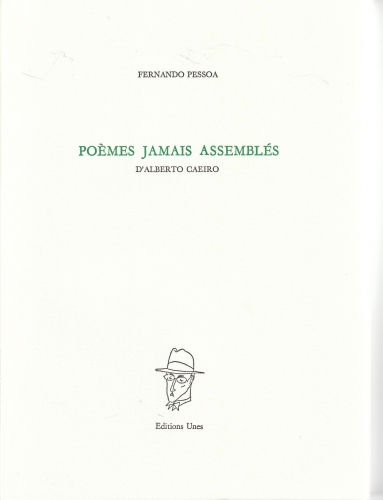
Alberto Caeiro n’est pas le premier, en septembre 1914, d’une longue liste d’hétéronymes de Pessoa, mais il est présenté comme le « Maître ». Ce personnage fictif, « blond clair yeux bleus », « peu instruit », serait né à Lisbonne en 1869, aurait vécu à la campagne, puis serait revenu dans la capitale du Portugal pour y mourir de la tuberculose (comme le père du poète) en 1915. Pessoa en fait l’auteur du Gardeur de troupeaux, d’un journal, Le Berger amoureux et, avant de mourir, des Poèmes jamais assemblés. Comme l’écrivait le "berger", ces derniers poèmes refusent les correspondances du symbolisme et ce qu’elles impliquent et prônent la nécessité de voir les choses telles qu’elles sont.
Il faut, d’abord, accepter ce qui est visible, c’est-à-dire la réalité devant soi, et donc ne pas « exiger du monde qu’il soit autre chose que le monde », monde qui n’a pas besoin de nous pour exister, qui est extérieur à nous, mais auquel nous appartenons comme toutes les choses. Cette acceptation évite des dépenses d’énergie inutiles : si la pluie est présente, ou le soleil, il ne sert à rien de les refuser, et les accueillir pour ce qu’ils sont agrémente la vie. Alors, tenter de changer le réel est contraire à la nature, il faut toujours « laisser vivre le monde extérieur et l’humanité naturelle ». Cette absence d’intervention vaut dans tous les domaines, y compris celui des sentiments amoureux, « Je n’ai pas été aimé pour une seule et bonne raison, / Parce que je n’ai pas été aimé ».
Il n’y a cependant pas à reprendre le point de vue de Cioran — ce serait un inconvénient d’être né ; être vivant permet au contraire d’apprécier le réel, d’ « écouter passer le vent », de regarder les choses et d’être heureux qu’elles soient ce qu’elles sont. Ce n’est pas parce que les choses du monde, fleurs ou arbres, sont "belles" qu’elles peuvent être appréciées, aimées, mais elles le sont plus simplement du fait qu’elles sont fleurs ou arbres. Aucune hiérarchie dans la nature, l’homme n’a pas à classer les éléments par rapport à lui, seulement à constater qu’il est différent de la pierre ou de l’arbre, et Caeiro insiste sur ce point : « Je ne sais pas ce qui est plus ou ce qui est moins » ; qu’il écrive des poèmes est un aspect de cette différence, rien de plus. Entre deux humains, c’est ce qui se passe entre leur naissance et leur mort qui les différencie : la manière dont chacun a saisi le réel est unique, non reproductible, et c’est cela qui forme l’identité de chacun.
La vie, en effet, ne peut être évaluée que d’après la capacité à voir le réel et non par l’accumulation de biens ou la reconnaissance publique, ni même par le fait d’être « en paix avec [sa] conscience ». Alberto Caeiro se définit lui-même comme regardant les choses, sans intervenir sur ce qu’elles sont ; ce qui n’est plus devant ses yeux n’existe plus Aussi est-il sans intérêt de déborder de l’instant présent, de penser ce qui est à venir puisque hors de notre connaissance ou de regretter le passé puisqu’il n’est plus modifiable. De là, « Préoccupons-nous seulement de l’endroit où nous sommes. » La conséquence est claire : vouloir changer les choses et « inventer la machine à bonheur », c’est aller contre la nature ; il est exclu alors de chercher à transformer la société, tout en sachant que la « souffrance sociale » existe, Caeiro la constatant écrit, « J’accepte l’injustice comme j’accepte qu’une pierre ne soit pas ronde ». Le choix est plus général et se formule ainsi, « Ce qui doit être est ce qui n’existe pas ».
Le contenu des poèmes de Caeiro, ici comme dans Le gardeur de troupeaux, s’oppose totalement aux idées de son temps sur la poésie, précisément au symbolisme. En effet, si rien n’existe en dehors de la « réalité immédiate », toute interprétation du monde est nulle, « Tout est défini, tout est limité, tout est choses ». On distingue donc les choses concrètes, que l’on peut voir et toucher, de ce qui est nommé mais n’appartient pas à l’ensemble des choses ; "printemps" est un mot pour désigner une "saison", « c’est une façon de parler », tout comme le vocabulaire de la renaissance du printemps. Le poète refuse du même coup toute personnification, l’eau n’est pas ma sœur, « si elle est eau, autant l’appeler eau » ; il rejette les correspondances entre les choses, la métaphore ou l’analogie, toutes les figures qui ne sont que trahison de la réalité. Une fois pour toutes, une chose « n’est rien d’autre que ce qu’elle est ».
Il faudrait relire ces Poèmes jamais assemblés avec le premier livre de Caeiro pour comprendre les objectifs de Pessoa, le rejet du symbolisme étant un aspect de sa poétique. Ce qui est clair, c’est que le primat de l’immédiat, du visible n’a pas grand-chose à voir, comme cela est parfois écrit, avec la phénoménologie dans ses versions nées après Husserl.
Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés, traduction collective, éditions unes, 56 p., 16 € ; Cette note de lecture a été publié par Sitaudis le 30 octobre 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poèmes jamais assemblés d'alberto caeiro | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.