12/09/2021
Cole Swensen, Poèmes à pied : recension
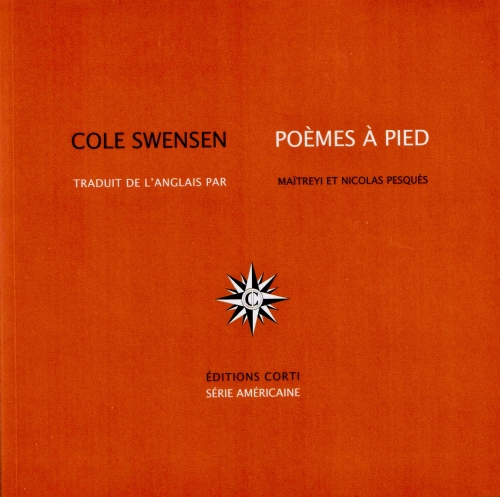
Avant Poèmes à pied, Cole Swensen, traductrice de poètes français, de Jean Tortel à Pierre Alferi, a publié trois livresux éditions Corti, écrits chaque fois à partir de créations françaises, le premier avait pour départ Les très riches heures du duc de Berry, le second prenait pour prétexte des tableaux de Pierre Bonnard, le troisième s’attachait aux jardins de Le Nôtre. Cette fois, le matériau est né de la lecture d’une douzaine d’écrivains qui, plus ou moins longuement, ont écrit à propos de leurs marches, de Chaucer et ses Contes de Canterbury, pour le plus ancien, à la poète américaine Harryette Mullen (née en 1953) — une bibliographie à la fin du livre énumère les titres retenus. On notera que Maïtreyi et Nicolas Pesquès ont traduit les quatre volumes, ce qui restitue à l’ensemble des livres son unité formelle.
L’un des thèmes qui sous-tend le livre apparaît dans le premier poème : Geoffroy Chaucer au long de ses pèlerinages à Rome marche avec le manuscrit de ses Contes de Canterbury ; aucune ambiguïté, Poèmes à pied lie l’écriture et la marche. Un exemple éclairant de ce lien est fourni par Rousseau qui, dans les promenades des Rêveries du promeneur solitaire, exprime avec ses marches son lien profond à la nature ; son manuscrit est « griffonné » — « la main court » —, et dans sa prose « Il y a un lien viscéral entre le rythme de son pas et celui de son écriture ». Dans l’écriture autour des Rêveries, le "je" de Rousseau alterne avec la construction progressive d’une poétique, que résumerait abruptement Wordsworth pour qui, annulant toute différence, « marcher c’était simplement écrire ».
Le lien, quasiment l’équivalence, marcher-écrire, est au centre de la relation à l’environnement et à partir de là plusieurs motifs se développent, celui de l’errance, de la perte, la prise de conscience de soi, très présent notamment chez Rousseau, et de l’étrangeté du monde. Le sentiment de perte est marqué en particulier dans les écrits de Thoreau qui, complètement absorbé par ce qui l’entoure, ou l’absorbant, finit par ne plus s’en distinguer. Alors le temps ne compte plus, ni à certains moments le langage, car peu importe que les espèces sauvages d’arbres fruitiers rencontrés ne soient pas dans les nomenclatures. Ce qui s’éprouve alors dans ce qui est rencontré dans la marche a plus d’importance pour le sujet que ce qui peut en être dit ; comment, par exemple, rendre compte de « l’étonnante variété de blancs » ? Mais cette confusion répétée dans la marche, cette perte temporaire de soi, conduisent à vivre autrement son corps que dans la relation à autrui, il devient comme « un ciel qu’on peut tenir contrairement au ciel qui semble se replier », et l’écriture fait que la marche « littéralement structure la littérature comme une charpente ».
Marcher aboutit souvent à se perdre dans le paysage, et cela d’autant plus aisément le soir ; Stevenson finit même par sentir qu’il « devient le paysage » et George Sand, cette « marcheuse extatique », dans ses errances se perd réellement quand vient la nuit. Les marcheurs nocturnes sont les plus nombreux dans Poèmes à pied ; alors, pour Dickens, le corps est « tel une lame de lumière à la fois improbable et inachevée ». Et le plus souvent il s’agit d’une marche dans la ville ; si Karl Gottlieb Schelle se partage encore, au début du XIXe siècle, entre « le champêtre et le citadin », soit entre « la rêverie et la raison », un de Quincey est « un arpenteur des rues de Londres » et, un peu plus tard, la marche est majoritairement urbaine. On lit encore chez Walser que « marcher toujours sur la même route change le temps en espace », mais c’est surtout le labyrinthe de la ville nocturne qui favorise l’errance et la perte dans l’imaginaire. Pour Sebald écrire à propos de ses marches devient une manière particulière de voyager ; chaque motif en suscitant un autre, ses phrases s’étendent et semblent ne pas pouvoir s’achever, « écriture associative » analogue au mouvement de la marche. Si l’on pouvait conserver les traces de celles accomplies toute une vie, les marches constituaient bien, selon le mot de Borges donné en exergue, « un dessin sur le temps » ; passé impossible à conserver et que la marche a effacé, comme écrire effacerait la mémoire pour Iain Sinclair.
En alternance avec les marches lues, Cole Swensen écrit aussi les siennes, toutes nocturnes, en les datant, pour en garder la trace. Presque toutes sont des ruptures d’avec la vie ordinaire, diurne.
Virginia Woolf rencontrait un chat, que la nuit faisait disparaître, Cole Swensen en croise plusieurs qui avancent avec un but connu d’eux seuls, l’un simplement né d’un jeu de lumière. Elle se trouve dans un parc où un octogénaire lit un magazine près d’un bassin, à plusieurs reprises sur un pont, lieu d’observation d’où elle voit des scènes surprenantes. La marche nocturne permet des rencontres que le jour exclut, comme si la nuit était indispensable pour transformer les choses et les manières de se comporter, comme si tous les actes sociaux diurnes perdaient une partie de leur sens. Cole Swensen remarque que les mouettes « tournent sans but », mais également qu’à onze heures du soir beaucoup de monde est dans la rue et que « personne ne va nulle part. » Comme si marcher devait aboutir à se perdre.
Cole Swensen, Poèmes à pied, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, Corti, 2021, 120 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans libr- critique.com le 19 juillet 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, poèmes à pied, traduction maïtreyi et nicolas pesquès | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.