31/01/2024
Jean-Louis Giovannoni, Le grand vivier, Journal 2020-2021 : recension
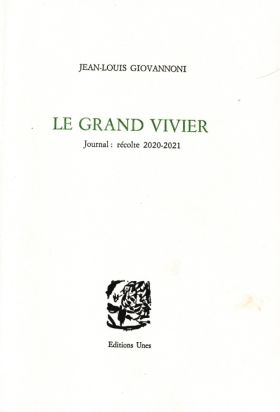
« Rien ne nous attend en dehors de nos inventions »
Le journal — "journal intime" est un pléonasme — n’est en principe pas destiné à la publication ; que l’on pense aux écrits de Joubert (1754-1824), dont des extraits ont été édités sous le titre de Recueil de pensées de M. Joubert, par Chateaubriand, intégralement en 1939 avec le titre Carnets. Depuis la seconde moitié du XIXe, d’abord avec les Goncourt, puis Léon Bloy, le journal devient un genre à part entière : une partie d’une œuvre est constituée par un journal publié à intervalles réguliers (Julien Green, Charles Juliet) et certains écrivains donnent à lire leur journal peu après sa rédaction (Christian Prigent, Pierre Bergounioux). Le grand vivier répond aux règles générales du journal, avec la mention des dates, de ce qui préoccupe le narrateur ; pourtant, l’un des extraits mis en exergue, « Je sais ce qui est autour de moi » (Wallace Stevens) pourrait donner une idée erronée de son contenu.
Le journal s’ouvre avec la date du premier confinement, le 17 mars 2020, et son effet visible, « Rien ne bouge. Personne dans les rues ». Cela paraît peu vraisemblable mais annonce la perception particulière des choses du quotidien ; une partie de ce qui entoure Giovannoni est constamment transformée et ce dès la note du 18 mars : il constate que les objets restent muets et qu’avec eux la relation affective est médiocre, maladroite. Ils peuvent d’ailleurs sembler prendre vie, sans le manifester clairement ; ainsi les vêtements sur leur support, note le narrateur, « n’attendent qu’une chose : mon corps » et souvent semblent bouger ; le savon fendillé sur le lavabo rêve visiblement de l’eau. Les meubles restent dans un silence « inentamable » mais leur rôle n’est pas négligeable, il est indispensable de les heurter pour « continuer à se sentir vivant ».
C’est qu’en effet le corps même du narrateur n’a pas d’assise suffisante pour se reconnaître comme tel ; à intervalles réguliers, il perd sa réalité jusqu’à rencontrer son autre lui-même : « Je ralentis toujours avant de franchir une porte. Peur de me croiser au détour d’un couloir ». Comment « se sentir fidèle à soi-même » devant le miroir quand on a le sentiment d’y voir chaque fois un inconnu. En outre, ce que font les personnes observées depuis le balcon n’est pas interprétable — des gens à leur fenêtre applaudissent, sans que l’on en ait la raison —, une dame se promène une laisse à la main — le chien, peut-être devant ou derrière elle, n'apparaît pas ; etc. L’hallucination n’est pas loin quand, dans une file d’attente le narrateur imagine sentir qu’on le pousse dans le dos alors que personne n’est derrière lui, la répétition de cette sensation l’inquiète et le fait partir.
L’espace même perd sa stabilité. Le balcon devient pont de navire et « appuyé au bastingage », « on a coupé les amarres ! » et l’on voit les immeubles s’éloigner ; d’autres demeurent à quai, le sable dans les rues s’accumule et pourrait devenir dune. Au paysage urbain se substitue la mer, l’absence de repères et la fin des relations sociales. Avec un scénario analogue le narrateur quitte la ville rêve avec le désir de s’envoler depuis le balcon, il verrait aussi volontiers des morceaux de son corps partir dans le vent. Une autre forme de disparition imaginée est fondée sur la réduction du corps : il rétrécit et « se glisse dans une boîte hermétique placée au fond d’un tiroir » ; on pense aux sculptures que Giacometti gardait dans une boîte d’allumettes. Ici, le narrateur souhaite que la boîte soit oubliée, du même coup sa propre existence.
Ce n’est que très rarement qu’un autre personnage — un "tu" — apparaît dans le livre. La nuit, le narrateur touche un visage (« ton visage ») ; plus avant, une scène est probablement rêvée, liée à la "vie" des pierres ; il jette au loin, note-t-il, « la pierre que tu m’avais offerte ». Restent le chat, les joggeurs du matin, quelques voitures, un voisin à sa fenêtre avec des jumelles. Pas de rupture dans les notations. Ce qui est extérieur au corps n’acquiert une existence que si des phrases ont été écrites, « Ces corps ne frémissent que si des phrases, des sonorités de mots bougent en moi, en lieu et place de cet arbre, de ce mur, de cette maison… à jamais dehors et moi à jamais dedans. » Les choses, les personnes ont perdu leur réalité et la fin du confinement, pour l’essentiel, ne change pas la vision du narrateur. Cependant, il faut continuer à vivre et puisque tout est désormais à nouveau en ordre, « on peut sortir ».
Jean-Louis Govannoni, Le grand vivier, Journal 2020-2021, éditions Unes, 2023, 176 p., 23 €. Cette recenion a été publiée par Sitaudis le 24 décembre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.