Rechercher : philippe raymond
Lou Andreas-Salomé, Lettre à Rainer Maria Rilke

Vienne IX, Pelikangasse 13, 13 janvier 1913
Cher Rainer,
J’ai devant moi ta lettre, qu’on vient de m’apporter, et il me semble que la neige de ces premières vraies journées d’hiver qui s’étale devant mes fenêtres et sur le jardin en fait aussi partie, parfaite illustration de cette distance entre nous dont tu écris qu’elle ne devrait pas exister. Je la ressens très souvent, Rainer, cette distance purement spatiale, et l’absurdité de ne pouvoir la franchir. À moins de recourir au train et à tout un luxe de combinaisons dans les rendez-vous. Il faudrait, eu contraire, que nous puissions nous retrouver sans bruit et tout naturellement sur des chemins perdus — que ce ne fût pas du tout un morceau de vie à côté d’autres qui s’en trouveraient modifiés, mais sans déplacer les autres ni se soumettre à leurs limites. Cela devrait être possible, et le sera peut-être un jour. Pour moi, quelque chose de semblable ou presque, existe déjà, et je t’en ai plus d’une fois parlé. Quand je lis ta lettre, et l’extrait de ton journal, et tout ce qui s’y trouve brusquement exprimé de ce qui reste, même dans le contact le plus personnel et le plus intense, sans substance et sans voix, — alors oui, je t’ai auprès de moi. […]
Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé, Correspondance, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Gallimard, 1980, p. 252-253.
22/07/2017 | Lien permanent
Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris
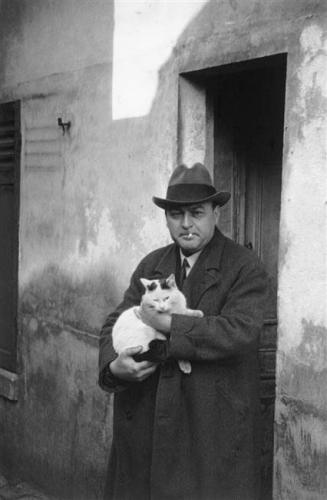
Ghetto parisien
Ce n’est pas, à proprement parler, un ghetto comparable à ceux de Pologne, de Roumanie ou de Hollande, c’est un petit pays limité par la rue du Roi-de-Sicile, la rue Ferdinand-Duval, autrefois rue des Juifs, et la rue Vieille-du-Temple, et dont le centre se trouve au coin de la rue des Écouffes et de la rue des Rosiers, où s’ouvre la librairie Speiser, rendez-vous de tous les Juifs du monde. Stefan Zweig ne traversa jamais Paris sans faire une visite à cette boutique. Trotsky venait souvent s’y asseoir. J’y suis entré tout à l’heure pour y apprendre la mort de Zuckermann, qui tenait à cette place, il y a quelque trente ans, un excellent restaurant où nous venions avant la guerre, Charles-Louis Philippe, Michel Yell, Chanvin et moi-même, attirés par une eau-de-vie qui sentait la violette et que le fils du patron nous servait avec une grâce de petit seigneur.
Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Gallimard, 1939, p. 100.
12/08/2017 | Lien permanent
Ingeborg Bachmann, Malina

La chambre est grande et sombre, non, c’est une salle aux murs crasseux, ce pourrait être un château des Hohenstaufen dans les Pouilles, car elle n’a ni porte ni fenêtres. Mon père m’y a enfermée, je m’apprête à lui demander ce qu’il veut de moi, mais je n’en ai pas le courage, et recommence à chercher des yeux une porte. Il doit bien y en avoir une, ne serait-ce qu’une, qui me permettrait de sortir ; pourtant je comprends déjà qu’il n’y a rien, il n’y a plus d’ouvertures, on a installé à leur emplacement des tuyaux noirs fixés tout le long des murs comme d’énormes sangsues appliquées aux parois pour y sucer je ne sais quoi. Ces tuyaux, comment ne les ai-je pas remarqués plus tôt, ils devaient y être depuis le début ! Aveugle dans la pénombre, j’avais longé les murs à tâtons pour ne pas perdre de vue mon père, pour trouver la porte avec lui, or c’est lui que je trouve, et je lui dis : la porte, montre-moi la porte. Mon père détache tranquillement un premier tuyau du mur, je vois un trou rond où il passe un souffle de vent, je rentre la tête dans les épaules, mon père continue, détache les tuyaux les uns après les autres, et sans avoir le temps de crier, je respire du gaz, de plus en plus de gaz. Je suis dans la chambre à gaz, c’est elle, la plus grande chambre à gaz du monde, et je suis seule dedans. Contre le gaz, on ne se défend pas. Mon père a disparu, il savait où étaient les portes et ne me les a pas montrées.
Ingeborg Gachmann, Malina, traduction Philippe Jaccottet et Claire de Oliveira, Seuil, 2008, p. 148.
28/05/2016 | Lien permanent
James Joyce, Finnegans Wake
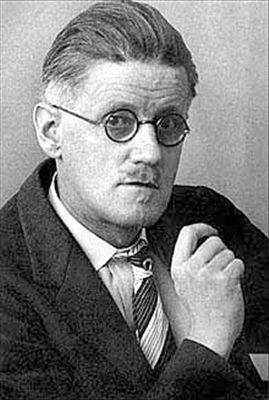
(…)
Entends, Ô monde du dehors ! Notre petit bavardage ! Soyez attentifs citoyens des villes et des bois ! Et vous les arbres, donnez votre écot !
Mais qui vient par ici avec ce feu au bout d’une perche ? Celui qui rallume notre maigre torche, la lune. Apporte les ramours d’olive sur la boue des maisons et la paix aux tentes de Cèdre. Néomène ! Le banquet du tabernacle s’approche. Shop-shup. Inisfail ! Tinkle Bell, Temple Bell ; ding ding disent les cloches du Temple. Sur un ton de synéglogue. Pour tous ceux d’esprit vif. Et la vieille sorcière qu’on damanomme Couvrefeu siffle de son allée. Et hâtez-vous, c’est l’heure pour les enfants de rentrer à la maison. Petits, petits enfants, rentrez chez vous dans vos chambres. Rentrez chez vous vivement, oui petits petits, allez, quand le loup-garou est dehors. Ah, éloignons-nous, réjouissons-nous, restons chez nous où la bûche dans son foyer brûle lentement !
(…)
James Joyce, Finnegans Wake, traduit de l’anglais par Philippe Lavergne, Gallimard, 1982, p. 262-263.
05/08/2016 | Lien permanent
Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments
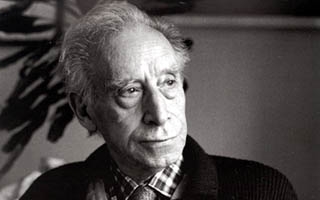
Elle s’ouvrit, eau de roche
Elle s’ouvrit, eau de roche,
goutta, veine indécise
jusqu’à un gargouillis de source
sous le soleil qui l’incendie —
et voici qu’elle inonde
les ruisseaux
de son ravinement
et l’arche de son rebond,
eau et feu, maintenant,
et enfance
devenue langage
clair et sourd, changeant et éternel,
dents et barbe des prophètes
en ruisselant comme stalactites et mousse
dans les âges arides,
en des terres désertes
elle épandue à chaque baptême.
Avec elle autrefois j’ai fait mainte ripaille
mais sans rien dissiper : rien.
Ainsi parle la parole,
de cela témoigne le témoignage.
Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments, traduction
Philippe Renard et Bernard Simeone, Flammarion,
1987, p. 269.
16/05/2020 | Lien permanent
Eduard Möricke, Poèmes / Gedichte, traduction de Nicole Taubes : recension
 D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.
D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.
Eduard Mörike est entré au séminaire d'Urach, dans le Jura souabe, puis dans celui de Tübingen comme avant lui Hölderlin et Schelling. La vie de pasteur ne lui convenait pas et il finit par l'abandonner pour enseigner dans un pensionnat de jeunes filles à Stuttgart, mais l'enseignement qu'il avait reçu lui donna le goût des littératures grecque et latine. À côté des traductions qu'il publia, il a emprunté des genres à l'Antiquité, imité ses poètes préférés — "Acmée et Septimius", d'après Catulle, plusieurs fois présent — et les a régulièrement cités : Tibulle, Anacréon, Erinna, élève de Sappho, ou leur a rendu hommage : « Ô laisse-moi te célébrer, Théocrite aux multiples grâces ! » ("Théocrite").
On pourrait lire Mörike comme un poète résolument tourné vers le passé, il n'accorde en effet quasiment aucune place aux événements qui transformèrent le XIXe siècle, contrairement à son contemporain Heine. Son entourage n'est pas absent, mais en dehors d'une "Cantate pour l'inauguration de la statue de Schiller" (1839), il est présent dans des pièces de circonstance, parfois de quelques vers, écrites à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, d'un retour de cure, ou à propos de la mort d'un oiseau, du jouet d'un enfant, quand ce n'est pas pour déplorer la présence de moustiques qui gênent une promenade et empêchent la lecture au pied d'un arbre ("La plaie de la forêt"). On peut ajouter la satire de ceux qui s'imaginent importants et ont un air très ou, dernière pièce du volume, le congé donné au critique seulement soucieux de la taille du nez du narrateur : celui-ci lui « applique de tout cœur / Le bout de [son] soulier / Sur sa partie charnue, au bas du postérieur » ("Le congé").
On pourrait donc à juste titre se désintéresser d'une poésie trop tournée vers des modèles anciens et se vouant à rimer à propos de futilités. Ce serait aller bien vite en besogne. Ce n'est pas le "sujet" d'un poème qui importe, mais le travail dans la langue (voir Mallarmé), et si Mörike était nourri de l'Antiquité, il n'était guère différent en cela de beaucoup de poètes romantiques en Europe et il a souvent privilégié les mêmes motifs qu'eux. Il apprécie les petits faits de la vie quotidienne, les lieux sans apprêts, qu'il évoque en les transformant, par exemple pour exalter le sentiment de l'amitié (« De nouveau tu m'emplissais l'âme / Comme un frère ne le pourrait pas, comme jamais une femme ») ou, devant la nature, pour exprimer la faiblesse humaine ; ainsi dans la longue méditation après un voyage à Urach où il avait commencé ses études : « Au long des jours, des ans, tu [=la nature] restes immuable, / Et souffres sans douleur le passage du temps. »
La nature est aussi lieu du merveilleux, domaine des forces bienfaisantes ou pleines de malice. Ici, « l'étang s'agrandit, devient une mer », là on voit « un squelette / À cheval sur des ossements », ou "l'homme impavide" descendre au pays des morts, ou encore Greth la mauvaise commander aux éléments, tuer le fils du roi qui l'a négligée, puis « Elle, avec un lugubre chant, / Jette alors son corps à la mer ». On lira d'autres minuscules tragédies, mais aussi le conte des deux cigognes venues annoncer une double naissance ou celui des fantômes du tonnelier du château de Tübingen qui se manifestent de manière facétieuse.
Ce goût du conte, Mörike l'a revendiqué, notant qu'avec Grimm « Au merveilleux, j'ouvris mes sens : j'entrai dans le monde des fées, / Et la forêt devint plus claire, étrange le chant du coucou ! ». À la vie parallèle, celle où les lois naturelles ne sont plus observées, s'ajoute la rêverie qui modifie le réel selon le désir. "Rêver", "rêve", voilà des mots qui reviennent sans cesse dans les poésies, dès les premières écrites en 1820 : « Seul, en silence, sur mon siège / Je me berce de mille rêves ». On multiplierait les exemples, qui indiquent la difficulté à supporter le réel : « Si j'ouvre grand les yeux, je suis pris de vertige ; / Alors je les referme et je retiens le rêve. » C'est là encore un des motifs du romantisme européen, le gouffre entre les désirs et le vécu, et le refuge dans le rêve :
Le poète souvent s'exalte à des chimères,
Peines de cœur, belles amours imaginaires [...]
Je veux croire si fort sans bornes mon bonheur
Que souvent je me perds dans le rêve éveillé.
Ces amours imaginées sont souvent pleines de sensualité, le narrateur « dévoré de l'envie et du désir d'elle » demande à la femme de lui accorder une faveur : « Laisse-moi seulement plonger mon front, mes yeux, / Dans l'épaisse toison bouclée de tes cheveux », et il se souvient, lui dit-il, qu'« Au sang nos lèvres se mordirent / Ce matin, en nous embrassant » ; etc.
Amours imaginées, imaginaires : prétexte à multiples variations, motif d'écriture, comme le spleen dont on relèvera également l'expression : « Ce que je pleure, je ne sais, / C'est un mal qu'on ne connaît pas », ou : « Quelle mélancolie vient embuer mes yeux ? » Motif d'écriture, certes. Et Mörike insiste sur « le non-dit des mots et tout leur invisible », rappelle par une image que le poème ne naît pas aisément : « gratte encore un peu le sol : / La poésie , qu'est-elle d'autre ? », revient régulièrement sur ce qui compte avant tout, « retenir, grâce à la forme, / Tout cela [la beauté, la vie de la nature] pour l'éternité ! ». C'est là un programme qu'aurait approuvé en France un Baudelaire. Il faut lire Mörike !
Eduard Mörike, Poèmes / Gedichte, traduction, notice biographique et éditoriale de Nicole Taubes, introduction de Jean-Marie Valentin, Les Belles Lettres, 2010.
Cette note a d'abord été publiée dans la revue Europe, 2011.
11/01/2012 | Lien permanent
Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments

Genera azzurro, l’azzurro,
si sfalda e si riforma
nelle sue terse rocce,
si erge in obelischi, scende
nelle sue colate e frane
di buio e trasparenza, migra
nell’azzurro fumigando, azzurro
in azzurro sempre —
sale
su, a volte,
affonda
il desiderio
in quella luminosa carne
di quel nume
di quel caos
ed ecco
gli si apre,
cielo, sì, e gorgo
lo spazio da ogni parte —
ma è lo spazio
quello ? o il tempo
prima e dopo il tempo, l’onnipresente ?
o l’uno e l’altro o niente di questo…
oscilla e vi si perde,
desiderio d’uomo
lasciato dalla sua storia, oh sola
felicità, s’inebria
egli di quella, non ha sede, non ha memoria…
L’azur engendre l’azur,
s’effrite et se reforme
dans ses roches limpides, s’érige en obélisques, dévale
ses coulées, ses éboulis
de nuit et transparence, migre
dans l’azur en fumant, azur
dans l’azur toujours —
il monte
parfois,
il sombre
le désir
dans la chair lumineuse
de ce génie
de ce chaos
et voici
que s’ouvre à lui,
ciel, oui, et gouffre
l’espace de toutes parts —
mais est-ce là
l’espace ? ou le temps
avant et après le temps, l’omniprésent ?
ou l’un et l’autre ou rien de cela…
il oscille et s’y perd,
désir d’homme
abandonné par son histoire, oh seul
bonheur, dont il
s’enivre, il n’a pas d’assise, pas de mémoire…
Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments, traduit de l’italien par Philippe Renard et Bernard Simeone, Flammarion, 1987, p. 236-237.
08/06/2011 | Lien permanent
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre
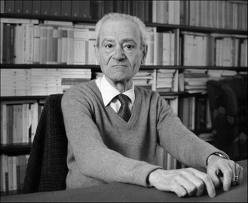
Condition
Un homme seul,
enfermé dans sa chambre.
Avec toutes ses raisons.
Tous ses torts.
Seul dans une chambre vide,
à parler. Aux morts.
Condizione
Uno uomo solo,
chiuso nella sua stanza.
Con tutte le sue ragioni.
Tutti i suoi torti.
Solo in una stanza vuota,
e parlare. Ai morti.
*
L'emmuré
« Vous m'avez fusillé
la bouche », dit-il. « J'ai tant
aimé (id est cherché
l'amour que je me retrouve
maintenant emmuré
dans cette tour. Au-dehors
est le désert du soleil,
des orties — le gel
ébloui du jour
est le glacier. À l'intérieur,
sur mon égoïsme
tout entier rimé, le four
aveugle de mon altruisme
effaré et non regretté. »
Il murato
« M'avete fucilato
la bocca, » disse « Ho tanto
amato (idest cercato
amore) ch'ora
io mi trovo murato
in questa torre. Fuori,
è il deserto del sole
e delle ortiche — il gelo
abbagliato del giorno
sul ghiacciaciaio. Dentro,
rimato tutt'intero
col mi egoismo, il forno
cieco del mio sgomentato
illacrimato altruismo. »
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre, traduit de l'italien
par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie, 2002, p. 25
et 24, 113 et 112.
11/01/2013 | Lien permanent
Andrea Zanzotto, Essais critiques

Pour Paul Celan
Pour quiconque, et tout particulièrement pour qui écrit des vers, prendre contact avec la poésie de Celan, fût-ce en traduction et sous une forme partielle et fragmentaire, se révèle bouleversant. Celan mène à bien ce qui ne semblait pas possible : non seulement écrire de la poésie après Auschwitz, mais encore écrire "dans" ces cendres-là pour aboutir à une autre poésie en pliant cet anéantissement absolu, tout en demeurant, d'une certaine façon, au sein de cet anéantissement. Celan traverse ces espaces effondrés avec une force, une douceur et une âpreté qu'on n'hésiterait pas à qualifier d'incomparables : mais frayant son chemin à travers les encombrements de l'impossible, il engendre une éblouissante moisson d'inventions, d'une importance décisive pour la poésie de la seconde moitié du XXe siècle, européen et au-delà, celle-ci se révèle néanmoins exclusives, excluantes, sidéralement inégalables, inimitables. Toute herméneutique, que toutefois elles attendent et prescrivent impétueusement, s'en trouve mise en crise.
Au reste, Celan avait toujours su que plus son langage allait de l'avant, plus il était voué à ne pas avoir de signification, pour lui, l'homme avait déjà cessé d'exister. Même si d'incessants sursauts de nostalgie pour une autre histoire ne font pas défaut dans ses écrits, celle-ci lui apparaît comme le développement d'une négation insatiable et féroce : le langage sait qu'il ne peut se substituer à la dérive de la déstructuration pour la transformer en quelque chose d'autre, pour en changer le signe : mais, dans le même temps, le langage doit "renverser" l'histoire, et plus que l'histoire, même s'il se révèle tributaire d'un tel monde, il doit le "transcender" pour en signaler au moins les effroyables déficits.
[...]
Andrea Zanzotto, Essais critiques, traduits de l'italien et présentés par Philippe Di Meo, éditions José Corti, 2006, p. 17-18.
28/03/2013 | Lien permanent
Hölderlin, Hypérion, Fragment Thalia
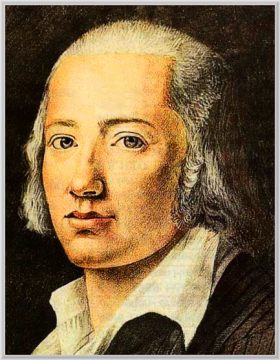
Fragment Thalia
Il est pour l’homme deux états idéaux : l’extrême simplicité où, par le seul fait de l’organisation naturelle, sans que nous y soyons pour rien, nos besoins se trouvent en accord avec eux-mêmes, avec nos forces et l’ensemble de nos relations, et l’extrême culture, où le même résultat est atteint, les besoins et les forces étant infiniment plus grands et plus complexes, grâce à l’organisation que nous sommes en mesure de nous donner. L’orbite excentrique que l’homme (l’espèce aussi bien que l’individu) parcourt d’un point à l’autre, c’est-à-dire de la simplicité plus ou moins pure à la culture plus ou moins accomplie, paraît être toujours identique à elle-même, du moins dans ses directions essentielles.
Les lettres, dont ce qui suit n’est qu’un extrait, se proposent de décrire quelques-unes de ces directions, ainsi que les corrections dont elles sont susceptibles.
Le rêve de l’homme est à la fois d’être en tout et au-dessus de tout, et la sentence que l’on peut lire sur la tombe de Loyola : « Non coerciti maximum, contineri tamen a minimo »(1), peut aussi bien définir ce dangereux penchant à tout convoiter et à tout dominer que le pus haut et le plus bel état que l’homme puisse atteindre. Laquelle de ces deux interprétations choisir, c’est à la libre volonté de chacun d’en décider.
Hölderlin, Hypérion, Fragment Thalia, dans Œuvres, sous la direction de Philippe Jaccottet, Pléiade / Gallimard, 1967, p. 113 ; traduction P. Jaccottet.
- "Ne pas être limité par le plus grand et n'en tenir pas moins dans les limites du plus petit
15/08/2016 | Lien permanent





